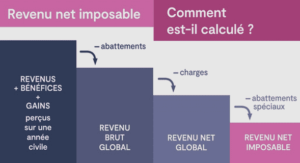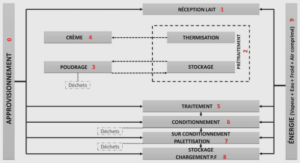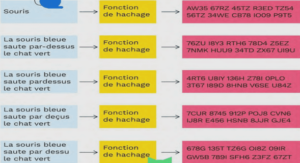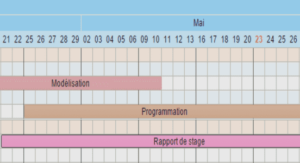Présentation du Parc National du Delta du Saloum (PNDS)
Le Parc national du Delta du Saloum occupe l’aire centrale de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS). Celle-ci est située au centre-ouest du Sénégal jusqu’à la frontière gambienne. Elle couvre la zone côtière sur la façade atlantique, entre 13°35 et 14°15 de latitude Nord et 16°03 et 16°50 de longitude ouest (Djigo, 2000). Elle correspond à la partie estuarienne du bassin hydrographique du Saloum, du Diomboss et du Bandiala. La RBDS s’étend sur environ 550 000 ha dont 76 000 ha constituent les ensembles amphibies et maritimes du Parc National du Delta du Saloum (Dia, 2003 ; DPN, 2014). La réserve est subdivisée en deux zones :
– l’aire centrale correspond au Parc national du Delta du Saloum, où les écosystèmes sont entièrement protégés contre toute exploitation. Sa spécificité réside dans le fait qu’il héberge un village : Bakadadji ;
– l’aire périphérique appelée aussi aire à usages multiples correspond aux terroirs villageois dont certains sont contigus au parc, notamment Missirah, Djinack, Massarinko, Béttenty, Samé, Karang et Karamba ;
– une troisième zone qualifiée de zone tampon entre l’aire centrale et l’aire périphérique reste toujours à définir.
Historique de la création du PNDS
Le PNDS est créé sur la base du décret présidentiel numéro 76577 du 28 mars 1976 (DPN, 2014). Cette aire aux fortes potentialités naturelles est unie à l’ensemble du complexe estuarien en 1981, pour former la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (RBDS). En 1984, le parc, zone d’accueil de plusieurs espèces d’oiseaux paléarctiques a été classée « zone humide d’importance internationale », en vertu de la convention sur les zones humides signée à Ramsar en 1971.
En 2008, le complexe PNDS et Parc National du Niumi en Gambie est devenu le premier site Ramsar transfrontalier non seulement africain, mais aussi extra-européen (DPN, 2014).
La présence d’importants sites d’amas coquilliers témoigne de l’occupation ancienne de la zone et des activités productrices qui y étaient exercées.
Structure et gestion
Sur le plan national, le parc est régi par deux textes de loi à savoir :
Le code de la chasse et de la protection de la faune et le code forestier (DPN, 2014).
En plus de ces deux textes, le parc dispose d’un règlement intérieur avec dans l’organisation une équipe de gestion de 22 agents dont 1 contractuel. Celle-ci est dirigée par un conservateur et son adjoint établis au poste de commandement (PC) de Bakadadji.
On compte six (06) postes de gardes (PG) réparties comme suit :
– Taïba, Karang, Massarinko et Missirah qui se retrouve dans les limites terrestres du parc ;
– Djinack et Béttenty qui sont insulaires.
Ces PG sont installées dans des lieux stratégiques. Ils comptent chacun deux agents.
Le poste de Karang héberge l’infirmerie qui est géré par un agent/infirmier.
En dehors de cette équipe, il abrite une station biologique localisée au niveau du poste de commandement et un personnel d’appui constitué d’écogardes volontaires issus des différents villages qui l’entourent.
Le PNDS se charge de plusieurs missions telles que :
– la conservation et le suivi écologique ;
– l’aménagement et la gestion des habitats ;
– la surveillance ;
– la sensibilisation et l’éducation environnementale ;
– la formation et l’appui à la recherche scientifique ;
– l’appui au développement communautaire
Caractéristiques physiques
les sols
La couverture pédologique du Sine-Saloum est liée à l’évolution géomorphologique de l’estuaire et ses bordures. On y distingue :
– les sols ferrugineux tropicaux, lessivés et non lessivés, développés sur la couverture gréseuse du continental terminal et sur les dunes continentales;
– les sols hydromorphes minéraux à pseudogley développés dans la partie supérieure du glacis de raccordement des tannes aux unités du plateau continental. Ces sols peu fertils sont caractérisés par la présence de fer et un pH acide ;
– les sols fortement minéralisés sur les cordons ;
– les sols hydromorphes bruns dans les vallées et ;
– les sols halomorphes des tannes, situés à l’arrière de la mangrove (CCLME, 2014).
L’hydrologie
Le Delta du Saloum se caractérise par la présence d’importantes ressources en eaux de surface, les eaux souterraines sont également abondantes mais leur qualité est généralement mauvaise, d’où le déficit en eau douce constaté par endroits.
L’estuaire du Sine-Saloum draine un bassin versant de 29720 km² dont le relief est en général plat et la pente très faible (Bousso, 2000). La surface en eau est de 90000 ha. La marée monte deux fois par jour jusqu’en amont de Kaolack situé à 112 km de l’embouchure et aucun cours d’eau de quelque importance que ce soit ne vient à la rencontre de l’eau salée. Les pluies représentent le seul apport d’eau douce (Bousso, 2000).
Le système hydrographique de cet ensemble est formé de trois bras principaux : le Saloum (110 km de longueur) au Nord et Nord-Est, le Bandiala (18 km) au Sud et Sud-Est et le Diomboss (30 km) entre les deux (CCLME, 2014). Ces deux derniers ont leur embouchure dans le PNDS alors que celui du Saloum est à la limite Nord du Parc.
Le Diomboss avec une embouchure large de 4 km est moins long que le Saloum mais plus large que ce dernier.
Le Bandiala est plus court et moins large que les deux premiers (rarement 500 m).
Les trois systèmes hydrologiques Saloum, Diomboss et Bandiala sont interconnectés par de grands chenaux de marée qui créent deux groupes d’îles bien distinctes ; au nord les îles du Gandoul (en majorité sérères), au sud les îles Béttenty (majorité mandingues). Un lacis de petits chenaux (bolongs) sépare chacun de ces deux ensembles en une multitude d’îles (Bousso, 2000).
La chute de la pluviométrie combinée à une forte évaporation et à une pente très faible des biefs avals du complexe estuarien a provoqué une élévation des salinités. Perpendiculairement à la côte, la salinité présente un gradient caractéristique définissant trois grands ensembles : un ensemble mer à 35 %o, un milieu intermédiaire à salinité variable et un ensemble amont à 90 ou 100 %o (Bousso, 2000).
Le climat
Le climat du Saloum, de type soudanien, est caractérisé par deux saisons nettement tranchées, une saison sèche qui dure sept (7) mois (de novembre à mai) et une saison des pluies longue de cinq (5) mois (CCLME, 2014). La pluviométrie moyenne annuelle de 1951 à 1980 sur le bassin est comprise entre 880 mm au sud et 480 au nord. Sur l’ensemble du bassin, la moyenne générale était de 828 mm dans les années 50. Elle est tombée autour de 500 mm dans les années 80-90 (CCLME, 2014).
Actuellement, la saison des pluies ne dure que de Juillet à Octobre avec une pluviométrie de moins de 400-600 mm (DPN, 2014). Le maximum des précipitations est noté au mois d’août. Les températures moyennes annuelles varient entre 26 et 31° C. La zone est soumise à trois types de vents :
– l’alizé maritime vent relativement frais balaie la côte avec une direction N-NW. Son pouvoir hygrométrique est très faible ;
– l’alizé continental ou Harmattan est un vent de direction N – E chaud et sec qui souffle en saison sèche. Son long parcours continental explique sa charge poussiéreuse et son pouvoir hygrométrique quasi nul ;
– la mousson après avoir effectué un long parcours océanique, arrive sur le continent avec une humidité élevée de l’air qui apporte la pluie (Diop et al, 2011).
Activités socio-économiques
L’économie de la zone repose essentiellement sur des activités liées aux ressources naturelles. Il s’agit de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de la cueillette des produits forestiers, du tourisme et de l’exploitation des coquillages.
Agriculture
L’agriculture occupe une très grande partie de la population totale. Le mil occupe la première place du point de vue des superficies cultivées ; pour les autres céréales, les superficies sont relativement plus faibles. La culture du riz dans les bas-fonds et le développement de maraîchage dans les vallées en saison sèche. La culture de l’arachide connait depuis peu des difficultés par rapport à la baisse de la pluviométrie, à la mauvaise organisation de la commercialisation et à la déprédation par les animaux telques les singes et les phacochères. Cependant, l’agriculture qui présente un grand potentiel est également confrontée en de nombreuses zones à une salinisation des terres et d’érosion des sols.