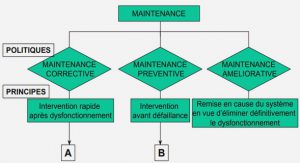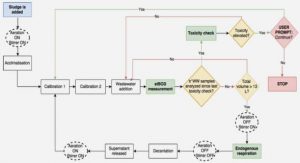Document 1 Mort pour avoir dit non
Jean-Marc, lycéen de 17 ans, a refusé d’être la victime d’un racket. Un coup de pied l’a tué. A Saint-Priest, des jeunes et des adultes disent leur dégoût de la violence ordinaire. Recouvert de bouquets de fleurs, le banc public ressemble à un cercueil. Il y a quelques jours, la tête de Jean-Marc a violemment heurté ce bloc de béton coffré de bois. Le garçon n’avait guère de chances de s’en sortir. Il ne s’en est pas sorti. Il est mort après trois jours de coma. Il avait 17 ans, il était lycéen, pratiquait le judo. Il n’a pas voulu se laisser racketter. Un coup de pied au visage l’a projeté en arrière. Son agresseur avait le même âge, mesurait plus de 2 mètres et fréquentait, plus ou moins, un institut médico-professionnel. Quand on l’a interpellé, le grand n’a presque rien dit aux éducateurs, encore moins à son avocat. Au juge, il a expliqué : « Il avait insulté ma mère » C’était faux, ses complices l’ont avoué. Jean-Marc avait seulement dit non, ce dimanche 30 novembre à la sortie du métro, lorsque trois jeunes des Minguettes ont exigé son argent et sa chaîne. Dès l’annonce de sa mort, jeudi dernier, le lycée Condorcet à Saint-Priest s’est figé. Les élèves de la terminale dans laquelle Jean-Marc préparait un bac de génie industriel se sont regroupés, incapables de travailler. Au troisième étage, une prof de philo a ouvert sa classe. Très vite des photos, des cierges et des textes se sont accumulés. Surtout des textes. Comme un besoin de dire le dégoût d’une violence quotidienne, de ne plus cacher sa peur. La mort de Jean-Marc a levé le non-dit. C’est David qui confie : « Le bus ou le métro, on ne peut jamais les prendre seuls. Trois fois je me suis battu, on voulait me prendre mon blouson. » C’est Stéphane et Abdel qui poursuivent : « Et encore le lycée, c’est calme, il n’y a pas trop de violence. Mais il faut voir les bagarres à l’extérieur avec quelques jeunes des cités d’à côté. » Ce sont aussi les professeurs qui leur rappellent que la violence est latente, que le lycée n’est pas épargné : « L’an dernier, lorsque la prof de français s’est fait agresser dans sa classe par quelqu’un de l’extérieur, vous saviez qui c’était. Personne n’a voulu parler. » Et le proviseur, Florent Sibue, de corriger : « Or il y a eu un élève qui a dit tout haut que tout le monde savait d’où venait l’agression. Il a été le seul : c’était Jean-Marc. »Florent Sibue est un proviseur qui fait l’unanimité tant chez les professeurs que parmi les élèves. Son lycée est même devenu zone pilote pour la formation des enseignants. Il ne cache pas sa colère : « Le problème, c’est le sentiment d’impunité des jeunes qui exercent une toute-puissance chez eux, où tout se dérègle, puis au collège et enfin au lycée, où personne n’ose plus les affronter. Il faut leur rappeler qu’il y a des limites, qu’une ligne jaune ou un feu rouge sont faits pour ne pas être franchis. » Il s’emporte : « J’en veux aux habitants des beaux quartiers qui viennent, dégoulinants de générosité, nous dire comment il faut faire de la prévention, puis retournent tranquillement chez eux. Moi j’habite sur place et je vois l’incompréhension et la colère des victimes quand elles croisent dans la rue ceux qui les ont agressés la veille. »Pas plus que Florent Sibue, René Prager n’est un partisan du tout-répressif. Professeur d’allemand et secrétaire du snes du lycée Condorcet, il reconnaît que, dans l’évolution de la crise sociale génératrice de la violence, les discours généreux n’apportent plus de bonnes réponses : « Aujourd’hui plus personne n’est en mesure de défendre les lycées ouverts comme celui-ci sur l’extérieur. Et plus personne ne peut hurler quand on évoque la possibilité d’installer des caméras de surveillance. Les réponses de fond, telles qu’on les a données jusqu’à présent, ne peuvent convaincre un prof ou un élève de ne plus avoir peur. On répond donc sécurité, en essayant d’éviter la glissade vers le sécuritaire. »Ce qui a encore plus exacerbé les passions à Saint-Priest et à Vénissieux, c’est que le racketteur était connu des services de police. Des violences et des rackets, il en avait déjà commis. Mais, mineur, il n’avait pas été mis en détention ni éloigné des Minguettes, où il sévissait. Ce qui fait dire à Stéphane Noël, juge d’instruction à Lyon : « Il faut en finir avec l’angélisme des ordonnances de 1945 sur la délinquance des mineurs. En cinquante ans, les enfants ont changé, pas les lois. »
Les miraculés de la « classe poubelle »
L’école n’en voulait plus, un prof les a récupérés. Il leur a appris à apprendre, à comprendre, à s’exprimer et à passer le bac ! Comme tous les philosophes, les romanciers et les scientifiques qui les ont rencontrés, Anne Fohr en est revenue stupéfaite. Elle raconte. C’est mercredi soir, la nuit est tombée et le collège est désert depuis longtemps. La concierge vient montrer le bout de son nez à la porte de la seule classe encore éclairée. Il reste une dizaine de fidèles, groupés autour de Jean-Luc, leur professeur. Il fait bon ici. La salle de classe appartient à un ensemble de trois petites pièces en enfilade, perdues au fond du deuxième étage du bâtiment. Quand les cinquante élèves sont présents, c’est bourré. Mais c’est chez eux. Ils ont récupéré deux vieilles bibliothèques et affiché aux murs photos et affiches : le tournage de leur film à Marrakech, la visite de Philippe Douste-Blazy alors ministre de la Culture, la couverture du prochain livre qu’ils vont éditer. Quelle folle journée aujourd’hui ! Des solitaires ont bouquiné des heures durant : Jankélévitch, Pagnol, Sollers ou les Mémoires de Géronimo. A côté, d’autres faisaient des devoirs, seuls ou avec l’aide d’un aîné. Un groupe s’est volatilisé dans l’après-midi avec Ludwig – « notre réalisateur » – pour « dérusher » le film tourné à Dole avant Noël. C’est une fiction sur les histoires d’amour qui ne finissent pas mal. Le même Ludwig a aussi donné une leçon de romani à l’équipe qui partira tourner le film sur les Tsiganes en Roumanie. Mais il s’est quand même tenu des cours à peu près « normaux ». Un cours de sciences, très technique. Un autre de littérature, très savant, pour les cinq terminales littéraires. Avec Chrétien de Troyes, a expliqué le prof, on était « dans le hors-temps, dans un récit biblique à l’envers ». Lancelot entrait « dans la logique du conte » et la fée, c’était « l’adjuvant dont parle Roland Barthes ». Les ouailles ont tenu le coup, et l’un d’eux a conclu qu’ils avaient « le nœud de l’histoire dès le premier mot » et qu’il fallait « dégager ce qui est lié à l’époque ». Une petite élève de seconde, restée dans la classe pour faire son travail, a tout écouté et a fini par demander si Bettelheim n’avait pas expliqué tout ça dans sa Psychanalyse des contes de fées !Enfin, il y a une heure de philo pour les cinquante élèves réunis : il paraît que la philo, on en fait beaucoup ici. « Quand on a une discussion foireuse, raconte Azad, Jean-Luc nous dit : « Allez, philo pour tout le monde ! » Une fois, ça a duré l’après-midi et on a poursuivi au troquet. Jean-Luc, il nous fait aussi le français, l’histoire, la géographie, l’anglais et l’espagnol, mais c’est la philo qu’il préfère. Ce qui est bien avec lui, c’est qu’il se promène parmi les matières, il les relie entre elles. Au début, c’est difficile, on a déjà du mal à cerner une idée, mais on finit par y voir un peu plus clair. »Sommes-nous dans une classe expérimentale ? Dans une école privée pour enfants précoces ? Pas du tout. Nous sommes à Reims, dans une classe d’exclus, de retardataires, de fâchés avec l’école. Cette classe est logée au collège Robert-Schuman, et pilotée par un professeur certifié en lettres. Jean-Luc Muracciole a 44 ans, et seize ans de métier derrière lui. Le nom de la classe : un cippa, soit « cycle d’insertion professionnelle par alternance ».Le sigle est triste, la réalité souvent encore plus. Les cippa vivent le plus souvent cachés. Ils font partie de ces dispositifs que le système éducatif a mis en place pour récupérer les élèves de plus de 16 ans dès qu’il les a mis dehors. Une classe cippa, on la planque le plus souvent dans un bout de collège ou de lycée professionnel, avec parfois un grillage de séparation et une porte de sortie discrète. Les élèves ne font qu’y passer : neuf mois au plus. Ils ont un prof-animateur qui leur donne des cours de remise à niveau en français et en maths, et leur recherche des stages, quand il y en a. En attendant une éventuelle réinsertion dans le cycle scolaire ou en contrat de qualification. « Une classe-poubelle », balancent les jeunes du dehors et du dedans…