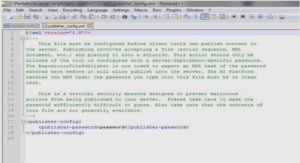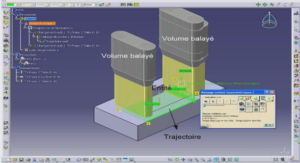Madagascar est réputée par sa grande richesse en diversité biologique, aussi bien en faune qu’en flore. Toutefois, depuis plusieurs décennies, on assiste à une dégradation massive de cette biodiversité, dégradation massive liée à une exploitation abusive des ressources naturelles existant dans les massifs forestiers. Cela traduit un problème au niveau de la gestion des ressources naturelles.
Relief et topographie
Le relief est très accidenté. Il est constitué d’une multitude de basses collines présentant des croupes plus ou moins convexes, d’altitudes sub-égales, aux pentes longitudinales faibles mais latérales plus marquées. Quant aux parties sommitales, elles peuvent être aplanies ou réduites. Les zones constituant les bas-fonds sont plus ou moins drainées et étroites (RANDRIAMBOAHANGINJATOVO, 2001). Les pentes sont abruptes et peuvent atteindre 80%. Par ailleurs, la forêt d’Ambohilero est caractérisée par un gradient altitudinal allant du niveau de la mer à plus de 1000 mètres d’altitude (TERRIER. 1998).
Hydrographie
Le fleuve Ivondro est le plus important réseau hydrographique arrosant la forêt d’Ambohilero. Ce fleuve prend source dans la plaine marécageuse de Didy, à l’ouest d’Ambohilero, suit un trajet sinueux jusqu’au sud du Toamasina en passant à travers la forêt. Ses nombreux affluents qui prennent source à l’intérieur de la forêt, sont: Sahamanohy, Sahavolo. Saratonga, Tolongoina, Sahavilarina, Sahanavy… Le fleuve Onibe coule juste à la limite nord de la forêt du côté de Manakambahiny Est. Par ailleurs, on note la présence d’un réseau hydrographique temporaire constitué par des ruisseaux se déversant dans les rivières plus importantes ou dans les fleuves qui se tarissent en saison sèche.
Géologie et sol
La forêt d’Ambohilero possède une roche mère composée de migmatites avec localement des migmatites granitoïdes. Les sols sous forêt sont du type granito-gneissique : ce qui leur confère une propriété riche en quartz, pauvre en fer et plus riche en aluminium (RANDRIAMBOAHANGIJATOVO, 2001).
TERRIER (1998) fait ressortir au cours de ses travaux les résultats suivants en fonction de la classe topographique.
– Bas-fonds : sol hydromorphe minéral ou peu humifère reposant sur d’anciens sols hydromorphes à pseudogley, chimiquement riche mais trop engorgé pour les arbres.
– Sommet obtus : sol ferralitique fortement désaturé rajeuni. Très profond mais physiologiquement moyennement profond, caractérisé par la présence de sable. Très pauvre chimiquement notamment en calcium et en phosphore assimilable, et très acide.
– Sommets aigus : sol ferralitique brune jaune/rouge Très profond mais physiologiquement peu profond : dominance argileuse. Très pauvre et très acide.
– Versants convexes : sol ferralitique brun jaune faiblement désaturé, remanié. Egalement très profond mais physiologiquement peu profond (Compacité structurale dès les premiers horizons due à la présence d’argile). Pauvre chimiquement et acide.
– Versants concaves : sol ferralitique brun jaune/rouge humifère modal. Très profond à dominance sableuse, très riche chimiquement. Texture et structure permettent url très bon enracinement ; le mélange sable-argile permet une bonne réserve hydrique.
Ainsi, les versants concaves présentent les meilleurs sols, suivis des sols de bas-fonds qui sont minéralement riches mais où l’on connait un problème d’engorgement d’eau. Quant aux sols de sommets obtus, ils sont pauvres chimiquement, mais compensés par leur caractère sableux. Permettant aux arbres de s’enraciner assez profondément. Enfin viennent les sols de sommets aigus et de versants convexes, pauvres et superficiels, dont la qualité est encore aggravée chez les seconds du fait des pentes souvent importantes rendant le milieu très instable.
Facteurs biologiques
Type de végétation
La formation climacique d’Ambohilero correspond à une forêt dense humide sempervirente de l’est. Selon RANDRIAMBOAHANGIJATOVO (2001), la répartition dans l’espace (horizontale) des espèces de flores est relative aux différentes stations écologiques, caractérisées par la qualité du sol, la topographie l’exposition et le bilan hvdrique. Sur le sol pauvre chimiquement ne favorisant pas leur croissance- les arbres présentent des diamètres faibles. Certains chutent avant d’avoir atteint un diamètre important. L’espèce qui y domine est le Uapaca sp. (Voapaka). Sur le sol présentant une pente forte, donc bilan hydrique faible, sol moins profond, très lessivé, la densité des arbres est faible. L’espèce dominante est le Uapaca sp. (Voapaka) un exemple type de l’espèce dominante en milieu difficile. Sur un sol qui présente moins de contraintes (pentes pas très forte, bilan hydrique favorable), la station est plus riche en espèces et est surtout dominée surtout par Campylospermum deltoïdeum (Malambovony) qui est essence très compétitive en bonne station. On note également la présence de Cyathea sp (fanjana), Eugenia sp. (Rotra), Chrysomalum boivinianum (Famelona). Les beaux sujets de Palissandre se rencontrent aussi sur ces types de sol.
Sur les marécages forestiers, aucune strate arborée n’est présente car la germination des arbres y est gênée. Toutefois, la Forêt renferme une multitude d’espèces floristiques notamment en ligneux assez bien réparties dans son ensemble lui conférant une hétérogénéité très remarquable. Quant à la répartition au niveau des strates (verticale), la strate supérieure est surtout dominée par les familles des Rubiacées. Arabiacées, Euphorbiacées. Myrticacées. Tandis que la strate inférieure constituant le sous-bois, elle est dominée par des palmiers nains, des fougères, des graminées sciaphiles à tiges rampantes.
Faune
Il n’y pas eu jusqu’à maintenant d’étude faunistique réalisée à l’intérieur de la forêt d’Ambohilero. Toutefois, selon toujours RANDRIAMBOAHANGIJATOVO (2001), on pourrait tirer les quelques constats suivants en ce qui concerne les endroits fréquentés par certains animaux :
– les sangliers (Potamocherus larvatus) préferent les bas de pente et les basfonds ou ils peuvent trouver facilement leur nourriture (vers de terre…) et où ils sont proches des points d’eau :
– les « Soimanga »» (Nectarinia souimanga) fréquentent les Prunus africana ou «kotofihv » (peut-être pour leur fruit?) ;
– les lémuriens dont Varecia variegata ou Propithecus diadema préfèrent délimiter leur territoire là où la forêt présente le plus de mosaïques de formations végétales.
Facteur humain
Population et ethnie
Le principal groupe ethnique résidant dans la forêt d’Ambohilero est le Sihanaka regroupant près de 95% de la population. Le reste est constitué par des Merina- des Betsileo, des Betsimisaraka et des Antesaka (CHARBONNIER. 1998). Néanmoins, l’effectif total des habitants de la forêt, ainsi que la répartition de la population par âge et par sexe est difficile à estimer étant donné l’éparpillement de la population dans le massif ainsi que l’enclavement de certaines zones démotivant la population locale à déclarer les éventuelles naissances ou décès- et l’administration elle-même à des travaux de recensement.
Activités économiques
La population vivant dans la forêt d’Ambohilero peut se distinguer en résidents temporaires ou en résidents permanents. Les activités économiques varient selon cette distinction.
Pour les résidents temporaires, ce sont surtout :
– des bûcherons qui ont comme activité principale les travaux de coupe. Ils travaillent pour le compte d’exploitants forestiers.
– les exploitants miniers et leurs ouvriers vivant de l’exploitation minière de quartz rose surtout.
– les autochtones ou les propriétaires de kijana résidant à Didy – Ambohijanahary qui ont soit l’agriculture, soit le fonctionnariat, soit le commerce comme principale source de revenu. En général, les bovins fréquentant les kijana forestiers appartiennent aux individus de ce groupe.
Concernant la population qui vit en permanence dans la forêt, ce sont :
– des Sihanaka issus d’un lignage possédant un kijana. L’agriculture sur tavy et l’élevage de volailles semi-intensif constituent leur activité génératrice de revenu.
– des Betsimisaraka dont les ancêtres se sont installés dans la forêt, ils pratiquent également la culture sur tavy.
Utilisation de la forêt
La forêt d’Ambohilero est perçue par la population locale comme une terre ancestrale. La surface forestière est répartie en kijana. Le kijana se définit à l’origine comme des espaces naturels qui servent de lieu de pâturage au cheptel bovin, et par extension. Ce sont des espaces utilisés par des individus de même lignage pour se procurer des produits forestiers. Ainsi, le kijana forestier représente en quelque sorte un symbole de la richesse du lignage. Jusqu’à ce jour, le kijana sert encore de lieu de parcours et de parcage de zébus pendant la période d’absence d’activités agricoles. On dénombre une cinquantaine de kijana dans le massif, occupant en moyenne une superficie de 2 000 ha.
La population, surtout les membres du lignage qui se sont installés à l’intérieur de ces kijana vivent avec un sentiment de sécurité du point de vue foncier, étant donné qu’ils sont les propriétaires légitimes de ces terres reconnus au niveau de l’administration. Ils pratiquent alors sur les sols forestiers la culture sur tavy d’autant plus qu’ils ne possèdent pas ou très peu de rizières dans la plaine de Didy. Les usagers de la forêt d’Ambohilero conçoivent également que le massif est une source intarissable de produits forestiers. Ils y prélèvent leurs bois de chauffe, le bois de construction et de service, mais également des produits non ligneux tels que le miel, les produits de la pêche et de la chasse, les plantes médicinales: des plantes à vocation artisanale (ex: Pandanus sp.). etc… Par ailleurs, des exploitants forestiers disposant d’un permis d’exploitation y font la collecte de bois d’œuvre.
INTRODUCTION |