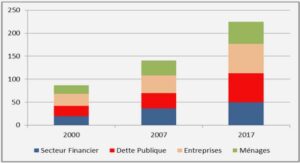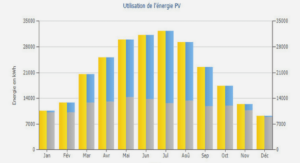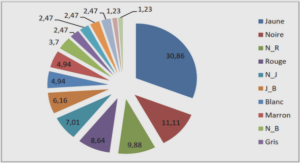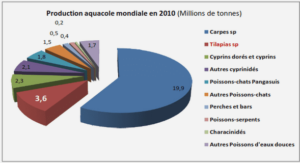Généralité sur le capital humain
La notion du capital humain a été vulgarisée vers les années soixante suite aux travaux des économistes américains entre autre Garry Becker, E. Denison, T. Schultz ou J. Mincer. Le concept du capital humain s’inscrit dans un contexte où son importance dans l’activité productive d’une économie demeure irréversible. Le capital humain est donc un facteur clef de la croissance économique avec des effets de diffusion importants. Le différentiel de salaire entre agent économique serait expliqué par le niveau d’étude ou le nombre d’années de formation ; en d’autres termes, le capital humain accroit le potentiel des individus en les rendant plus productifs d’où son importance et son rôle stratégique dans une économie donnée. D’après ces économistes, l’éducation tient une place importante dans l’accumulation du capital humain mais la question est la manière de maintenir le stock du capital humain à un niveau satisfaisant pour une économie donnée. C’est dans cette perspective que la santé trouve son importance majeure dans le processus de la croissance économique. Lorsqu’on fait une analogie sur le capital physique, l’accumulation du capital s’effectue dans le processus de la production et le stock du capital a subit de l’amortissement suite à des usures éventuelles du capital.
Etudes macroéconométriques appliqués à la santé
La majeure partie des travaux empiriques macroéconomiques s’inscrit dans le domaine de l’économie de développement, visant à estimer le poids déterminant des différentiels de croissance entre les pays à hauts revenus et les pays pauvres à partir de regression sur un échantillon plus ou mois large des pays. Ces travaux cherchent principalement à expliquer la correlation entre l’éspérance de vie et la croissance économique.
D’après le rapport de l’OMS sur la santé en 20015, une augmentation de 10% de l’ésperance de vie à la naissance contribue au moins à 0,3 point de croissance par an. Bien que la question de l’effet de la santé sur la productivité des individus ait été étudiée depuis le début des années 70, avec notamment le modèle précursseur de Grossman en 1972, cette question n’a été que peu abordée à un niveau macroéconomique pour les pays développés. Cette relation positive entre état de santé et productivité a été longtemps considérée principalement pour les pays en voie de développement (PVD), pour lesquels les enjeux de santé publique sont importants. Si pour les PVD, cette relation positive est largement admise, pour les pays développés la question reste posée. L’état de santé dans les pays développés a atteint un niveau relativement élevé et par conséquent, sous l’hypothèse de rendement marginaux décroissants de la santé, l’effet positif d’une amélioration de l’état de santé sur la croissance peut être considéré comme relativement faible. Cette analyse en termes de rendements marginaux décroissants confirme qu’il peut même exister un niveau d’état de santé général de la population au-delà duquel les bénéfices de son amélioration ne compensent pas les coûts de cette amélioration, on sera alors en présence de rendements marginaux négatifs.
Le rendement de la santé
Les investissements dans le domaine de santé est comme tout autres investissement, on peut l’évaluer en terme de rendement. L’approche du capital humain fournit une méthode permettant d’évaluer des gains individuels à la suite d’une amélioration de l’état de santé ou d’une augmentation de l’ésperance de vie par rapport à l’ésperance de vie à la naissance.
Evaluer un taux de rendement de la santé consiste à comparer les bénéfices et les coûts consécutifs à la santé. Il existe trois principaux concepts du taux de rendement de la santé. Ce sont le taux de rendement social, taux de rendement public et le taux de rendement privé.
Taux de rendement social : Le taux de rendement social est défini comme étant une référence aux institutions de décisions dès lors qu’il s’agit de déterminer s’il est rentable financièrement au niveau
social de favoriser l’accès de tous au système de soins. Ce taux est un ratio qui mesure les gains pour la société consécutifs à un investissement dans le domaine de santé. Cet indicateur compare les ressources engagées pour promouvoir la santé publique et le supplément de production générée à l’échelle de la collectivité.
Taux de rendement public : Le taux de rendement public mesure la rentabilité de la santé du point de vue du gouvernement. Il évalue dans quelles proportions les recettes fiscales dépassent les coûts supportés pour soutenir le secteur santé. Les gains pour l’Etat constituent la somme globale de l’impôt perçu sur le revenu supplémentaire des agents. Les coûts de la santé représentent pour l’Etat l’ensemble des montants engagés pour la santé à savoir : les subventions aux établissements sanitaires, les subventions accordés à des patients, etc.
Taux de rendement privé : Le taux de rendement privé évalue les gains potentiels de l’individu ou du particulier qui investit dans le secteur santé. Il indique s’il est souhaitable pour un agent de poursuivre un traitement donné plutôt que suivre une autre. Les gains sont évalués à partir du différentiel de l’état de santé après un traitement par rapport à l’état initial de santé. Ces gains en termes de santé sont les plus souvent évaluer en unité naturelle comme l’exemple du nombre de vie sauvé. Dans le cadre d’une analyse coût-bénéfice, les gains peuvent être évalués en unité monétaire. Les coûts cosidérés sont principalement des coûts du traitement de la maladie, la perte de productivité pour le patient ainsi que pour sa famille.
Le système de santé décentralisé
Le système de santé n’est pas mis à l’écart de cette réforme. Dans le domaine de la santé, une décentralisation, en donnant plus de poids à la logique démocratique permet d’accroître le rôle réel des citoyens dans la prise de décision et favoriser la participation de la population locale au financement de la santé en tenant compte leur pouvoir économique. Elle encourage les initiatives visant à organiser en fonction des ressources locales, les différents éléments du système de soins, en particulier les relations entre la médecine ambulatoire et la médecine hospitalière, les cliniques privées et les hôpitaux publics; prendre en compte les particularités locales (épidémiologiques, culturelles, économiques et sociales). La décentralisation permet aussi de favoriser la prise de conscience du rôle de l’environnement social sur la santé de la population et établir un système de sanctions et récompenses centré sur les résultats sanitaires obtenus au niveau local, plutôt que sur des normes centralisées de processus.
Mais, pour qu’un système local de soins puisse fonctionner de façon efficace, il faut qu’il y ait une cohérence entre quatre piliers: un financement global public, un pouvoir réglementaire partagé, une gestion décentralisée des systèmes locaux de santé et la pertinence d’information et de la surveillance.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : APPROCHE THEORIQUE: ANALYSE ECONOMIQUE DE LA SANTE
CHAPITRE 1: ETUDES MACROECONOMIQUE DE LA SANTE
1.1. Généralité sur le capital humain
1.2. Qu’est ce qu’un capital humain?
CHAPITRE 2: IMPACT DE LA SANTE SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE
2.1 Une croissance auto-entretenue: santé à la croissance ou croissance à la santé ?
2.2 Etudes macroéconométriques appliqués à la santé
CHAPITRE 3. ETUDES MICROECONOMIQUE DE LA SANTE
3.1 Le rendement de la santé
3.1.1 Taux de rendement social
3.1.2 Taux de rendement public
3.1.3 Taux de rendement privé
3.2 Evaluation économique
3.2.1. Les différents types d’analyse économique en santé
3.2.1.1 Etude de minimisation des coûts
3.2.1.2 Analyse coût-efficacité (cost-effectiveness)
3.2.1.3 Analyse Coût-Bénéfice (« cost benefit »)
3.2.1.4 Analyse coût-utilité
3.2.2. Les coûts considérés
3.2.2.1 Les coûts directs (CD)
3.2.2.2 Les coûts indirects (CI)
3.2.2.3 Les coûts intangibles (CIt)
DEUXIEME PARTIE: GÉNÉRALITÉS SUR LA DÉCENTRALISATION ET LE SYSTÈME DE SANTÉ
CHAPITRE 4. GENERALITE SUR LE SYSTEME DE SANTE
4.1. Santé
4.2. Soins de santé primaires
4.3. Divers types de systèmes de santé
4.3.1. Le modèle allemand
4.3.1.1. Développement d’une idiologie : le Bismarckisme
4.3.1.2. Evolution des concepts
4.3.2. Le Royaume-Uni
4.3.2.1. Les producteurs de soins
4.3.2.2. Les institutions du NHS
4.3.3. Le système français
4.3.3.1. Le secteur ambulatoire et la médecine libérale
4.3.3.2. L’hospitalisation publique et privée
4.3.3.3. L’industrie pharmaceutique
4.3.3.5. La protection sociale
CHAPITRE 5: LA DECENTRALISATION DU SYSTEME DE SANTE
5.1. Les différents types de la décentralisation
5.1.1 Les typologies de la décentralisation
5.1.2 Le système de santé décentralisé
5.1.2.1 Un financement global public
5.1.2.2 Un pouvoir réglementaire partagé
5.1.2.3 Une gestion décentralisée des systèmes locaux de santé
5.1.2.4 Information et surveillance
5.2. Systèmes de santé dans la région Afrique
5.2.1. Cadre de développement sanitaire
5.2.2. Conditions d’élaboration du cadre
5.2.3. Système de santé de district
5.2.3.1. Soins de santé primaires dans le paquet de santé
2.2.3.2. Un paquet minimum de santé pour tous pour les centres de santé
5.2.3.3. Les interventions liées à la santé
5.2.2.4. Rôle pivot du centre de santé
5.3. Système de santé à Madagascar
5.3.1. Etat actuel de la décentralisation de notre système de santé
5.3.1. 1. Le niveau central
5.3.1.2. Le niveau intermédiaire
5.3.1.3 Le niveau périphérique ou local
5.3.2. Le paquet minimum d’activités des formations sanitaires de base
5.3.2.1. Activités préventives
5.3.2.2. Activités curatives
5.3.2.3 Activités de maternité
5.3.2.4. Activités de laboratoire et d’imagerie
PARTIE III : ETUDE EMPIRIQUE SUR L’EFFICACITE DE LA DACENTRALISATION AU SEIN DU CSBII D’AMBOHIPO
CHAPITRE 6 : CADRE D’ETUDE
6.1. Le CSB2 d’Ambohipo
6.1.1. Organisation du CSB2
6.1.2. Situation du personnel
6.1.3. Activités
6.2. Le secteur sanitaire
6.2.1. La carte sanitaire
6.2.2. Démographie
CHAPITRE 7: METHODOLOGIE D’ETUDE
7.1. Type d’étude
7.2. Période d’étude
7.3. Population d’étude
7.3.1. Critères d’inclusion
7.3.2. Critères d’exclusion
7.4. Echantillonnage et taille de l’échantillon
7.5. Approche méthodologique
7.5.1. Hypothèse
7.5.2. Objectif général
7.5.3. Objectifs spécifiques
7.6. Recueil des données
7.7. Saisie et traitement
7.8. Limite et éthique
7.9. Paramètres d’étude
CHAPITRE 8 : RESULTATS D’ETUDE
8.1. Situation du personnel
8.2. Services du CSB2
8.3. Actes et prestations enregistrées
8.4. Evaluation des coûts
8.4.1. Coût du personnel
8.4.2. Coût des actes et prestations
8.4.3. Coût-avantage
8.4.4. Coût des journées de travail chômées
8.5. Analyse coût-avantage
8.6. Analyse coût-efficacité
CHAPITRE 9 : COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
9.1. Commentaires
9.1.1. Méthodologie
9.1.2. Nos résultats
9.1.2.1. Coût du personnel
9.1.2.2. Coût de prise en charge des patients
9.1.2.2.1. Au niveau du CSB2 avec les nouveaux services de laboratoire et d’échographie
9.1.2.2.2. Au niveau du CSB2 sans les nouveaux services et tenant compte des frais d’orientation recours
9.1.2.3. Coût-efficacité
9.2. Suggestions
9.2.1. Renforcement du personnel
9.2.1.1. Objectif
9.2.1.2. Stratégies
9.2.2. Implantation d’un service décentralisé qui est le service de radiologie
9.2.2.1. Objectif
9.2.2.2. Stratégies
CONCLUSION