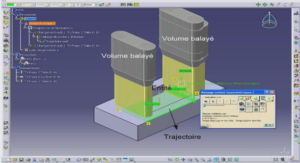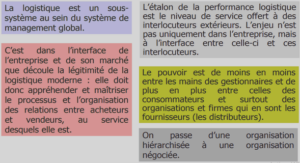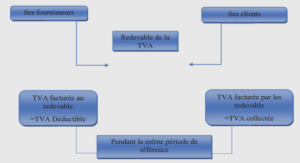Etudier la peinture domestique en Italie de la fin du Ier à la fin du IIIes
Un manque historiographique
La définition chronologique et géographique d’un tel sujet est en premier lieu motivée par l’histoire de la discipline. En effet, l’étude de la peinture murale antique a longtemps été dominée par les recherches sur les cités du Vésuve, c’est-à-dire sur une période s’arrêtant en 79 ap. J.-C. La situation est particulièrement sensible en Italie, où la quantité et la qualité des vestiges campaniens ont eu tendance à oblitérer la documentation plus fragmentaire des périodes postérieures, significativement appelées « post-pompéiennes ». Des études portant spécifiquement sur les IIe et IIIe s. (en incluant parfois la fin du I er s.) ont tout de même été tentées, dès le début du XXe s., mais elles ont longtemps souffert d’un manque de matériel. Par ailleurs, l’inégale conservation des vestiges a porté à concentrer la réflexion sur quelques sites privilégiés comme Ostie et Rome, réduisant de fait l’histoire de la peinture murale en Italie à ces régions centrales.
La peinture murale en Italie de la fin du Ier à la fin du IIIe s. : une histoire partielle
Le premier à risquer une analyse globale de la décoration murale des IIe et IIIe s. est H. Krieger qui, en 1919, tente de prolonger la classification établie par A. Mau pour Pompéi3 . Il propose ainsi d’utiliser la notion de « cinquième style » pour les peintures de la période d’Hadrien et des Antonins et celle de « sixième style » pour les peintures de la période sévérienne. Cette étude pose un premier problème : l’auteur tente d’y définir des styles à partir d’un nombre très restreint de documents, puisqu’il se concentre essentiellement sur les peintures de la domus sous la Villa Negroni, de la Villa d’Hadrien et du tombeau des Nasonii, en mentionnant au passage quelques peintures d’Ostie, celles d’une maison privée retrouvée sur la Via dei Cerchi ou encore celles de la Catacombe de Domitilla – ce qui fait dire à H. Joyce que les analyses de H. Krieger ne sont que des extrapolations à partir de peintures 3 Krieger 1918-19. Etudier la peinture domestique en Italie de la fin du Ier à la fin du IIIe s. 12 bien connues4 . Mais surtout, la terminologie utilisée par l’auteur (cinquième et sixième styles) suscite de sérieuses difficultés méthodologiques : comment prolonger un système de classification établi, sur une période donnée, à partir d’une documentation homogène et restreinte, à une documentation très éparpillée, aussi bien dans l’espace que dans le temps ? De telles réserves expliquent sans doute le peu de succès qu’a rencontré cette première tentative, M.H. Swindler étant le seul à avoir repris ces analyses, dans un ouvrage général publié en 19295 . Cependant, plutôt que de parler de « cinquième et sixième styles », sa démarche consiste plutôt à retrouver dans les exemples qu’il étudie les influences des différents styles identifiés par Mau. Ce premier excursus bibliographique montre donc d’emblée les obstacles qu’a pu connaître l’étude de la peinture dite « post-pompéienne » dont la lecture a précisément été parasitée par l’influence du modèle pompéien. La première véritable histoire de la production picturale des IIe et IIIe s. est due à F. Wirth, dans un ouvrage de 1934, qui, pour la première fois, prend en compte un grand nombre de documents jusque là non publiés : Die Römische Wandmalerei vom Untergang Pompejis bis ans Ende des dritten Jahrhunderts6 . L’auteur définit un certain nombre de périodes stylistiques sur la base de monuments pour lesquels il possède des critères de datation fiables, comme les monnaies, les portraits ou les reliefs historiques. La première est appelée le « style flavien » – et il convient ici de souligner le fait que F. Wirth, en véritable précurseur, envisage la peinture du IIe s. directement dans la continuité de la peinture pompéienne, puisqu’il fait commencer le style flavien avec le Quatrième Style Pompéien. Pour cette première période stylistique, son corpus est essentiellement constitué de la Domus Aurea et des peintures pompéiennes mais y sont intégrés quelques documents datés d’après 79 comme la Villa de Domitien à Castel Gandolfo. Au « style flavien », succède le « style philhellène », de 100 à 160 ap. J.-C. Le choix de l’adjectif philhellène est justifié par le classicisme qui, selon l’auteur, caractérise cette période, en peinture comme dans de nombreux autres domaines. Il s’agit essentiellement, on l’aura compris, de la période du règne d’Hadrien et la Villa de l’empereur à Tivoli constitue d’ailleurs une des principales sources de documentation. De 160 à 217, F. Wirth distingue ensuite le « style antonin », qui se caractérise par une tendance croissante au mouvement et au « baroque » (par opposition au classicisme) : une recherche d’asymétrie, un manque de régularité, des simplifications, impressions d’esquisse…. A cette période, selon F. Wirth, on tend à défaire le lien organique qui existait entre l’architecture et les surfaces, pour aboutir à des constructions de plus en plus abstraites. Cependant, l’auteur insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un appauvrissement dû au développement des mystères et du christianisme, ni d’un art décadent, mais d’une recherche de formes nouvelles. Selon lui cette décoration, qui n’a plus aucun rapport avec les objets réels et qui devient purement décorative, s’approche de l’idée d’art absolu. Au « style antonin » succède le « style illusionniste » qui constitue, toujours selon F. Wirth, un pas supplémentaire pour s’éloigner du classicisme. Toute l’ornementation qui s’était formée depuis plusieurs siècles serait jetée par-dessus bord : les éléments architectoniques, qui formaient jusque-là la base de la décoration murale, sont mêlés en un jeu étrange de lignes et l’on supprime les derniers restes d’une armature solide en mêlant la décoration du mur et du plafond et en ne respectant plus la traditionnelle division du mur en trois parties. Nous reconnaîtrons dans cette description le style linéaire, qui constitue pour l’auteur « la création la plus indépendante et la plus originale de l’art romain ». Le IIIe s. se termine enfin avec les styles dits « de Gallien » (260-270) et « du début de l’antiquité tardive » (270 et après) pour lesquels l’auteur est beaucoup plus rapide car la documentation devient de plus en plus clairsemée. F. Wirth reconnaît globalement les mêmes tendances que celles qui caractérisaient la période précédente, avec cependant un certain recul vers des formes plus classiques. Pour ces deux styles, les exemples sont issus essentiellement de l’architecture funéraire.
Ostie
bastion avancé de la recherche sur la peinture des IIe et IIIe s. La ville antique d’Ostie a connu un important développement urbain et a été largement reconstruite à la fin du Ier et au début du IIe s. ap. J.-C., de sorte qu’elle prend de façon inespérée le relai des cités du Vésuve. De plus, son exceptionnel état de conservation – comparée à une ville comme Rome qui a connu une occupation urbaine continue –, en fait un 20 témoin incontournable de la production picturale de cette époque. Les chercheurs ont depuis longtemps mesuré l’importance de ce site qui est très tôt devenu un lieu d’étude privilégié. G. Calza, figure majeure des études ostiennes, fut l’un des premiers à faire sortir de terre et publier le décor des insulae. Avant lui, en 1913, F. Fornari avait réalisé une première étude mais peu d’édifices étaient alors connus19. En 1917 donc, G. Calza publie un article sur l’Insula di Diana20 , dans lequel il consacre quelques pages à la description des peintures retrouvées au rez-de-chaussée et aux étages ; article suivi, quelques années après, par la présentation des résultats des fouilles qui, entre 1915 et 1918, portèrent sur un groupe d’habitations situé dans le centre de la ville, « entre la Casa di Diana et le Temple de Vulcain ». Il s’agit essentiellement de l’Isolato dei Dinpinti, au sein duquel G. Calza concentre son attention sur l’Insula di Bacco Fanciullo et l’Insula di Giove e Ganimede. Après avoir décrit la topographie de la fouille, puis les bâtiments un à un et, enfin, chacune des maisons, il se livre à une étude détaillée des peintures, nous livrant ainsi un travail complet et minutieux qui demeure très utile. Vingt ans plus tard, le même G. Calza publie les peintures de l’Isola Sacra21, dont les tombes forment un ensemble continu depuis la période d’Hadrien jusqu’au milieu du IIIe s. En 1941, G. M. A. Hanfmann, à l’occasion d’un compte-rendu de cet ouvrage, examine le développement de la peinture murale à Ostie à travers les peintures des tombes de l’Isola Sacra22 . Au cours de la décennie successive, les études ostiennes font un important pas en en avant grâce à la publication des premiers volumes du vaste projet Scavi di Ostia, initié par G. Calza. Outre le premier volume consacré à l’analyse générale de la topographie de la cité et de son évolution23, sortent, en 1954, le volume de G. Becatti sur les mithrea et, en 1958, celui de M. Floriani Squarciapino sur les nécropoles, monographies qui incluent toutes deux la description des décors peints.