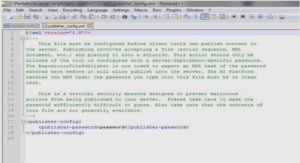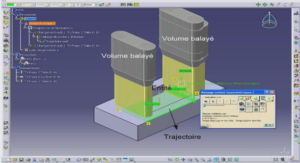Depuis une vingtaine d’années, le Centre National d’Etudes Spatiales (C.N.E.S.) et la Société Nationale d’Etude et de Construction des Moteurs d’Avion (S.N.E.C.M.A.), deux acteurs incontournables de l’activité spatiale française et européenne, portent une attention particulière au fonctionnement des pompes lors de démarrages rapides. L’étude de tels fonctionnements a été confiée à l’équipe E.N.S.A.M. du Laboratoire de Mécanique de Lille (L.M.L). Ce dernier a acquis une expérience reconnue en la matière avec notamment la réalisation de trois thèses successives, Ghelici [11], Picavet [15], Bolpaire [1] ainsi que du post-doctorat de Dazin [5, 6]. Ce mémoire de doctorat s’inscrit pleinement dans la continuité de ces travaux. L’aspect novateur de cette nouvelle étude réside dans la prise en compte supplémentaire du phénomène de cavitation, qui peut se produire sous certaines conditions lors de la phase transitoire d’un démarrage rapide. Ce phénomène nuit aux performances hydrauliques (et structurales) de la pompe en provoquant des fluctuations de débits et de pressions pouvant aboutir à son désamorçage. L’objectif général consiste à caractériser le phénomène afin de mieux en contrôler les effets .
Les démarrages rapides de turbopompes constituent une problématique principalement rencontrée dans le secteur spatial. Le moteur Vulcain par exemple, qui assure la propulsion de l’étage principal d’Ariane 5, est composé d’une turbopompe hydrogène (TP LH2) et d’une turbopompe oxygène (TP LOX) qui alimentent la chambre de combustion en ergols liquides. Les turbopompes sont entraînées par une turbine alimentée par des gaz de combustion créés dans un générateur de gaz, alimenté en ergols par prélèvement en sortie des pompes (cycle à flux dérivé) .
Lors du démarrage des turbopompes, le temps nécessaire pour que celles-ci atteignent leur vitesse finale de rotation (13000 tr/min pour la TP LOX et 33000 tr/min pour la TP LH2) est inférieur à deux secondes. Le caractère fortement transitoire de ce phénomène fait que les turbopompes fonctionnent éloigné de leur domaine stabilisé. Or l’allumage de la chambre de combustion intervenant durant cette phase, il est important de prédire avec précision le comportement instationnaire des pressions, des débits et des vitesses de rotation.
Avant 1990 ([19], [20]), le fonctionnement instantané hors cavitation des turbomachines était analysé à partir des caractéristiques quasi-stationnaires, ce qui est approprié pour des transitoires « lents » mais pas pour des transitoires «rapides». La première collaboration entre le CNES et le LML sur les démarrages rapides de pompes a permis d’écrire l’expression de la hauteur totale de la pompe durant un transitoire rapide en intégrant à la fois l’accélération angulaire du rotor et l’inertie du fluide (Ghélici [11]). Cette expression, basée sur l’équation de la dynamique écrite pour une particule fluide située sur une ligne de courant entre l’entrée et la sortie de la roue, constitue le premier modèle des démarrages rapides de pompes hors cavitation. Les travaux sur le banc DERAP (DEmarrages RAPides) mis en place au LML ont aussi permis la caractérisation expérimentale de l’influence de paramètres tels que la vitesse de rotation finale, l’accélération angulaire, le débit final et la longueur du circuit durant des séquences de démarrages rapides de pompes centrifuges. Un retard temporel de la montée du débit comparée à la montée en vitesse est ainsi constaté et attribué à l’inertie du fluide dans les conduites.
Dans les travaux suivants menés au LML sur les démarrages rapides hors cavitation, Picavet [15] et Bolpaire [1] ont cherché à mieux connaître l’écoulement à l’intérieur de la machine dans le cas d’un démarrage rapide. Ils ont en particulier mené des expériences pour caractériser le phénomène de recirculation. Ce phénomène, qui apparaît pour les pompes centrifuges fonctionnant à débit partiel, voit l’écoulement dans la conduite d’aspiration prendre à sa périphérie une composante axiale négative. Il est souvent accompagné de prérotation (apparition d’une composante tangentielle de vitesse en périphérie de la conduite d’aspiration). Picavet [15] et Bolpaire [1] se sont tous deux intéressés à ce phénomène en régime stationnaire et en régime transitoire. En régime stationnaire, la technique du fil de laine utilisée par Picavet [15], ainsi que des observations de microbulles ou des mesures de capteurs de pression statique en paroi utilisés par Bolpaire [1] ont montré que la recirculation apparaît pour des débits de l’ordre de 0,7 Qd et que l’étendue axiale de ce phénomène pouvait atteindre 5 fois le diamètre de la conduite pour les très bas débits (0,1 Qd). Dans le cas d’un démarrage rapide, une zone de recirculation apparaît quel que soit le débit final atteint. Ceci s’explique par le fait que la pompe passe par des points de fonctionnement à faible coefficient de débit pour lesquels l’écoulement est désadapté. Toutefois, cette zone reste d’extension très limitée par rapport au cas stationnaire. Il est probable que la courte durée du transitoire ne permet pas à ce phénomène de s’installer.
En 2005, Dazin [5] propose un modèle fonctionnel permettant de prédire l’évolution de la hauteur totale de la pompe ainsi que le couple interne au cours d’un démarrage rapide. Ce modèle, basé sur les équations de quantité de mouvement et d’énergie appliquées à une turbomachine, présente l’avantage d’être général car il permet potentiellement de prendre en compte la nature compressible ou incompressible du fluide ainsi que la géométrie de la pompe. La hauteur totale expérimentale de la pompe au cours d’un démarrage rapide hors cavitation est ainsi correctement modélisée avec un écart relatif inférieur à 5%. Ce modèle n’a pas été testé dans le cas d’un démarrage rapide en cavitation car il nécessite de caractériser préalablement le comportement de la roue en régime cavitant, ce qui n’a encore jamais été fait.
INTRODUCTION GENERALE |