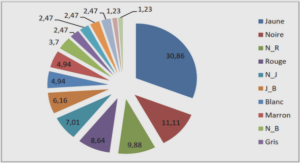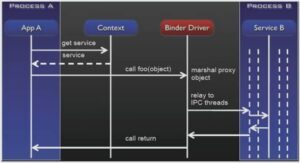Étude de la turbulence inhomogène au voisinage d’un vortex intense
Atteindre l’origine : démêler le jugement de la sensation
[Locke] était si loin d’embrasser dans toute son étendue le système de l’homme, que, sans Molyneux, peut-être n’eût-il jamais eu occasion de remarquer qu’il se mêle des jugements aux sensations de la vue. Condillac1 […] comment retrouverons-nous la première trace de nos pensées ? N’y a-t-il pas même de la témérité à vouloir remonter jusque-là ? Si la chose était moins importante, on aurait raison de nous blâmer ; mais elle est peut-être, plus que tout autre, digne de nous occuper : et ne sait-on pas qu’on doit faire des efforts toutes les fois qu’on veut atteindre à quelque grand objet ? Buffon2 Le Traité des sensations est le seul ouvrage où l’on ait dépouillé l’homme de toutes ses habitudes. Condillac3 Que la distinction du rationalisme et de l’empirisme ne partage pas les réponses au problème de Molyneux en positives d’un côté et négatives de l’autre ne signifie pas qu’elle n’en constitue pas le cœur et, par là même, ce qui permet d’en appréhender l’unité à travers ses différents enjeux. Bien qu’elle passe à l’intérieur même d’un tel partage des résolutions du problème, en cela que certaines d’entre elles sont positives tout en étant résolument empiristes, c’est bien une telle distinction que fait jouer la question du savant irlandais. D’abord, sa formulation en 1693 fut conditionnée par ce que l’on appelle le « rationalisme classique ». Loin d’être un objet que la raison produit dans son prétendu exercice naturel, nécessaire et atemporel, la question du savant irlandais constitue un problème historiquement déterminé, dont il est possible de retracer les conditions d’émergence. Nous nous efforcerons ainsi d’établir que William Molyneux n’aurait pu formuler son fameux énoncé avant que la science moderne, et plus précisément l’optique keplérienne, ne soit venue dissocier les deux modalités sensorielles que sont la vue et le toucher et, par là même, ces deux opérations que sont la sensation et le jugement. De ce cadre conceptuel émergea une théorie de la vision qui fut considérée, au siècle suivant, comme la première 1 Extrait raisonné du Traité des sensations, op. cit., p. 6. 2 Histoire naturelle de l’Homme, dans Œuvres choisies de Buffon, Paris, Didot Frères, Fils et Cie (éd.), 1859, t. I, p. 304. 3 Extrait raisonné du Traité des sensations, op. cit., p. 7. 26 réponse, évidemment anticipée, que reçut le problème de Molyneux : celle de Descartes, dont le rationalisme réside en ce qu’elle rend compte d’un phénomène, la vision, à l’aide d’un dispositif géométrique – l’institution de nature – dont nul ne peut avoir l’aperception. Mais, pour que la question du savant irlandais apparût comme un authentique problème, il fallut que la théorie cartésienne de la vision subisse un certain nombre de critiques, au premier rang desquelles figurent celles de Gassendi : celui-ci signala, contre Descartes, qu’un aveugle-né est proprement incapable de percevoir les couleurs1 . Cependant, loin de lui l’idée de douter que les figures visibles, tels le cube et la sphère présentés à l’aveugle de Molyneux, puissent différer des figures tactiles correspondantes. Mais en 1690, John Locke, dans son Essai philosophique concernant l’entendement humain, déclara vouloir suspendre toute considération sur les causes inapparaissantes des perceptions. Comment, dès lors, être encore assuré que la vision constitue l’effet instantané d’un dispositif mécanique, et suscite des sensations analogues à celles du tact ? N’est-elle pas plutôt celui, progressif, d’un jugement d’expérience ? Il y a bien un moyen de s’en assurer : s’enquérir des perceptions visuelles d’un aveugle-né à la vue nouvellement recouvrée. En effet, l’éventuel écart entre ce que celui-ci percevra par la vue et ses perceptions issues du tact signerait la dimension historique de la perception, puisqu’il signifierait que seule l’expérience nous permet aujourd’hui, à nous voyants, d’apparier dans l’instant ces deux « séries sensibles2 ». Et voilà posé le problème3 de Molyneux. La suspension de toute considération sur l’inapparaissant commande ainsi de partir de l’expérience et, de là, de concevoir une genèse de la perception, démarche qui est précisément celle de la posture que Jean-Bernard Mérian qualifie de « matérialiste » et qui a été caricaturée par Leibniz sous le nom de « voie empirique ». Ainsi, la question du savant irlandais ne s’inscrit pas seulement dans le cadre de la science moderne : en tant que problème, elle s’enracine aussi dans le programme empiriste énoncé dans l’Essay de Locke. Si le problème de Molyneux fut ainsi conditionné et par les thèses de Kepler et de Descartes et par le précepte méthodologique que Locke formula en 1690, il constitua, pour les philosophes des Lumières, l’occasion de mettre en œuvre un tel précepte, c’est-à-dire d’élaborer des théories qui considèrent nos perceptions d’hommes faits non pas comme les effets immédiats de dispositifs géométriques, mais comme des phénomènes dont l’origine se trouve dans une sensation épurée de tout jugement. S’il est vrai que ceux que l’on nomme « empiristes » font de la sensation l’origine des 1 Il peut paraître surprenant que l’auteur de la Dioptrique ait soutenu le contraire : comme nous l’expliquerons en temps voulu, la possibilité, pour un aveugle de naissance, de percevoir les couleurs, est pourtant impliquée par la théorie cartésienne de la vision. 2 Selon l’heureuse expression de Geneviève Brykman, qui, plus précisément, parle d’ « hétérogénéité des séries sensibles » à propos de la différence spécifique des genres de sensations chez Berkeley. Cf. Berkeley et le voile des mots, Paris, Vrin, 1993, p. 113. 3 Comme l’indique la définition du terme proposée dans l’Encyclopédie, il est nécessaire, pour qu’un problème se pose, de se trouver confronté à deux résolutions concurrentes. Cf. art. « Problème », dans Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers, par une société de gens de lettres. Mis en ordre et publié par M. Diderot […], et quant à la partie mathématique, par M. d’Alembert, Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand ; puis Neuchâtel, S. Faulche, 1751-1765, vol. 13, p. 401 : « Problème, en terme de logique, signifie une question douteuse, ou une proposition qui paraît n’être ni absolument vraie, ni absolument fausse, mais dont le pour et le contre sont également probables, et qui peuvent être soutenus avec une égale force ». 27 connaissances, c’est donc en un sens dont il faut mesurer l’originalité : d’après eux, il ne s’agit pas seulement de dire que toutes nos idées générales ont été abstraites de la sensation, mais que la sensation constitue une origine qu’il convient de reconstituer. Le problème de Molyneux offre ainsi la possibilité de mettre en œuvre le versant proprement régressif1 de la genèse : que voit-on la première fois que l’on ouvre les yeux ? De là, trois voies se sont tracées2 . Selon une première approche, résolument critique à l’égard des théories géométriques de la perception, Locke et Berkeley se sont attachés à montrer que la sensation, loin d’être l’effet d’un jugement géométrique, constitue le matériau dont le jugement se sert pour élaborer ses objets. Ainsi, selon eux, nos perceptions d’adultes sont pétries d’un certain nombre de jugements inaperçus qui ont progressivement recouvert nos sensations originaires. Cependant, une telle voie, qui se dessine entre 1694 et 17333 , ne laisse pas de faire difficulté : peut-on admettre que nos perceptions renferment des jugements inaperçus, quand le précepte qu’il s’agit de suivre impose de dériver les connaissances de contenus strictement apparaissants ? C’est la raison pour laquelle La Mettrie, Condillac et Diderot, entre 1745 et 17494 , suivent une autre voie, et refusent que nos perceptions actuelles soient constituées de jugements inconscients : d’après eux, le sens de la vue suffit à nous faire connaître les corps. Loin que la sensation primitive, pour ce qui est de la vision, consiste en un ensemble de couleurs plus ou moins figurées, elle s’identifie peu ou prou à ce que nous voyons actuellement.
Les conditions d’émergence du problème de Molyneux
À distance d’une conception qui envisage les problèmes de philosophie comme des entités atemporelles ou qui, à tout le moins, réduit la dimension historique de leur formulation à la simple explicitation d’une interrogation déjà envisagée sous d’autres formes1 , il nous est apparu que la question posée par William Molyneux en 1693 n’aurait pu faire figure de « problème2 » avant la fin du XVIIe siècle3 . Question typiquement moderne, elle émerge depuis un triple contexte historiquement situé à l’âge classique : l’optique keplérienne, la théorie cartésienne de la vision, et les critiques qui furent adressées à cette dernière4 . Ce triple contexte permet de comprendre en quoi la question de Molyneux est un problème qui concerne, lors de son émergence en particulier, l’articulation de la sensation et du jugement. Lorsque Kepler découvre que l’objet de la vision n’est pas la chose vue, ni un double de cette chose, mais une simple image (la peinture rétinienne), indissociablement la vue devient irréductible au toucher et le jugement irréductible à la sensibilité. En effet, dès lors que l’œil n’est plus conçu comme un organe sensible, en contact immédiat avec la chose, mais comme un vecteur d’image, ce qui est vu n’est plus la chose même que l’on touche. Il est donc requis de juger afin de combler l’écart ainsi creusé entre les sensations visibles et les sensations tactiles. Mais si l’organe du sens est désormais privé de sensibilité, a fortiori se trouve-t-il incapable de produire un tel jugement : c’est donc à l’esprit qu’il revient de juger de la conformité (ou non) des sensations visuelles et tactiles. Si, par sa distinction de l’objet vu et de l’objet touché et par son refus d’attribuer au sens le jugement perceptif, l’optique keplérienne a ainsi conditionné5 l’émergence de la question posée par Molyneux, elle n’a cependant jamais été considérée par les philosophes du XVIIIe siècle comme susceptible de lui apporter réponse : parce qu’elle achoppe sur la question de savoir comment l’âme en vient à rencontrer l’image rétinienne, ou comment la sensation émerge d’un dispositif strictement optique, elle n’offre qu’une théorie embryonnaire de la vision. Descartes, le premier, résolut cette question, en soutenant que ce n’est pas l’image rétinienne qui suscite la vision, mais les mouvements imprimés aux nerfs par cette image. Le fait d’avoir ainsi complété et corrigé l’optique keplérienne conduisit Descartes à élaborer une conception originale des rapports entre sensation et jugement et, de ce fait, la première théorie susceptible de résoudre le problème de Molyneux. Tandis que chez Kepler, le jugement qui participe à la vision échoue à combler parfaitement l’écart entre l’apparence visuelle de l’objet et sa réalité matérielle, chez Descartes, un dispositif rectifie tout ce que l’image rétinienne peut porter de déformations et défigurations. Descartes comble ainsi l’écart que son « premier maître en optique1 » avait introduit entre figures visibles d’un côté, et figures tactiles de l’autre : selon lui, qu’il soit vu ou bien touché, un objet peut occasionner dans l’âme des idées de figure strictement identiques. Cette homogénéité des idées issues des différents sens, conditionnée par un dispositif de type géométrique, justifie la dimension positive de la réponse que Descartes, d’après Berkeley et Voltaire, aurait donnée au problème de Molyneux. C’est une telle homogénéité que certains adversaires de Descartes, interpellés par la figure2 de l’aveugle aux bâtons qui lui sert de ressort, commencent à faire vaciller avant même que Molyneux ne forge sa supposition. S’il s’avère que l’aveugle vit dans un monde d’objets différents des nôtres, n’estce pas toute la théorie cartésienne du sensible et la figure de l’aveugle aux bâtons sur laquelle elle s’appuie qui demandent à être intégralement repensées ? Il s’agit en somme d’établir ici que la question posée par Molyneux en 1693 prit racine dans ce que l’on nomme « le rationalisme classique », et constitua un problème dans la stricte mesure où Locke , dans son Essay de 1690, ébranla la façon dont ce rationalisme concevait la perception sensible.
Le problème de Molyneux avant Kepler : l’illusion de l’atemporalité
Dans l’ouvrage qu’elle consacre au problème de Molyneux, Marjolein Degenaar indique que les thèses keplériennes font partie de son « background1 », sans préciser les raisons d’un tel statut. Cependant, à remonter l’histoire de l’optique au-delà de Kepler, de curieuses affinités apparaissent entre l’énoncé du problème et ses traitements dix-huitiémistes d’une part, et certains textes de l’Antiquité et du Moyen Âge d’autre part. Mais ces affinités, troublantes au premier regard, révèlent rapidement l’abîme qui sépare le cadre conceptuel antique et médiéval de celui qui a vu naître le problème de Molyneux. À notre sens, c’est donc de bon droit que Marjolein Degenaar estime que l’optique keplérienne a conditionné la formulation du problème de Molyneux, et toutes nos prétentions se borneront ici à donner à sa remarque la portée qu’elle mérite : la question posée par William Molyneux, en tant qu’elle suppose que soient clairement distinguées les deux modalités sensorielles que sont la vue et le toucher, n’aurait pu être formulée dans le cadre des théories pré-keplériennes de la vision. Il est troublant de lire sous la plume de Lucrèce, au Ier siècle après Jésus-Christ, ces quelques lignes qui, à notre connaissance pour la première fois dans l’histoire de la philosophie, traitent de la reconnaissance visuelle d’une figure géométrique – en l’occurrence un carré – d’abord appréhendée par le toucher dans l’obscurité : Ajoutons ceci : quand nous manions un objet dans les ténèbres, nous l’identifions à celui que nous voyons à la lumière éclatante du jour ; c’est donc nécessairement la même cause qui émeut le toucher et la vue. Maintenant donc, si, palpant un objet dans l’obscurité, nous avons l’impression d’un carré, le carré que nous apercevrons à la lumière, que pourra-t-il être sinon l’image de cet objet ? C’est don dans les images que semble résider le principe de la vision, et sans elles nul objet ne peut nous apparaître1 . L’affinité entre ces lignes du De natura rerum et l’énoncé du problème de Molyneux se révèle, à l’examen, purement illusoire : loin de questionner, comme le fait Molyneux, le transfert des sensations tactiles aux sensations visuelles, Lucrèce part de l’effectivité d’un tel transfert et démontre, de là, l’existence des simulacres. La reconnaissance des figures n’est pas mise à l’épreuve, mais posée au principe de l’argumentation. La question de Molyneux aurait-elle seulement été douée de sens pour un Lucrèce ? Cela est bien peu probable, car le disciple d’Épicure s’attache à montrer que la vision se réduit à une espèce de toucher ; or, ce que présuppose à tout le moins l’énoncé du savant irlandais, c’est une différenciation de ces deux modalités sensorielles. Ce court passage du De natura rerum vise en effet à démontrer une nouvelle fois l’existence des simulacres, fines pellicules qui sont au principe de la vision. Puisque, dans l’obscurité, nous reconnaissons par le tact l’objet que nous connaissons par la vue, alors nécessairement la même entité qui ébranle le tact ébranle aussi la vue. Mais quelle est cette entité, demande Lucrèce ? Seule l’expérience inverse, celle du transfert des sensations tactiles aux sensations visuelles, est à même de nous l’enseigner : si nous reconnaissons à la lumière du jour l’objet que nous avons palpé dans les ténèbres, ce que nous voyons-là ne peut être qu’une image de cet objet, une pellicule matérielle qui s’en est détachée pour venir frapper nos yeux. Ainsi, tandis que la vision seule ne peut nous révéler l’existence des simulacres, trop ténus pour être visibles à l’œil nu, et que le transfert des sensations visuelles aux sensations tactiles nous enseigne uniquement l’identité des objets visuels et tactiles (le carré que je vois est le même que le carré que je touche), le transfert inverse, parce qu’il joint à la reconnaissance le sentiment de l’éloignement des corps, nous apprend de surcroît que ce que nous voyons ne peut être qu’une pellicule de matière émanée de l’objet que nous avons touché. Or, une telle conception réduit la vue à une espèce du genre « toucher » : si, dans la vision, des images matérielles détachées des corps pénètrent nos organes sensoriels, voir revient à toucher des yeux la partie superficielle des choses que nous voyons. Le tact diffère alors uniquement de la vision en ceci qu’il appréhende les couches les plus profondes des corps ; c’est pourquoi nous appréhendons la dureté par le tact, mais non par la vue. Ainsi, lorsque Lucrèce et Épicure appellent « simulacres », « idoles » ou « images » ces fines pellicules de matière, ils désignent de véritables choses (et non des « images » au sens où nous l’entendons aujourd’hui), qui ne diffèrent des corps dont elles proviennent que quantitativement, parce qu’elles sont constituées d’un plus petit nombre d’atomes. Les simulacres avec lesquels nous entrons en contact dans la vision possèdent donc des propriétés qui sont non seulement spécifiquement, mais aussi numériquement, identiques à celles des corps dont ils se sont détachés, au point qu’ils pourraient être envisagés, en termes modernes, comme les attributs de leur substance :
INTRODUCTION |