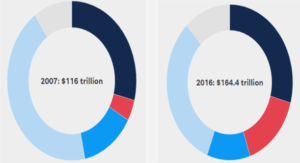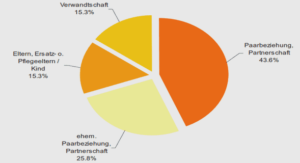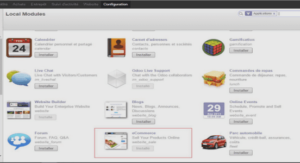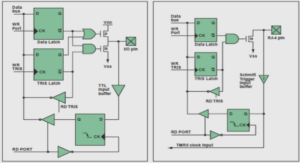L’aboutissement d’un parcours personnel
Nous avons animé, pendant trois ans et hebdomadairement, des cours d’éducation aux médias pour une classe média en collège. Ces cours nous ont poussée à reprendre des études en master de recherche en documentation. Après la soutenance du mémoire, nos recherches se sont prolongées et ont mené à ces travaux, à des rencontres et à des colloques nous encourageant à faire évoluer notre pratique professionnelle en lycée. Il était important de continuer à réfléchir à la construction d’une éducation à l’image de la 6ème à la Terminale. Nous avions alors deux possibilités : mener des enquêtes en lycée, sur notre temps libre, avec l’autorisation au chef d’établissement du lycée voisin et avec l’accord du collègue professeur documentaliste. Ou nous pouvions postuler à un poste en lycée général. Il nous semblait qu’intervenir, en lycée pour y mener une enquête, ne nous permettrait pas d’observer et de délimiter avec précision les besoins des lycéens. Nous en avions fait l’expérience au collège : il faut beaucoup de temps pour observer, créer et évaluer une action. Nous avions également appris que les échanges informels nourrissaient les réflexions. Nous venions de choisir la focale de la photographie dans nos recherches, il nous semblait alors primordial de tisser des liens de confiance pour recueillir les témoignages des élèves sur leurs propres pratiques, en lien à leur intimité. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de postuler sur un poste de lycée. Dès notre arrivée, la directrice nous a confié l’animation de séances de formation autour des médias et de l’image photographique dans le cadre de l’aide personnalisée. En programmant, dans le projet culturel de l’établissement les sorties à Perpignan au festival Visa pour l’image, nous inscrivions l’établissement dans cette pratique active d’une éducation à l’image que nous comptions encore développer. Nous avons pendant deux ans investi le champ de l’éducation aux médias dans le cadre de l’aide personnalisée, de l’éducation civique et morale avec les enseignants d’histoire jusqu’à une proposition, en mai 2016, d’un partenariat qui allait rendre possible une expérimentation de plus grande ampleur, à la fois en terme de temps et du nombre des acteurs.
L’aboutissement de travaux de recherche
Au cours de ces deux ans et de nos travaux de recherche, nous avons pu réfléchir et déterminer les éléments importants à insérer dans un parcours d’éducation à l’image photographique. Nous avons essayé de définir les bases d’une culture scolaire de l’image, de déterminer les savoirs essentiels en lecture d’image. Nous avons également recensé des ressources afin de créer des séances visant à l’acquisition d’une culture de l’image. Nous avons écrit un décalogue pour les éducateurs à l’image offrant une entrée dans cette éducation. Avant de nous lancer dans l’écriture du projet, il a fallu créer un vadémécum des essentiels, réfléchir au contenu d’une séance pédagogique d’éducation à l’image photographique et penser à une méthode d’analyse.
Nous avons retenu que chaque projet d’éducation à l’image photographique devait contenir :
– des éléments de l’histoire de la photographie depuis son invention, rappeler son évolution technologique, présenter un courant photographique, permettre à l’élève de découvrir aussi les noms des photographes célèbres, les photographies importantes dans notre histoire visuelle,
– des mots techniques lui permettant d’enrichir son vocabulaire pour lui donner la possibilité de se composer un lexique des mots essentiels importants de la photographie pour construire une culture de l’image,
– offrir l’opportunité à l’élève d’apprendre la lecture d’image photographique,
– lui faire découvrir les techniques de production, les droits de diffusion, les circuits informationnels et économiques d’une image.
Nous avons noté le besoin nécessaire d’acculturation de l’élève à ce média et l’importance de le rendre acteur dans son apprentissage. Nous avons opté pour une éducation à l’image par l’image. Cela a son importance car il ne s’agit pas de créer des séances théoriques sur l’image, ou des séances de présentation d’œuvres photographiques mais de permettre à l’élève d’apprendre à voir, de construire un savoir, sur une image photographique.
Nous avons donc réfléchi à la situation communicationnelle à mettre en place. La méthode d’Alex Mucchielli, « la sémiotique situationnelle », nous a été proposée par notre directeur de thèse « permettant à un professionnel de la communication, quel que soit son domaine d’action, une méthode pour comprendre et prévoir » (De Lavergne, 2009) « les significations attachées aux différentes expressions et actives humaines » (Mucchielli, 2008). Nous avons ainsi tenté de poser le contexte normatif, c’est à dire de déterminer les intentions et les enjeux, les normes et les règles, de définir notre positionnement et la qualité des relations à établir avec l’élève. Nous avons ensuite réfléchi aux différents contextes : temporel, spatial et sensoriel en nous appuyant sur le schéma : le modèle situationnel : le système des contextes reproduit par Catherine De Lavergne, dans son article intitulé : la sémiotique situationnelle (De Lavergne, 2009). Nous nous sommes reconnue dans cette approche interactionniste. Nous nous sommes située comme acteur. Nous avons proposé les éléments pertinents à la construction d’une culture de l’image chez l’élève. Nous souhaitons instaurer une nouvelle approche de communication dans le contenu des apprentissages. Nous avons voulu développer une relation de médiation pour permettre à l’élève d’apprendre en lisant une photographie, mais aussi dans son processus dynamique, définit par Catherine De Lavergne comme une approche « où le sens n’est pas donné d’avance, il se construit en situation ».
« Ce sont par des actions spécifiques intervenant sur différents contextes de situation pour les acteurs que la trame de la situation de communication se forme, et que la construction du sens est faite par les acteurs. L’objectif de la sémiotique situationnelle est de faire apparaître ces contextes pour reconstruire et faire émerger le sens final de la communication. » 7 contextes sont identifiés : le contexte spatial, le contexte temporel, le contexte physique et sensoriel, les enjeux, les normes et cultures qui sont les règles collectivement partagées, les positionnements et la qualité des relations.
Ainsi nous avons pu établir que le temps de cette action serait le temps scolaire, en gardant le cadre du cours. Les dispositifs de l’AP, accompagnement personnalisé ou de l’EMC, l’éducation morale et civique seraient les plus adéquats pour mener cette éducation. Le lieu serait le CDI ou tout espace permettant de voir l’image photographique. « Voir » serait le sens à privilégier. Nous avons conservé notre intention de former à l’image photographique, en déterminant que l’enjeu est de permettre à l’élève de devenir un citoyen responsable et actif dans notre société de l’image. Notre positionnement est d’être un médiateur afin de permettre à l’élève de s’approprier un savoir contenu dans le média image, un médiateur bienveillant et à l’écoute. Comme normes et règles, nous nous sommes fixée de nous appuyer sur les programmes scolaires en vigueur, de faire vivre le règlement de l’établissement et du CDI, d’amener les élèves à respecter les droits d’auteur, de nous attacher à conduire une éducation à la citoyenneté. Nous avons choisi comme contenu les éléments cités précédemment. Nous restons convaincue du besoin de créer une nouvelle méthode, les méthodes existantes se révélant insuffisantes, inappropriées, difficilement adaptables à notre objet d’étude. Cependant, ce temps de définition était nécessaire pour prendre le temps de faire vivre la théorie dessinée.
L’écriture du projet
Le projet a été écrit en mai et juin 2016 à la suite d’une soirée organisée à la médiathèque visant à promouvoir la lecture plaisir avant les vacances d’été. Nous avions demandé à la médiathèque la possibilité le prêt de la salle de l’auditorium pour présenter les booktrailers, des bandes annonces littéraires crées par les élèves de seconde, dans le cadre de l’enseignement d’exploration littérature et société pendant l’année scolaire. Notre projet était alors de leur proposer de présenter leur livre préféré en image. Certains ont choisi de réaliser des petites œuvres multimédia à partir de photos, d’autres de travailler uniquement en vidéos et un groupe a choisi de créer une bande-annonce à l’aide de l’application en ligne Powtoon. Les élèves de première L assuraient la première partie, en présentant leur oral de TPE comme un petit spectacle, pour les secondes et pour leurs familles. Au début de ce projet, les élèves ont pu visiter la médiathèque et certains l’ont fréquentée ensuite durant l’année scolaire. Nous avions naturellement convié les bibliothécaires du service éducatif de la médiathèque qui nous ont prêté main forte dans l’organisation et la communication de cet événement, en mettant à disposition leurs compétences et leur réseau. Le travail des élèves a été valorisé sur les pages internet de la médiathèque ; les parents, les enseignants présents et les élèves invités ont tous applaudi la performance des élèves, devenus passeurs culturels.
Dès la fin de la soirée, il a été convenu de nous revoir pour dessiner un projet pour la section littéraire, le directeur nous offrait un partenariat culturel et financier. La première rencontre a eu lieu deux semaines après.
Dès le départ, nous avons insisté sur notre désir de mener une expérimentation pour confirmer que la pratique de la photographie en lycée pouvait amener à développer des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire nécessaires, à l’entrée dans le supérieur et permettre de construire une culture de l’information. Tous les acteurs, le professeur de philosophie (professeur principal de la classe), la directrice du lycée et nos partenaires éducatifs, la médiathèque, le SCUIO de l’université ont accepté de relever le défi. Nous avons informé les élèves de première L du défi à venir. Nous avons imaginé un projet qui allait se construire et se nourrir de tous les regards. Les parties rendant le tout meilleur que le chercheur seul, chacun jouant sa partition en éclairant de ses compétences le projet. Nous pouvions ensemble provoquer le déclic et la résonnance n’en serait que plus forte. Nous ne voulions pas en rester au constat d’une école n’offrant aucune éducation à l’image photographique. Nous voulions dépasser les freins énoncés, les enseignants n’ayant pas de formation leur permettant une transmission d’une éducation à l’image, l’école n’ayant pas les fonds, … Au contraire, il s’agissait de rassembler nos forces et nos atouts pour construire un parcours d’éducation à l’image possible. Nous allions dessiner une réponse à notre problématique de recherche et ébaucher une éducation à l’image photographique. La ville de Narbonne venait d’accueillir le festival de la photographie sportive : Sportfolio. Le personnel de la médiathèque y avait participé et souhaité développer une médiation auprès du jeune public. Il y avait donc eu une rencontre autour de missions partagées sur la transmission d’un patrimoine, d’une culture, et sur l’image.
L’écriture du projet a débuté à la médiathèque, avec quatre acteurs : deux bibliothécaires, un professeur de philosophie et un professeur documentaliste doctorant. Nous avons intitulé le projet : « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu deviendras ». Nous disposions de 2h hebdomadaires, dans le cadre de l’aide individualisée au lycée, pour mener ce projet. La photographie offrant un reflet de soi, nous avons proposé d’intégrer sa pratique à l’orientation et défini la place de la médiathèque et des bibliothécaires sur l’année. Elles nous ont proposé de travailler avec un photographe et ont monté la demande de financement. Il ne manquait qu’à tisser un fil jusqu’à la littérature que nous n’avons pas tardé à trouver. Nous allions faire une recherche des métiers exercés par nos héros en littérature, nous avons encore affiné cette recherche par la suite. La co-construction du projet a permis de rester réaliste et professionnel. La force du groupe était d’être composé de deux concepteurs technophiles et de deux pragmatiques technophobes. « Il n’y a pas à choisir son camp », (Grassin, 2011), mais cette particularité permettait de faire le point sur l’ancrage technique que nous voulions apporter au projet. Nous nous reconnaissons dans l’homme contemporain que décrit Marc Grassin : « un peu désorienté, partagé entre l’émerveillement des bienfaits de la technique et la frayeur de ses dérapages » (Grassin, 2011). Difficile, pour le professeur ou l’intervenant, d’envisager de former l’élève à une technique à laquelle l’enseignant n’a pas été formé lui-même ; la tâche est ardue lorsque l’on est dans la pratique, de raisonner son usage pour communiquer et enseigner sa bonne utilisation. Nous avons dû répondre à la question suivante : quelle part le numérique allait-il prendre dans ce projet ? Nous nous sommes interrogée sur la place à donner à internet et au numérique dans cette éducation à l’image photographique. La question posée était double puisque aujourd’hui, la photographie s’interroge elle-aussi sur la question de son évolution technique. Comme le démontre Marc Grassin, maître de conférences en philosophie, il ne s’agissait pas d’être simplement pour ou contre la technique mais de s’entendre sur ce qu’il nomme la balance bénéfice/risque. Conscient que « nous vivons et profitons d’un même pas de ce temps de la technique, profitant de ses largesses malgré les quelques «petits» inconvénients, vite oubliés », chaque intervenant se devait de faire un point sur ses pratiques et sur ses propres compétences, au-delà de cette simple catégorisation « je me sens à l’aise et je suis pour la technique » ou « je suis mal à l’aise et je préfère rester dans ma « zone de confort » c’est à dire de maîtrise des savoirs. En plus de nous faire confiance comme nous l’avons évoqué au point précédent, il nous a fallu nous « partager » cette éducation à l’image photographique selon nos compétences. Toujours selon Marc Grassin : « le défi moderne est désormais là, dans cette liberté d’un homme actif et fabricant, inscrite entre cette puissance d’invention du monde et l’héritage des représentations et des répartitions ». Nous nous sommes rendu compte qu’en donnant aux élèves la possibilité, à leur tour, de prendre part au monde en prenant des photographies, nous leur permettions de « basculer dans un monde fait d’une liberté ouverte à l’indéterminé de ce que nous déciderons de produire » (Grassin, 2011). Marc Grassin nous rappelle que le philosophe allemand, Peter Sloterdijk, avait noté que « les technologies de l’information ont créé, quant à elles, un nouveau rapport à l’espace, infini et sans distance, à un temps immédiat et sans mémoire, développant des logiques inédites de réactivité et d’adaptabilité aux événements, à une condition humaine nomade et mobile ». Nous prenons comme mise en garde sa définition de « l’homme moderne comme un messager sans message, qui a donc perdu sa fonction médiatrice avec les autres, le passé, l’histoire et par-là même avec le futur ». Ces propos résonnent avec le portrait de la société de l’information que nous avons dressé. D’autant plus si on pense aux comportements des adolescents de type : selfie, où l’adolescent envoie des photos de lui pour montrer qu’il appartient à cette société, mais sans autre message. Nous pourrions écrire qu’il s’émet pour dire son appartenance à ce monde où même le destinataire n’est pas choisi précisément et nous pourrions nous demander s’il communique vraiment ? C’est pour développer d’autres usages de sa pratique photographique quotidienne que nous nous sommes lancée dans un projet d’éducation à l’image photographique. Ce dernier représentant aussi une petite révolution dans le domaine éducatif, une avancée où le regard et l’investissement des deux institutions, la médiathèque et le lycée, nous a également porté. Au bout de deux réunions, quelques échanges d’e-mails, la première version du projet a été validée par les deux établissements sous la forme d’un accord. Nous reproduisons ci-dessous le projet initial, mis au propre et résumé par les bibliothécaires et transmis à leur direction le 8 juin 2016.