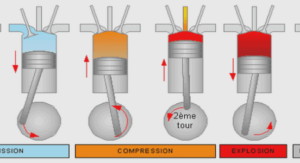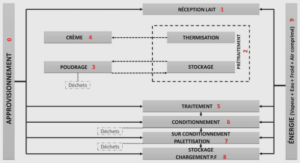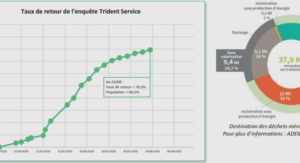« Et si les coopératives disposaient déjà d’une des clés du monde d’après ? »
C’est ainsi que praticiens et chercheurs appellent à valoriser l’expérience coopérative auprès des politiques publiques et des citoyens dans leur appel à signatures « #Coopérons pour une démocratie économique ! », initié par la Confédération générale des SCOP et Bigre (2020). Qu’elles soient économiques, écologiques, sociales ou sanitaires, les crises qui plongent le monde de 2020 en proie aux incertitudes ont toutes pour point commun de souligner la nécessité d’opérer un changement drastique de paradigme socio-économique. Une transition, oui, mais vers quoi ? Pour les initiateurs de la pétition, le modèle coopératif suggère un premier pas vers un changement sociétal, en proposant pour commencer une alternative aux entreprises capitalistes. Il questionne le rapport à la propriété et « l’appropriation individuelle de richesses créées collectivement », au pouvoir en « privilégiant la concertation et l’intelligence collective, dans une logique de citoyenneté économique », et au savoir, en utilisant « des voies d’éducation populaire, de construction de savoirs endogènes auxquels chacun·e peut légitimement contribuer et que chacun·e peut librement se réapproprier. ». D’autres types d’entreprises collectives répondent à ces valeurs : ce sont les associations, les mutuelles et les fondations. Ensemble, elles forment les entreprises de l’économie sociale. Ce sont des entreprises qui seront appelées collectives, et qui se distinguent des formes d’entreprises qui seront appelées individuelles ou capitalistes. Les entreprises de l’économie sociale répondent aux principes fondamentaux définis par la Charte de l’économie sociale (Comité national de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives [CNLAMCA], 1980). Elles fonctionnent en effet selon les principes de gouvernance démocratique (1 personne = 1 voix), de propriété collective du moyen de production, de libre adhésion, de non-lucrativité, et d’intérêt général ou collectif de l’action face au profit. Depuis près de trois siècles, les entreprises collectives cohabitent avec les entreprises capitalistes. En associant le contrôle, la propriété et l’usage de l’entreprise aux mains des mêmes acteurs, face à des entreprises qui dissocient les trois (Hansmann, 1996), elles proposent une incarnation concrète de développement durable attachée à la notion de biens communs (Francoual, 2017).
L’entrepreneuriat collectif semble donc faire partie de la réponse à cette question de la transition vers une société et une économie plus durable, responsable, écologique et égalitaire.
Depuis les années 1990, l’entrepreneuriat lui-même est amené comme une solution à la crise sociale. La notion d’entrepreneuriat sera définie par la création d’une entreprise ex nihilo, c’està-dire d’une unité organisationnelle produisant des biens ou des services (Bruyat, 1994, cité dans Guyot et Vandewattyne, 2008). Il permettrait de créer son propre emploi, devenant ainsi un des axes majeurs de la politique française de lutte contre le chômage (Darbus, 2008). C’est dans cette dynamique très favorable à l’entrepreneuriat qu’apparaissent en parallèle des EES des entrepreneurs, ou porteurs de projet, qui souhaitent promouvoir une nouvelle manière d’entreprendre autour de valeurs fortes : écologie et égalité des chances. Ils souhaitent devenir des « entrepreneurs engagés » (France Active, 2020), « à impact» (les Canaux, 2020), des « acteurs de changement » (Ticket for Change, 2020), répondant aux « grands enjeux sociétaux » (Ashoka France, 2020). Ce mouvement prend racine dans le concept anglo-saxon du Social Business, incarné par le microcrédit de Mohammed Yunus au Bangladesh, ou d’entrepreneuriat social, mouvement promu à l’origine par Bill Drayton aux Etats-Unis (Petrella et Richez Battesti, 2010, Draperi, 2010). Cette véritable vague d’entrepreneurs responsables est rendue visible en France par différents réseaux d’accompagnement et de financement comme le Mouves, Ashoka France, Ticket for Change et les Canaux pour ne citer qu’eux. Les valeurs de ces entrepreneurs et celles portées par les entreprises collectives semblent mettre tout le monde d’accord : l’objectif est de promouvoir une société plus égalitaire, de lutter contre la catastrophe écologique, et de mettre au centre de l’entreprise un objectif de réponse à un besoin collectif, et donc autre que le profit.
Cependant, on observe différentes manières pour les entrepreneurs portant ces valeurs de mettre en pratique leurs aspirations. Le choix notamment de la structuration collective ou individuelle du projet est une nuance qui s’avère majeure dans le processus de construction entrepreneurial. Tandis que les entreprises collectives proposent des espaces publics de proximité (Laville, 1994, cité dans Codello-Guijarro, 2003) par la pratique de la démocratie économique et de la double qualité, les entreprises individuelles d’utilité sociale ne proposent pas de questionner les rapports de pouvoir au sein des entreprises. Le choix d’un statut pour un projet voulu social ou environnemental n’est donc pas neutre (Petrella et Richez-Battesti, 2010).
Partant de ce constat, il est intéressant de se pencher sur le moment précis du choix statutaire opéré par les entrepreneurs. En tant que porteurs initiaux du projet, ils se trouvent, au moment de cette décision, à l’origine de la future forme organisationnelle de l’entreprise.
Les recherches concernant le choix statutaire individuel ou collectif insistent souvent sur les différences de portée des formes d’entrepreneuriat, mais n’étudient pas les porteurs de projets directement, à quelques exceptions près. La littérature aborde généralement cette question par une approche gestionnaire, en catégorisant par exemple les entrepreneurs selon le degré d’implémentation de pratiques collectives dans leurs entreprises (Johanisson, 2002), ou en étudiant les profils des porteurs de projet une fois l’entreprise développée (Richez-Battesti, 2016). Aucune recherche ne s’intéresse particulièrement au moment spécifique du choix et de ses facteurs déterminants chez les individus. La référence aux différentes rationalités catégorisées par Max Weber semble pertinente afin d’opérer une analyse de la construction de sens de la décision par ces entrepreneurs. En abordant la rationalité, il est affirmé ici que les « hommes agissent suivant des raisons » reposant sur un certain « rapport d’adéquation » entre « moyens et fins » (Mongin, 2002). Ainsi, ce choix peut être questionné à l’échelle individuelle d’action : Alors que les porteurs de projets sociaux souhaitent tous répondre à un problème résolument collectif, qu’il soit social ou environnemental, comment se fait-il que certains choisissent la forme collective non-lucrative pour y répondre, et d’autres la forme individuelle et lucrative?
Une ou des rationalités ? L’impossible définition d’une raison pure à l’action
Faire un détour par l’étude de la sociologie wébérienne, ses choix méthodologiques et son appréhension de la rationalité de l’acteur peut sembler être éloigné de l’objet d’étude. En réalité, s’ancrer dans une perspective sociologique précise et questionner la manière dont on peut essayer de comprendre les choix des individus permettra de solidifier l’approche au sujet. Il sera ainsi tenté de comprendre les actions sociales, autrement dit de répondre à cette question : pourquoi un acteur agit-il comme il le fait ? Répondre à cette question peut commencer à amorcer la réponse à la question de recherche, interrogeant l’adoption où le rejet de l’entreprise collective par les porteurs de projets sociaux. Large interrogation à l’origine de toutes sciences sociales et psychosociales, la perspective adoptée vise, à l’instar de Weber, à comprendre plutôt qu’à expliquer le comportement humain : c’est-à-dire que cette partie tentera de justifier le choix de l’analyse de l’objet d’étude par l’acteur plutôt que par le système, même si l’acteur ne peut pas être complètement coupé de son environnement. Ensuite, l’apport sur les questions de rationalités de Weber et ses critiques sera développé, afin de dégager ce qui peut permettre de comprendre l’action sociale individuelle.
La nécessité de comprendre l’action sociale individuelle par l’individualisme méthodologique
Entreprendre est une action sociale
Pour qu’un comportement individuel soit une action sociale, il faut que celui-ci soit conséquent d’une interaction sociale et orienté par rapport à autrui (Passeron, 1994). Weber, pour illustrer sa définition de l’action sociale, c’est-à-dire qui entre dans la délimitation stricte de sa sociologie, prend l’exemple de l’utilisation des parapluies (Weber dans Passeron, 1994). Si lorsqu’il pleut, tous les individus dans la rue ouvrent leurs parapluies, c’est une action logique au sens de Pareto, c’est-à-dire que le fait d’ouvrir son parapluie est un moyen de se protéger de la pluie. À l’inverse, si tous les individus ouvrent leurs parapluies alors qu’il ne pleut pas pour obéir à un rite ou transmettre un message politique, alors elle est coexistante d’une interaction sociale. Les acteurs agissent ici non par rapport à la pluie, mais par rapport au comportement d’un autre individu. Selon Weber, toute « relation sociale est, le comportement de plusieurs individus dans la mesure où, par son contenu significatif, l’action des uns prend en considération celle des autres et s’oriente en conséquence» (1921). Pour Cherkaoui (2006), «est donc social tout phénomène émergent, en d’autres termes tout phénomène irréductible à la simple somme des actions individuelles en raison précisément de la structure d’interdépendance dans laquelle se trouvent les acteurs sociaux. Il en est ainsi de l’échange, de la division du travail, de la quasi-totalité des phénomènes qui se déroulent sur un marché, de l’amitié, de la coopération, du conflit, des organisations, bref de tous les phénomènes pour lesquels il y a une probabilité que des agents sociaux orientent leurs actions en fonction des actions passées, présentes ou futures des autres ».
C’est dans ce sens que créer une entreprise est une « conduite socialement significative » (Passeron, 1994). Une entreprise est créée par un ou des individus, se destine à être en interaction avec d’autres structures ou individus, en externe, mais aussi en interne à l’organisation. Le porteur de projet opère des choix, conséquent d’arbitrages en lien avec leur contexte, dont on peut se demander comment ils ont été opérés.
L’action sociale peut s’étudier par l’individualisme méthodologique
Avec la sociologie de l’acteur et plus spécifiquement du sujet, Touraine soutient que l’individu a comme volonté de se construire comme un acteur, s’opposant aux « approches théoriques ou idéologiques qui font disparaitre les acteurs au profit d’un système global » (Pleyers, 2008). Pour lui, les acteurs ne sont soumis ni à une fatalité ni à une réalité historique, mais construisent l’histoire et produisent la société. Réduire au déterminisme les actions sociales n’aide pas à comprendre la conduite sociale concrète, mais donnerait l’illusion d’une société fonctionnant sur des principes d’interprétation générale, personnifié comme rationnel utilisant des moyens au service d’une fin. Interpréter un ensemble conduirait à prendre une organisation technique, économique et sociale sur laquelle s’élève et par rapport à laquelle se définissent toutes les autres manifestations de la vie sociale, et à prendre la société comme « un mouvement, une volonté, un esprit qui la poussent à créer des richesses d’un nouveau type ou à entreprendre des aventures inouïes » (Touraine, 1965). À l’image de Touraine, dégager le sens donné ou latent par les acteurs dans leurs actions sociales, mais aussi dans les conflits peut permettre d’en discerner les enjeux. Autrement dit, « expliquer des événements singuliers, des actes sociaux concrets, n’est pas possible hors du sens que les acteurs leur donnent. » (Touraine, 1965).
INTRODUCTION |