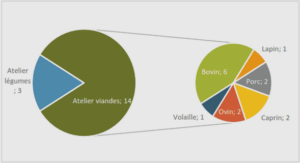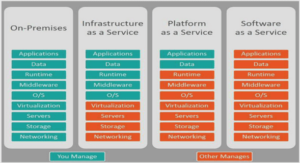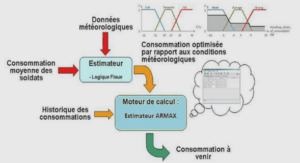Un écrivain moderne :
Les fonctions de l’écrivain, qui sont mentionnées implicitement ou explicitement au sein de la fiction n’ont pas changé dans le passage à l’ère postmoderne. L’auteur remplit un rôle cathartique, mémoriel et communicationnel-didactique.
Le premier motif pour lequel Bellatin, Bolaño et Bellatin écrivent, et plus particulièrement, se mettent en scène dans leurs œuvres, est la catharsis. Théorisée par le philosophe grec antique Aristote dans sa Poétique (335 avant J. C.), la catharsis désigne le pouvoir purificateur de la tragédie ; libérer, extérioriser les passions du spectateur à travers l’émotion que lui procurait la pièce représentée – par identification aux acteurs – (pitié, empathie, colère, peine). L’auteur postmoderne base l’acte d’écriture sur ce dessein cathartique. Écrire exercerait un effet dépuratif. Ce même effet s’applique d’ailleurs aussi bien au créateur (l’écrivain) qu’au spectateur (le lecteur). La relation qu’entretient Bolaño avec son texte est dichotomique, comme il le dénote dans son recueil d’articles, de discours et d’essais Entre paréntesis (2004) : « La literatura, supongo que ya ha quedado claro, no tiene nada que ver con premios nacionales sino más bien con una extraña lluvia de sangre, sudor, semen y lágrimas. » Par cette phrase, il lie plaisir et souffrance, en mettant en relief le caractère masochiste de l’écriture. Les substantifs « sangre », « sudor » et « lágrimas » renvoient au concept d’effort et de peine. Écrire épuise physiquement (fait suer), moralement (fait pleurer) et mène à la mort (s’empare de notre énergie vitale, le sang). Parallèlement, le substantif « semen » connote le plaisir, un plaisir sexuel et diffus. Il entretient donc également une relation érotique et euphorique avec l’acte d’écriture/de création. Quant à l’adjectif « extraña », il souligne le caractère antagonique des deux types d’approche face à l’écriture. Pour Bolaño, écrire permet d’endosser deux rôles à la fois ; celui de victime (en souffrant) et celui d’acteur (en étant (re)productif, comme l’est le sperme).
Dans le monde décadent, chaotique de Bolaño, de Bellatin et d’Enrigue, qui ne laissent de place ni à l’espoir ni à Dieu, la littérature (l’écriture) apparaît comme une panacée, comme le seul point de référence stable, un ordre établi, en somme, un refuge – que le lecteur est invité à rejoindre. Bellatin conçoit d’ailleurs son Œuvre comme un théâtre dans lequel le lecteur/spectateur pourrait donner libre cours à ses passions (« fantasías »), s’en libérer : « Siempre pensé que mi literatura era una especie de prostíbulo en el que todos podían introducirse y disfrutar, podían vivir sus fantasías.468 » L’écriture possède donc un pouvoir curatif, thérapeutique non négligeable. Le fait de recourir au même procédé que les artistes de la Grèce Antique démontre que le monde n’a pas tant évolué depuis deux millénaires. L’homme n’a toujours pas atteint l’état de plénitude et éprouve le besoin d’exorciser ses maux dans l’art.
En fin de compte, s’auto-représenter dans la fiction pour se comprendre, se trouver, se construire. Dans une société globalisée, la logique capitaliste ne parvient ni vaincre la mort qui guette l’homme, ni à combler son vide intérieur. La création incessante de nouveaux désirs – par le biais de la publicité – est une tentative vaine de nous distraire de ces préoccupations et interrogation existentielles (métaphysiques).
L’acte d’écriture s’érige comme remède et exutoire face à ce double échec en formulant les peurs, les doutes – existentiels, identitaires – qui habitent l’écrivain.
Plus qu’une mission, l’écrivain a un « devoir » mémoriel. La thématique de la mémoire est particulièrement patente dans 2666, en particulier dans « La parte de los crímenes », qui énumère pas moins de 104 féminicides commis à Santa Teresa et ses environs. La députée Azucena Esquivel Plata, partie à la recherche de son amie disparue Kelly Rivera Parker, rappelle dans l’un de ses monologues adressés au silencieux journaliste Sergio González que tout auteur remplit une mission testimoniale et mémorielle : ¿Qué es o qué quiero que usted haga?, dijo la diputada. Quiero que escriba sobre esto, que siga escribiendo sobre esto. […] Ahora no puedo sacármelos de la cabeza. Conozco los nombres de todos o de casi todos. (BOLAÑO, 2004, p. 788-789)
Le savoir (« Conozco ») engendre une responsabilité, celle de communiquer l’information, de la faire vivre. D’ailleurs, écrire apparaît comme une arme de combat, qui permet de lutter contre un fléau d’actualité. En revanche, cesser d’écrire sur le sujet rebattu des féminicides équivaut à reconnaître qu’il est résolu.
Selon la typologie fonctionnelle de la littérature élaborée par Vincent Jouve, l’on peut constater que 2666 remplit une fonction communicative. En effet, le narrateur tente de nouer dès le début un contact le lecteur. Il ne force pas la main à ce dernier et maintient une distance fictive, qu’il abolit et entretient alternativement. C’est pourquoi il s’adresse à un narrataire (indéterminé). Il incite ce dernier à l’identification en utilisant le sujet indéfini « uno » (« on ») ainsi que la première personne du pluriel (« nosotros »). Ainsi, il se place au même niveau que celui-ci et l’invite à prendre part à la fiction (en tant que juge). De plus, l’emploi du présent gnomique à valeur de vérité générale, il se présente comme un personnage universel, auquel tout un chacun peut être assimilé. C’est avec ces stratégies stylistiques et narratives qui visent à obtenir l’approbation, le soutien du lecteur, que le narrateur scelle le pacte de lecture.
Une autre fonction de communication que revêt le roman transparaît dans l’intention du narrateur d’être clair, de faire passer son message à son/ses destinataire(s). C’est pourquoi il utilise des formules de synthétisation (« En suma ») ou de synonymie (« o »).
L’écrivain postmoderne renoue avec les pratiques du Siècle d’Or – pensons au fameux Don Quichotte de Cervantès – qui tendaient à rendre le lecteur « actif » par le biais d’un jeu imposé par le narrateur, mais désormais, le lecteur n’est plus invité à être complice de l’illusion fictionnelle. Il est constamment mis à l’épreuve pour la démanteler. Le lecteur devient alors un détective (bis ?), autonome, qui doit rassembler les pièces du puzzle (de l’histoire fragmentée) pour lui donner une forme, pour résoudre l’énigme finale. Mais ce rôle ne s’arrête pas aux faits, à la trame. Le lecteur se voit conférer une fonction d’anticipation. Tout comme l’Argentin Jorge Luis Borges dans les nouvelles de Ficciones (1944) et El Aleph (1949), le narrateur postmoderne apprend au lecteur – son disciple – à décoder et « lire » la fiction par le biais d’indices qui développent son esprit de déduction et lui permettent de restituer la chronologie du récit, tout en l’incitant implicitement à se pencher sur les composants de la fiction et à s’interroger sur la manipulation qu’il subit. Bellatin confirme le versant récréatif et distractif de son écriture (un jeu ?) dans son entrevue accordée à Alejandro Hermosilla Sánchez : « En cualquier caso, la considero [la literatura] una ciencia y una diversión. También un arte y un entretenimiento. Un deporte y un mero pasatiempo.469 » De même, à la question « – Hay muchos guiños en sus libros, ¿cree que la literatura es también un juego? », Roberto Bolaño répond : Son más de los que se imaginan, porque la mayoría de mis guiños no los capta nadie. Sólo yo. Deben ser muy malos. La literatura es un ejercicio aburrido y antinatural, entonces si no te lo tomas como un juego, o también como un juego, puede llegar a convertirse en un suplicio.470
Le Chilien ne conçoit pas non plus la littérature sans jeu, sans énigmes, sans indices, sans mystères. Nos deux auteurs latino-américains partagent l’objectif de Borges, et plus encore à une époque où le matérialisme, la superficialité règnent.
D’autre part, dans une société où les relations « virtuelles » (réseaux sociaux, téléphone, mails) ont remplacé les relations « humaines », l’écrivain tente de communiquer avec son lecteur, parfois à travers de apostrophes directes destinées au narrataire : « No os lo vais a creer, pero ayer por la noche, a eso de las cuatro de la madrugada, vi en la tele una película que era mi biografía o mi autobiografía o un resumen de mis días en el puto planeta Tierra.471 », d’autres fois par le biais de narrateurs homodiégétiques qui s’expriment à la manière d’une confession :
Hace algunos años, mi interés por los acuarios me llevó a decorar mi salón de belleza con peces de distintos colores. Ahora que el salón se ha convertido en Moridero, donde van a terminar sus días quienes no tienen dónde hacerlo, me cuesta mucho trabajo ver cómo poco a poco los peces han ido desapareciendo.472 (BELLATIN, 2010)
La confession – ou journal intime – est un genre monologique en apparence, mais qui fait en réalité appel à un destinataire (un narrataire).
Les symboles de la littérature postmoderne : la tradition revisitée :
La littérature est parsemée de symboles depuis la nuit des temps. Cependant, certains d’entre eux revêtent un tout nouveau sens une fois placés dans le contexte de la postmodernité, puisqu’ils renvoient synecdotiquement à l’écriture postmoderne. Tel est le cas du labyrinthe – symbole cortazarien par excellence473 – et du mandala.
• Le labyrinthe :
Le labyrinthe, symbole rebattu, renvoie à une information disséminée partiellement par le narrateur, aux directions aléatoires et changeantes prises par les personnages, et révèle l’intention du narrateur de rendre le lecteur actif. Dans 2666, les quatre critiques de la première partie ne cessent de parcourir le monde (l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, la France…), sans pour autant atteindre leur objectif (rencontrer Benno von Archimboldi).
Le labyrinthe a une structure chaotique et infinie. Sa symbolique est presque illimitée. Il peut renvoyer par exemple à l’existence, aux différents choix que l’homme fait tout au long de sa vie, qui débouchent sur une voie sans issue ou sur d’autres chemins (ouverts). Mais il connote en sus l’astuce, la ruse (le leurre), la peur, la difficulté. Toutes ces notions trouvent leur origine dans la mythologie grecque, et plus précisément dans le mythe de Thésée, lequel pénètre dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure – créature bimorphique, mi-homme, mi-taureau –, puis finit par en sortir grâce à l’aide du fil d’Ariane, après avoir accompli sa tâche. Tout comme Thésée dans le labyrinthe, l’homme postmoderne est perdu, sans repères, il se heurte à son ignorance, à ses limitations (contre les parois du labyrinthe), il craint de ne pouvoir affronter sa pire peur – la mort – (le Minotaure).
L’époque postmoderne voit émerger une culture hybride, plurielle, reflet d’une société hétérogène et désordonnée, dans laquelle l’homme peine à trouver son chemin. Ce sentiment d’isolement est représenté symboliquement dans la fiction à travers le motif du labyrinthe. Mais la symbolique de ce dernier n’est pas si réduite. Le labyrinthe renvoie métafictionnellement à la pratique de la lecture, puisqu’il recèle un sens présent, mais voilé – que le lecteur devra saisir – et car il connote la difficulté (d’atteindre la sortie, d’en saisir le sens)
La structure labyrinthique, de l’imbrication et de l’enchâssement est mise en relief par Le Magazine Littéraire : « […] l’écrivain multiplie les récits dans le récit, établissant des passerelles entre des lieux et des époques que tout sépare474 ».
• Le mandala :
Les différentes photos (séquences) du roman de Bellatin ainsi que les nombreuses vies du protagoniste de Vidas perpendiculares, ne renvoient-elles pas au mandala, soit à la « Représentation géométrique et symbolique de l’univers, dans le brahmanisme et le bouddhisme475 » ? Chaque portion de vie, tel un pétale, une fois assemblée aux autres, finit par proposer une reconstitution du monde dans son intégralité et toutes ses dimensions – un monde morcelé, disloqué, instable, hétérogène et pluriel.
La métaphore du mandala prend tout son sens si l’on songe au fait que Bellatin a une grande fascination pour le Japon et sa culture, comme le démontrent l’empreinte japonaise de ses romans El jardín de la señora Murakami (2000), Shiji Nagaoka: una nariz de ficción (2001) et El pasante de notario Murasaki Shikibu (2011). Par ailleurs, la religion japonaise majoritaire est le bouddhisme, duquel provient le terme mandala, qui signifie « cercle » en sanskrit. Le monde est ainsi présenté par le Mexicain comme une figure géométrique ronde kaléidoscopique qui symbolise la pluralité, la circularité et la dualité – matérielle/spirituelle – de la destinée humaine.
Bien que l’ère postmoderne soit entamée, l’écrivain reste marqué par tout un héritage culturel issu de la modernité duquel il ne peut se défaire et auquel il ne veut complètement renoncer. Il en conserve d’ailleurs le patron d’écriture (les fonctions de l’écrivain) et les symboles, qu’il réactualise.
Entre fiction et réel :
Tous les écrivains caressent le dessein de créer une illusion de réalisme afin de provoquer l’adhésion du lecteur à sa fiction. Loin d’incarner l’ambition extrême des auteurs membres du mouvement réaliste français de la seconde moitié du XIXème siècle qui avait pour mot d’ordre la représentation la plus fidèle de la réalité, dépourvue de toute idéalisation, et dont les principaux représentants furent Flaubert, Balzac, Maupassant, Stendhal, Dumas et Zola –, Bellatin, Bolaño et Enrigue alternent entre l’instauration d’un semblant de réalité – une base de fiabilité – et la remise en cause de ce dernier. Ce stratagème va tout à fait dans le sens de la mission éducative fondamentale dont se charge l’auteur postmoderne.
Un ancrage réaliste :
Bellattin, Bolaño et Enrigue sont conscients de la nécessité d’émailler leur récit de référents réels – qu’ils soient historiques ou littéraires – pour que le lecteur conclue le pacte de lecture. Ainsi, dans Muerte Súbita (2013), les allusions à des personnages historiques, littéraires d’actualité et du passé sont innombrables. Y figurent, entre autres, dans un panel très hétéroclite, Felipe II, Ana Bolena, el rey Enrique, Thomas Cromwell, Jean Rombaud, Philippe Chabot, Francisco de Quevedo, el duque de Osuna, Pedro Téllez Girón, Isabel Clara Eugenia, Juana la loca, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Hernán Cortés, la Malinche, Francisco María del Monte, Felipe IV, el cardenal Del Monte, Vincenzo Giustiniani, Galileo Galilei, Carlo Borromeo, Cuauhtémoc, Moctezuma, Pío IV, el cardenal Montalto, Vasco de Quiroga, Thomas Morus.
Une réalité remise en question, démentie (contredite) :
Bolaño ne peint pas la réalité dans ses fictions. Il se sert d’éléments tirés du réel tels des personnages historiques, des écrivains contemporains, des romans et des essais plus ou moins connus du public –, certes, mais il rompt aussitôt avec cet arrière-plan « réaliste » en rappelant au lecteur la dimension cinématographique, théâtrale en somme, fictionnelle – du récit. Il s’agit de l’un des nombreux paradoxes sur lesquels se fonde l’écriture bolañesque. Dans « Las parte de los crímenes », la biographie d’Albert Kessler (p. 725-727) est un nouveau prétexte pour aborder le problème que pose la réalité remettant en question ses postulats, notamment ceux qui ont trait à sa femme : ¿La conocía o no la conocía? La conocía, claro que sí, sólo que a veces la realidad, la misma realidad pequeñita que servía de anclaje a la realidad, parecía perder los contornos, como si el paso del tiempo ejerciera un efecto de porosidad en las cosas, y desdibujara e hiciera más leve lo que ya de por sí, por su propia naturaleza, era leve y satisfactorio y real. (BOLAÑO, 2004, p. 727)
Dans ce fragment, le Chilien démontre que la réalité est insaisissable, de par son essence : elle change constamment. Elle est poreuse, s’estompe et est floue (« parecía perder los contornos »).