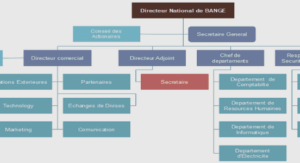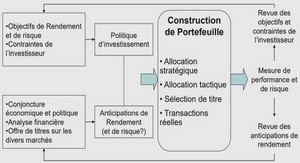La montée en compétence du consultant
La montée en compétence comme connaissance située
Les travaux sur l’apprentissage et la connaissance dans les organisations peuvent, grossièrement, être rangés dans deux catégories. D’une part, (1) une littérature abondante, inspirée par la métaphore de l’information processing (Cyert and March 1963, Huber 1991, March and Simon 1958) et par certains travaux classiques sur l’apprentissage adulte (Kolb 1984, Mezirow 1991), assimile ces phénomènes à des processus cognitifs. La connaissance y est dépeinte comme statique et résultant d’un travail intellectuel, comme quelque chose que l’on peut posséder, créer, codifier, convertir, transférer et partager (Hansen 1999, Hedlund 1994, Nonaka, 1994, Nonaka and Takeuchi, 1995). Dans cette perspective, qu’Empson (2001) qualifie de knowledge as an asset perspective, la connaissance est une empowering resource (Drucker 1994), souvent considérée comme tacite ou explicite selon le découpage proposé par Polanyi (1966). D’autre part, (2) plusieurs contributions, qu’Empson (2001) intègre cette fois dans la perspective knowledge as a process, cherchent à nuancer cette vision orthodoxe de la connaissance en la présentant comme un processus actif, collectif, situé et conditionnel (Brown and Duguid 2001, Lave and Wenger 1991). Car manifestement, tout ce que nous comprenons (ou savons faire) ne peut être expliqué en référence au savoir que nous possédons (Brown and Duguid 1998, Cook and Brown 1999, Tsoukas 1996, 2005, Wenger 1998). Ainsi, pour Lave et Wenger (1991), l’apprentissage est avant tout un processus social rendu possible par la participation à des “shared practices of knowing” omniprésentes dans les organisations. Action et connaissance sont interconnectées dans les pratiques des individus au travail (Gherardi 2000, 2001) ; l’apprentissage étant le résultat d’un engagement continu et situé des praticiens dans leur environnement. Les travaux d’Orlikowski (2002) sur les organisations high-tech géographiquement éclatées vont dans le même sens : elle y montre que la compétence des salariés ne consiste pas à appliquer de manière experte une connaissance centrée sur un domaine spécifique, mais réside dans une capacité, interactive et sociale, à partager l’information au cours d’échanges pratiques. A la logique d’accumulation des connaissances se substitue celle d’adaptation, dans la mesure où des pratiques singulières doivent en permanence être développées sur site. Et pour Lave (1993), c’est une erreur de penser, comme le font beaucoup de chercheurs sur l’apprentissage et l’éducation, que la connaissance peut être dissociée de son contexte et acquise sous forme de données purement abstraites ou d’approches universellement applicables. Cette conception résolument pratique de la connaissance multiplie les ponts avec différentes contributions qui soulignent la dimension matérielle de l’apprentissage situé et des phénomènes cognitifs. Ainsi, pour n’en citer que quelques-uns, les travaux de Goody (1979) sur la raison graphique, les développements multiples de la théorie de l’Acteur-réseau (Callon 1986, Latour 1987, 2005) ou encore les théories de la cognition distribuée (Suchman 1987, Hutchins 1995, Hutchins et Klausen 1996), ont contribué à incarner les phénomènes de connaissance dans un monde d’objets. Le mouvement est parfaitement logique : si l’on bascule d’une vision cognitiviste du savoir à une prise en compte de sa pratique située, l’attention se porte naturellement vers les artefacts qui peuplent, agencent et performent les pratiques des individus. La connaissance devient le produit ou l’effet d’un réseau d’actants hétérogènes, humains et non humains, qui composent les organisations (Law 1992, Latour 2005). En matière d’apprentissage, ce sont sans doute les technologies intellectuelles et littéraires qui sont les plus répandues et dont le rôle est déterminant. Elles permettent de dépasser les limites inhérentes aux mécanismes de l’intellect par la mise en ordre, la stabilisation et le stockage des données cognitives (Goody 1979). Leur fonction est également sociale : elles servent de support à l’interaction en canalisant les comportements (Cooren 2004) et en assurant le partage de schémas cognitifs (Werr et Stjernberg 2003). Les travaux 261 récents d’Orlikowski (2005, 2007) plaident également pour une meilleure prise en compte de la matérialité dans l’étude des organisations et des pratiques de connaissance (knowledgeable practice) qu’on y observe. L’auteur propose ainsi d’enrichir ses travaux précédents : “a practice view of knowledge (Orlikowski 2002) leads us to understand knowing as emergent (arising from everyday activities and thus “always in the making”), embodied (as evident in such notions as tacit knowing and experiential learning), and embedded (grounded in the situated socio-historic context of our lives and work). And to this list I want to add another critical dimension, and that is that knowing is also always material (Orlikowski 2005, p.2, emphase dans le texte)”. Elle introduit notamment la notion d’échafaudage de la connaissance (scaffolding human knowledgeability) pour comprendre les dispositifs, temporaires et portables, qui permettent de faire tenir ensemble des éléments composites et émergents dans une logique générative. Notre analyse de la montée en compétence des consultants relève de ce second courant, d’inspiration pragmatiste, qui fait de la connaissance une pratique hybride et située. Nous considérons donc qu’au lieu de prendre comme point de départ l’expertise du consultant, pour en étudier les ambiguïtés et les ressorts langagiers, il est intéressant de se pencher sur ce que font les professionnels et d’investiguer les mécanismes concrets qui permettent leur montée en compétence. Nous nous penchons ainsi sur les ressorts actifs de l’apprentissage des consultants, sur les multiples appuis qui leur permettent de circuler dans des environnements nouveaux. Ces appuis sont cognitifs, sociaux, matériels ; ils sont mobiles et intriqués, ils se découvrent dans l’action. En privilégiant une approche ethnographique, nous cherchons à poser un regard nouveau sur une problématique au demeurant bien connue de la littérature en management. Car les consultants sont d’illustres représentants de l’économie de la connaissance et des knowledge workers (Starbuck 1992, Alvesson 1993) qui la peuple. Leur rôle, en tant que producteur et pourvoyeur de connaissance dans les organisations, a largement été investigué. Ainsi, Canato et Giangreco (2012) proposent une typologie de ces rôles autour de quatre figures : information source (Abrahamson 1991, Brown et Eisenhardt 1997), standard setter (Sturdy 2009), knowledge brokers (Hargadon 1998, Werr et al. 1997, Werr and Stjernberg 2003, McKenna 2006) et knowledge integrators (Bessant and Rush 1995, Tyre et Von Hippel 1997). Néanmoins, dans ces études, la connaissance est surtout considérée comme une ressource du consultant, une donnée statique acquise à l’extérieur de l’organisation cliente, qu’il s’agit de fournir, de disséminer, d’intégrer ou de transférer.
Enjeux et paradoxes de la montée en compétence des consultants
La vignette ethnographique suivante relate un échange entre Thomas97 et son manager de ConsultCorp au cours d’une réunion de coaching. Elle capture, en quelques lignes, les principaux enjeux de la montée en compétence, par une formulation qui nous semble particulièrement juste. Dans cet extrait, Thomas commence par exposer à son coach les difficultés rencontrées au cours de sa mission : 97 Comme précisé dans le chapitre méthodologique, Thomas est le pseudonyme utilisé par l’auteur. 263 Lorsque [mon coach] me demanda comment j’avais vécu ma mission, je lui répondis la chose suivante : « maintenant je peux dire que ça s’est bien passé, mais sur le coup c’était difficile ». Je lui fis ensuite part de ma perception de la « montée en compétence », selon le terme consacré, et de cette difficulté, de cette fébrilité qui caractérise le consultant tenu à produire très vite de la valeur. Je conclus la discussion par cette remarque : « en tous cas, si je devais le refaire aujourd’hui, je ferais les choses différemment ». Il me répondit : « voilà une remarque de consultant. Tu es arrivé dans un environnement inconnu, tu as appris quelque chose, tu en as tiré des conséquences et des axes de progrès pour l’avenir. C’est tout notre métier […] ». (Notes de terrain, mars 2010) On perçoit d’emblée ici la tension qui structure la montée en compétence des consultants. Les clients attendent de ces derniers qu’ils fassent tout de suite une différence par leur contribution, quand bien même les professionnels découvrent les ressorts du système-client98 et de la situation dans laquelle ils doivent intervenir. De cette tension naît une posture particulière d’apprentissage dont la difficulté est largement admise (Sturdy 1997, Czarniawska et Mazza 2003). Ainsi, dans cet extrait, Thomas fait remarquer qu’il est parvenu à s’en sortir mais que s’il débutait aujourd’hui sa mission il « ferait les choses autrement ». Ce à quoi le manager répond, assez paradoxalement, « voilà une remarque de consultant ». Cette capacité à apprendre en faisant, à monter en compétence « sur le tas », par essais et erreurs, au contact de problématiques singulières, semble donc être perçue comme étant caractéristique de l’activité. Le manager se livre ensuite à un long exposé au cours duquel il décrit de manière à la fois très libre et, à notre sens, très juste, les principaux enjeux de la montée en compétence : [Manager] : C’est pour ça qu’il faut aborder les choses avec humilité. Une humilité qui dit : votre métier, je n’y connais rien, alors je ne vais pas essayer de vous apprendre la vie. Par contre, tu es en droit de dire, j’ai bien pris le temps de vous écouter, j’ai bien pris le temps de vous poser des questions, alors maintenant je vais vous dire ce que j’en pense, vous donner une pensée extérieure, nouvelle. Il faut toujours privilégier une approche de prise de recul et surtout poser des questions ouvertes […]. Il y a toujours une phase de tâtonnement, mais il faut la réduire au maximum […]. Entre nous, il faut quand même donner le moins possible 98 Sur la notion de client dans le conseil voir Alvesson et al. (2009), Schein (1997), Arnaud (1998). 264 l’impression que tu ne comprends rien parce que le client ne va pas trop aimer, au prix que tu lui coûtes. Si sur une mission d’un mois il y a un jour où tu n’apprends pas, t’es mort. Non, il faut arriver avec son humilité, poser des questions ouvertes et avoir un petit glossaire. Tu te mets dans une position d’écoute active, tu vas pouvoir capter des trucs que tu as vu ou entendu, mettre en forme l’existant, comparer ensuite, poser des questions au cabinet, aller voir sur Wikipédia même. Et tu vas voir qu’en très peu de temps tu vas parler comme tes clients, être comme tes clients. Mais le but, attention, ce n’est pas d’être comme eux, c’est d’être légitime et de pouvoir expliquer pourquoi. (Ibid.) Là encore, le propos peut sembler déroutant tant les paradoxes sont nombreux. Le consultant « n’y connaît rien » mais doit être capable de proposer une pensée « nouvelle » ; le consultant écoute ses client pour finir par « parler comme eux », tout en gardant une « position de recul » et en conservant à l’esprit que son but n’est pas d’être comme eux, « mais d’être légitime et de pouvoir expliquer pourquoi ». Les tensions entre extériorité et intériorité, entre compétence et crédibilité sont explicites. Ainsi, le manager commence par pointer l’extériorité structurelle du consultant et ses conséquences en matière de compréhension du contexte. Par définition, et quel que soit son niveau d’expertise, le consultant est ignorant du contexte en comparaison des internes qui demeurent sa première source d’information. Mais cette source à un statut particulier : elle sert à produire un décalage. Inutile pour le consultant de savoir autant ou mieux que les internes, il doit savoir autrement. Il ne s’agit pas tant d’apprendre en détail les caractéristiques d’un environnement que de le comprendre a minima pour produire une pensée nouvelle, pour proposer un éclairage différent. Selon les propos du manager, la compétence du consultant ne consiste pas à savoir mieux, mais à savoir différemment. L’extériorité est présentée ici comme une opportunité de nouveauté. Pour cela, la prise de recul, la capacité à poser des questions ouvertes et surtout l’humilité sont mises en avant, comme un écho à cette remarque que fait Schein (2001) de manière un peu provocatrice : « humility and ignorance [is] what it takes to be an effective process consultant ». Le manager explique ensuite à Thomas, « entre nous », comme s’il s’agissait d’une remarque de back office, la tension entre compétence et crédibilité qui structure la montée en compétence. Apprendre sur le tas est une épreuve au cours de laquelle les consultants doivent 265 faire attention à ne pas se discréditer. On touche là une forme de « management des impressions » (Clark 1995, Clark et Fincham 2002, Clark et Salaman 1998), largement thématisée dans la littérature critique, et qui fait, semble-t-il, partie intégrante de la pratique. Les stratégies cognitives d’apprentissage et les stratégies plus sociales de production de la légitimité du praticien sont indissociables. Et il est indispensable pour le consultant de parvenir, en toute bonne foi, à donner le sentiment qu’il est en maîtrise, qu’il comprend ce qu’on lui demande, quand bien même ce n’est pas le cas. Après quoi, en passant, le manager précise les multiples opérations sociocognitives, les appuis matériels qui permettent la montée en compétence, depuis les techniques de captation jusqu’à la capacité de mise en forme, en passant par la mobilisation du collectif interne et le recours à différentes bases de données ou outils internet. Nous reviendrons sur ces éléments au cours de la discussion. A ce stade, il est intéressant de noter que l’humilité d’entrée qu’il préconisait laisse la place à un comportement actif et outillé de compréhension et d’action sur la situation.