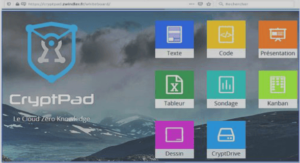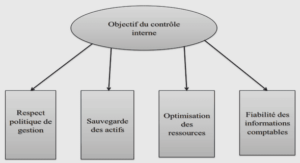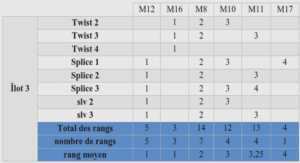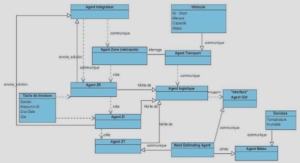Fonction des émotions dans l’apprentissage : hypothèses de recherche
Nous cherchons à saisir les émotions à partir et dans le flux incessant des interactions entre les sujets et leur environnement. Ce flux continu peut être considéré comme une sorte de « toile de fond » permanente à partir de laquelle nous cherchons à en identifier certaines variations. Les émotions que nous avons mis en objet peuvent être, de ce point de vue, considérées comme des variations mêmes de flux, s’en détachant temporairement, s’incarnant dans les comportements des sujets qui en sont la proie et orientant leurs activités dans un sens pas forcément prévu au départ des activités en cours. C’est le rapport entre surgissements d’émotions au travail et induction de réorientations d’activités en cours vers un processus d’apprentissage que nous cherchons à caractériser.
Les émotions, telles que nous venons de les désigner dans la reformulation de l’objet de recherche, sont donc envisagées du point de vue des fonctions qu’elles accomplissent dans la situation tutorale au travail dans une visée formative. Nous présentons ci-dessous les hypothèses de recherche du point de vue donc de la dimension fonctionnelle des émotions.
Les hypothèses sont présentées en deux volets étroitement articulés entre eux, « ce que les émotions font aux sujets » et « ce que les sujets font des émotions (de ce qu’elles leur font) ». Ces deux volets correspondent aux deux principales et successives phases enchevêtrées entre elles, de ce que nous pouvons appeler la progression dynamique temporo-affective en lien avec le processus d’apprentissage en situation tutorale.
Fonction des émotions sur les sujets
Nous avons appelé ce premier volet « fonction des émotions sur les sujets » pour désigner l’emprise temporaire que les émotions exercent chez tout sujet qui les vit. De façon plus pragmatique, nous pouvons également appeler ce premier volet « ce que les émotions font aux sujets » par distinction avec le deuxième volet présenté plus bas et que nous avons appelé tout aussi pragmatiquement « ce que les sujets font des émotions ». Cette formulation cherche à désigner l’arrachement nécessaire, d’une manière ou d’une autre, des sujets à l’emprise émotionnelle, et ce qui nous intéresse, vers une possible visée formative.
Concernant tout d’abord le premier volet, les émotions ont donc une caractéristique forte, soulignée dans la partie théorique, elles surgissent chez le sujet, sans que ce dernier qui en est la proie, ne puisse s’y soustraire délibérément, en tout cas dans un premier temps. En effet, l’emprise émotionnelle se caractérise par une forte intensité qui ne peut être éprouvée, vécue par le sujet que sur un très court laps de temps.
Comme vu plus haut également, les émotions ne sont ni « neutres » ni anodines. Confrontés à une même situation, deux sujets peuvent vivre des émotions diverses et variées, voire strictement contraires. Tout se passe comme si les émotions pouvant être identifiées chez un sujet singulier témoignait non seulement d’une « lecture » personnelle de la situation, mais surtout de son impossibilité ou difficulté temporaire à la « lire » comme à l’accoutumée.
De la même façon, les émotions qui surgissent chez le stagiaire investissant un espace de travail pour l’apprendre avec un tuteur, peuvent être associées à une difficulté à poursuivre son investissement en cours autour d’une tâche de travail singulière pour ce sujet. Il est par conséquent possible d’avancer l’hypothèse selon laquelle nous pouvons identifier un rapport entre les émotions, « en faisant ce qu’elles font au sujet », et l’émergence simultanée d’un apprentissage possible à caractère fondamentalement personnel, c’est-à-dire un apprentissage qui compte pour le sujet au regard de l’ensemble de son expérience, et qui lui est signifiant.
Dans cette perspective, nous proposons la formulation des premières question et hypothèse de recherche de la manière suivante :
• Question de recherche1 : en quoi les émotions générées dans et par l’espace de travail contribuent-elles au processus d’apprentissage ?
• Hypothèse de recherche1 : dans l’espace de travail, les émotions remplissent une fonction de révélateur de moments d’apprentissages signifiants pour les interactants.
Dans ce premier volet, les émotions dont il est question et à identifier, sont plutôt celles de l’espace de travail. En effet, elles surgissent autour et à l’occasion d’une tâche de travail donnée. Les émotions nous semblent concerner plus directement le stagiaire qui les subit, mais précisons encore que même si les émotions sont identifiées chez celui-ci, elles naissent de la situation tutorale au travail. L’unité d’analyse du point de vue méthodologique est donc bien l’interaction tutorale.
Dans le deuxième volet qui suit, les émotions dont il est question et à identifier, sont plutôt celles de l’espace de formation. Suite à leur surgissement, les émotions sont en effet fonctionnalisées par les interactants selon des modalités qui peuvent être diverses. Bien entendu, la modalité qui retient tout particulièrement notre attention est la modalité formative.
Fonctionnalisation des émotions par les sujets
À l’instar de la désignation du premier volet, nous avons appelé ce deuxième fonctionnalisation des émotions par les sujets » pour désigner la reprise possible d’une certaine forme de contrôle par les sujets sur les émotions qui ont surgi et sur lesquelles, jusqu’à ce moment-là, ils n’avaient aucune maîtrise.
Les émotions sont, dans cette seconde phase, en quelque sorte « instrumentalisables » par les interactants. De façon plus pragmatique, nous pouvons donc également appeler ce deuxième volet « ce que les sujets font des émotions », et nous pourrions compléter pour insister sur le lien avec la première phase, « ce que les sujets font des émotions de ce qu’elles leur font ».
L’accent est donc mis ici sur l’installation d’un régime d’activité spécifique induit par les émotions et propre à elles, dès lors que celles-ci se sont manifestées au décours de l’interaction tutorale selon les deux phases que nous avons distinguées plus haut, ce que les émotions font aux sujets et ce qu’ils en font (peuvent ou veulent en faire).
En effet, le destin des émotions est connu : leur naissance, en général rapide et brusque, appelle inévitablement leur extinction, après une progressive décroissance. Du coup, il est possible de penser qu’elles produisent et soumettent à leur tempo propre durant cet intervalle temporel, et selon les phases indiquées ci-dessus, les autres activités en cours.
Cette considération a une conséquence intéressante nous semble-t-il, dans la construction d’un modèle méthodologique que nous sommes amené à proposer pour rendre compte des modalités de ruptures opérées par les émotions dans les activités investies et en cours par les interactants. La question que nous sommes amené à nous poser est donc en quoi « ce que font les sujets des émotions de ce qu’elles leur font » peut s’inscrire dans un processus d’apprentissage pour le stagiaire dans son interaction avec le tuteur ? Dans le chapitre précédent, nous avons pu distinguer les interactions tutorales de travail des interactions tutorales formatives, distinction jamais complètement tranchée tant les deux types d’interaction s’enchevêtrent en permanence.
Nous proposons plus bas des indicateurs qui permettent donc seulement, à partir d’« arrêts sur image » d’identifier en l’occurrence des interactions de type formatives qui résultent, nous semble-t-il, de l’endossement réciproque par tuteur et stagiaire de rôles davantage orientés vers des processus de formation – positionnements formatifs – que vers des processus de travail au décours de leurs interactions. Cette reconnaissance mutuelle des positionnements respectifs par les tuteurs et stagiaires ouvrant par conséquent l’espace de formation à partir de l’espace de travail comme vu plus haut.
Dans ce deuxième volet, les émotions dont il est question et à identifier, sont plutôt bien celles de l’espace de formation. Dans cette perspective, nous proposons la formulation des deuxièmes question et hypothèse de recherche de la manière suivante :
• Question de recherche2 : Dans quelle mesure l’interaction fait-elle ressource formative du point de vue de ce qu’elle permet du traitement des émotions ?
• Hypothèse de recherche2 : Au décours du déploiement émotionnel, l’émergence d’apprentissages possibles est associée à l’adoption de positionnements formatifs réciproques que tuteur et stagiaire se reconnaissent mutuellement.
Sur le plan méthodologique, nous sommes amené à identifier, d’une part les changements de régimes d’activités d’interaction sous l’impulsion puis l’instrumentalisation des émotions par les tuteurs et stagiaires. D’autre part, identifier en quoi et comment certaines configurations dyadiques tutorales peuvent être désignées de formatives.
La partie qui suit est consacrée au dispositif méthodologique de la recherche, et dont nous présentons dans un premier temps, les modalités de constitution de l’échantillon retenu et les modalités choisies pour recueillir les données.