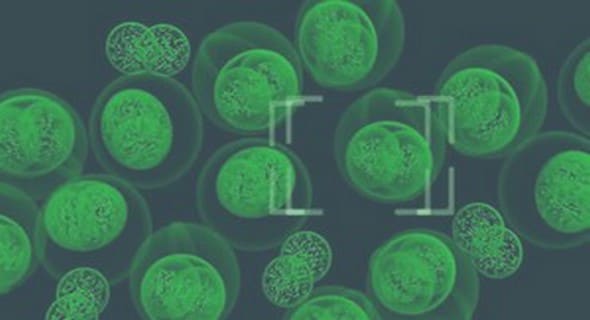Les fractures de l’extrémité distale du radius sont des lésions traumatiques fréquentes. Classiquement, elles touchent la femme de plus de 60 ans ostéoporotique. De nos jours, le sujet jeune actif se voit de plus en plus concerné. Il est bien connu que les fractures du raduis distal sont très courantes et que le choix du traitement peut entrainer des séquelles anatomiques et fonctionnelles indissociables, parfois lourdes de conséquences économiques ou sociales(9). Les méthodes d’ostdosynthèse sont nombreuses et toutes ont fait leur preuve. Le traitement est de plus en plus chirurgical, permettant une réduction la plus anatomique possible, en particulier la longueur de la métaphyse et l’orientation de l’épiphyse radiale(8). A propos d’une série homogène prospective de 379 cas de fractures du raduis distal colligées sur 22 ans au service de chirurgie Orthopédique aile 4 du CHU Ibn rochd et de l’hôpital ibn tofail de Marrakech, traitées par embrochage de py . A travers l’analyse de cette série, notre but est de contribuer à l’évaluation des résultats de ce type d’ostéosynthèse et de préciser ses indications éclectiques parmi les autres méthodes d’ostéosynthèse. Aussi, à travers cette expérience, nous nous proposons, de rapporter les détails de cette technique, en précisant au passage plusieurs « trucs et astuces » et quelques évolutions de la technique de py.
La plupart des auteurs; E. Lenoble (4), TH. Judet (11), L. Kerboull (12) rapporte une prédominance féminine chez les sujets âgés. L’âge dans la plupart des séries se rapproche de 60 ans. La moyenne d’âge dans notre série rejoint celle des séries marocaines de T. Fikry (13), L. Kerboull (12) et A. Lahtaoui (14). La jeunesse de la population marocaine explique l’âge jeune de notre série. La prédominance de l’atteinte du sexe masculin chez les patients jeunes de moins de 50 ans peut s’expliquer par la fréquence des accidents à haute énergie.
Comme le soulignent la majorité des auteurs, la chute de sa hauteur est la cause la plus retrouvée.
Nous avons noté la fréquence de l’atteinte du côté gauche (61,74%) par rapport au côté droit (38,25%) qui peut s’expliquer par le réflexe qu’ont les patients d’exposer la main gauche pour protéger la main droite.
Le mécanisme le plus rapporté par nos patients était indirect par chute sur la main en hyperextension (70,83%), ce qui est également rapporté par la majorité des auteurs. Plusieurs théories ont été proposées pour décrire le mécanisme de cette fracture :
Théorie de l’écrasement-tassement
GOYNAUD, NELATON et DUPUYTREN(100) furent les premiers à défendre cette théorie qui a été par la suite remise en relief par DESTOT (15), il considère le poignet comme une enclume sur laquelle vient s’écraser le radius.
Selon LEWIS (11), le radius est considéré comme une poutre en console . Mais toutes les théories soulignent l’importance des forces de compression et la perte de substance osseuse qui en résulte au niveau de la corticale postérieure, en particulier chez les sujets âgés et ostéo-porotiques. Cette communition est responsable d’une chambre de jeu des broches intrafocales (kapandji) et responsable de la tendance à l’ascension épiphysaire après traitements non verrouillés. Théorie de LEWIS (11) : La chute se faisant sur le poignet en extension, il s’y associe toujours une pronation (chute en avant) ou une supination (chute en arrière) de même qu’une inclinaison généralement radiale. L’obliquité de l’axe de l’avant bras par rapport au sol rend compte de diversité des fractures et conditionne le déplacement dans le plan antéropostérieur et transversal.
De très nombreuses classifications ont été proposées, elles sont basées sur l’analyse des clichés radiographiques en face et en profil. Une classification idéale répond à trois objectifs :
– Décrire la lésion, dont sa sévérité.
– Servir de guide pour un traitement approprié.
– Porter un pronostic fonctionnel.
Elle doit en plus être fiable et reproductible (19,23) Selon Dumontier(22), aucune classification ne répond en fait à ces trois critères réunis et présente des limites. Dans notre étude nous avons utilisé la Classification de Cooney dite universelle COONEY (28) distingue les fractures extra-articulaires ou articulaires d’une part et les fractures stables ou instables d’autre part. Le critère de stabilité est le maintien de la position après réduction orthopédique, ce qui est loin d’être précis. La description des traits fracturaires est vague, le sens du déplacement n’est pas étudié et des fractures différentes sont classées dans un même groupe, ce qui affiche à cette classification un caractère trop simpliste même si l’ambition de l’auteur est de procurer un algorithme thérapeutique.
Bowers (30), insiste sur la nécessité d’évaluer dans les fractures du poignet l’atteinte du secteur ulnaire indépendamment du secteur radial, et il distingue les déplacements minimes de la styloïde ulnaire des déplacements modérés ou sévères, ces derniers comportent selon lui, des dégâts constants du complexe fibro triangulaire et doivent être considérés comme des avulsions fractures des ligaments de la partie distale du radius.
Pour Fontes(26), une analyse systématique des lésions potentielles du versant ulnaire, est ainsi indispensable que celle du versant radial, en matière de fracture du poignet, puisqu’elles pourront mettre en danger la stabilité du poignet et une fixation de la styloïde ulnaire est préconisée avec la recherche des lésions Ligamentaires.
CASTAING (9) les classes sous le nom de « dérangement interne du poignet ». LEWIS (10) démontrait expérimentalement qu’une chute en hyperextension du poignet engendre un double phénomène de compression voire de tassement postérieur du radius et d’étirement des structures ligamentaires antérieures qui finissent par se rompre. GEISSLER et FERNANDEZ (32) ont essayé de quantifier le déplacement de l’extrémité distale du radius susceptible d’engendrer des lésions ligamentaires de la radio-ulnaire distale, ils concluent qu’une bascule dorsale de 28°, une translation dorsale de 5,8mm ou un raccourcissement de 2,7mm sont le maximum tolérable pour le ligament triangulaire qui se rompt au-delà.
INTRODUCTION |