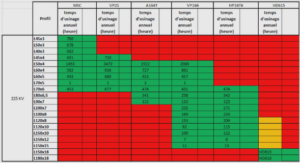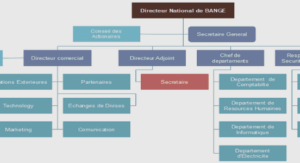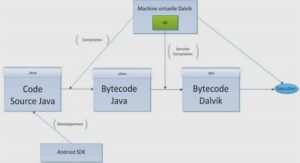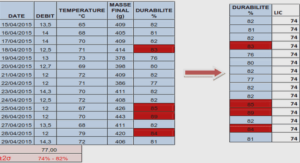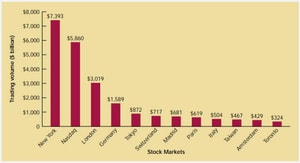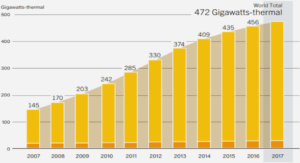La dimension heuristique de la comparaison
La comparaison a tôt été assimilée à un processus qui avait presque valeur d’expérimentation, censée donner à la sociologie autant de légitimité qu’aux sciences naturelles. Même en quittant ce postulat positiviste, de nombreux chercheurs soulignent les vertus de la posture comparative dans la production de connaissances. Elle peut par exemple stimuler l’imagination du chercheur, susciter des questionnements, permettant ainsi à la fois de traiter de nouveaux problèmes et de générer des hypothèses. Ce processus se base sur la confrontation à l’altérité, une « (…) mise en regard explicite, dans la quête tant de ressemblances que de différences21 ». Comme l‘indiquent également Michèle Dupré et ses collègues dans un ouvrage dédié aux stratégies de comparaison internationale, il s’agit d’une épistémologie fondamentalement dialectique, qui fait de l’altérité un moteur « en vertu de laquelle la négation de Soi par confrontation à l’Autre reste un moyen privilégié de la connaissance du Même22 ». Cette posture épistémologique permet ainsi de prendre de la distance vis-à-vis de son propre contexte culturel et de « dénaturaliser » des phénomènes. Cécile Vigour désigne cela sous le terme de « rupture épistémologique », à la fois vis-à-vis du sens commun, des prénotions et des schèmes d’analyse propres à la culture du chercheur, qui permet d’en apprendre autant sur l’autre que sur soi-même. La comparaison, en cassant les évidences et en démontrant que les phénomènes sociaux qui peuvent passer pour « naturels » sont en réalité construits, permet d’appréhender la spécificité de la situation française, que le manque de recul empêche d’entrevoir23.
Le statut du comparatiste se situe entre distance et proximité, comme ce que décrit Simmel dans sa « digression sur l’étranger24 ». La distance offre une certaine liberté dans le regard et le jugement ; la proximité rend possible la compréhension. Allier ces deux pôles doit donc être la « posture idéale » de tout chercheur. Toujours dans le cadre de notre étude, notre proximité avec l’Allemagne est une proximité physique, du fait de l’emplacement de notre université qui se situe presque directement à la frontière25, mais également une proximité culturelle et intellectuelle de par notre maîtrise de l’allemand et notre connaissance de la littérature scientifique. Ces proximités rendent possible une compréhension, sans toutefois nous aveugler ; nous gardons une distance critique et ne tenons aucun discours « messianique » sur l’Allemagne et ses performances.
Le chercheur souhaitant initier une recherche comparative peut se rattacher à différentes traditions de recherche, induisant des postulats de départ et des démarches différentes. Celles-ci se distinguent par leur positionnement vis-à-vis de la culture. Commençons d’abord par définir ce concept, avec l’aide de Bernard Lamizet26 :
On désigne par le concept de culture l‘ensemble des médiations symboliques des représentations de l‘appartenance sociale : la culture est ce qui se partage, ce qui constitue un patrimoine commun de représentations en quoi se reconnaissent les sujets qui revendiquent la même appartenance sociale et symbolique.
Selon Marc Maurice les recherches fonctionnalistes, ayant pour objectif d’identifier des universaux » en étudiant les « fonctions » des items culturels, postulent une forte continuité et donc une comparabilité assurée entre ces phénomènes d’un espace national à l’autre. Les chercheurs relevant de cette posture, en adoptant un point de vue généraliste, peuvent avoir des difficultés à expliquer les différences qu’ils observent sur le terrain. D’autres approches, qu’il qualifie de « culturalistes27 » (on les désigne aussi sous le terme « cross-national »), prennent également la culture pour objet d’étude. Elles comparent les cultures en les simplifiant et en les réduisant à des variables contrôlables mathématiquement, afin de réduire leur complexité28. La catégorisation que proposent ces approches « culturalistes », si elle apporte des éléments exploratoires, a le défaut de tendre à l’essentialisation des cultures et donc au renforcement de stéréotypes. Selon Stefanie Rathje29, elles permettent peut-être de décrire des valeurs, mais pas de comprendre les cultures. La dichotomie des indices30 est problématique car simplificatrice. L’orientation individualiste et collectiviste peut par exemple exister au sein d’une même culture, en l’occurrence en Thaïlande, terrain de son étude et seule une analyse approfondie des représentations et des valeurs peut en produire une connaissance.
La problématique de départ dans l’étude menée par Marc Maurice et ses collègues était la différence d’écart salarial entre ouvriers et non-ouvriers, l’Allemagne ayant (apparemment) de moindres écarts salariaux31. Ils s’interrogent alors sur les relations entre système éducatif et système productif, donc entre la socialisation des acteurs et l’ensemble des faits d’organisation du travail. Leurs travaux soulignent la place et la légitimité accrue de la formation professionnelle en Allemagne, qui en RFA concerne alors la moitié d’une classe d’âge. Cette formation s’effectue sur le mode de l’alternance entre l’école et l’entreprise. En France, où l’enseignement général est plus valorisé, l’enseignement professionnel ne fait pas l’objet d’une compétition sociale, mais est plus souvent utilisé par les catégories d’élèves n’ayant pas accès l’enseignement général32. Ils observent alors que la combinaison des facteurs qui produisent ces décalages constituent des « cohérences structurelles », pensées « comme le fruit d’interdépendances entre les acteurs du système de formation, du type d’organisation productive et des relations sociales et professionnelles »33. Pour identifier ces « cohérences », l’analyse sociétale préconise une démarche inductive, ouverte à « comparer l’incomparable », mobilisant des outils empiriques, c’est-à-dire des études de cas et des analyses statistiques. D’après Marc Maurice, pour comparer efficacement, il faut revenir au social, processus à la source des valeurs, représentations ou normes culturelles en vigueur dans chaque pays. L’analyse sociétale articule acteurs et société sans donner la prééminence à l’un ou à l’autre :
• Les catégories et les dimensions d’analyse entrent en cohérence entre elles dans la mesure où elles sont conceptualisées comme éléments d’une société. C’est là, la signification première de l’effet sociétal34 ». Le choix des dimensions et catégories d’observation fait partie de la démarche même. L’analyse sociétale a permis de dépasser la tentation de mettre à jour des facteurs culturels » explicatifs des nombreuses différences d’organisation existantes et d’en dégager d’autres, en l’occurrence les éléments institutionnels structurant le contexte national.
Une première critique de l’analyse sociétale est formulée par Jean-Daniel Reynaud, pour qui la recherche de cohérences stables et représentatives du cadre national, privilégié dans l’analyse sociétale, est questionnable ; il n’y aurait pas de « cohérence structurelle nationale » mais des ordres locaux. Il formule une théorie de la régulation sociale proposant une analyse des modalités de régulation structurant les rapports sociaux. Il se défait ainsi du postulat de l’unité de la société pour privilégier une vision « contractualiste », issue de la pluralité et de l’opposition des acteurs sociaux constamment en négociation et en compromis35. Un deuxième courant de critique s’articule autour du concept de culture, évacué par les fondateurs de l’analyse sociétale, critiques et méfiants à son égard. Philippe d’Iribarne propose une « réinterprétation culturelle » des éléments présentés par Marc Maurice et ses collègues. Il considère la culture comme « questions de représentations, de sens, de valeurs, de traditions ancrées dans l’Histoire36 ». Il s’appuie notamment sur les analyses de Norbert Elias pour démontrer les différences dans les modes de structuration de la société et leur influence respective sur les valeurs qui marquent chaque pays37 » et en conclut que « la vie en société fait concourir une révérence pour des traditions qui demeurent avec une capacité à inventer et à créer ». Le culturel n’est pas un « vernis », mais imprègne de manière profonde les comportements et les attitudes, constitutif des relations sociales. Philippe D’Iribarne opère une synthèse entre une approche considérant les institutions comme des constructions sociales et une prise en compte de la culture et des traditions dans ce processus de construction, car « la prise en compte de la dimension culturelle des modèles nationaux permet de mieux comprendre les « structures » comme une « cristallisation organisationnelle » des « rapports sociaux38 ». Ces structures sont produites et négociées sur le temps long. Comme l’indique l’anthropologue Dominique Desjeux, « la culture est à la fois une structure et une dynamique, c’est ce qui rend son analyse et son observation si difficile39 ». Elle est dynamique car soumise au changement et à l’histoire » qui la font évoluer. La culture n’est pas une essence figée ; sa stabilité apparente relève surtout de la longue durée historique. Ce n’est pas une « chose » transcendante qui existerait en-dehors des individus et déterminerait leur comportement, il n’y a pas « d’influence magique qui fait perdurer un déterminisme devenu fatalisme40 » ; au contraire, les acteurs sociaux participent activement à son maintien et à l’invention de nouveaux éléments.
Une deuxième génération de travaux inspirés de l’analyse sociétale, dans les années 1990 et 2000, en a renouvelé les objets ainsi que les terrains, bien que le cadre national reste privilégié. L’action publique, « porteuse d’un « intérêt général » dont la définition est la résultante de compromis entre des conceptions différenciées41 », est notamment devenue un nouveau chantier. Le niveau régional est réhabilité comme espace de coordination de l’action collective, traversé de tensions entre le niveau national voire supranational et des arrangements locaux : les cohérences sociétales ne se « bouclent pas nécessairement au niveau national42 ». En tant que démarche inductive, étudiant les choix d’acteurs et les différentes contraintes pesant sur ceux-ci43 ainsi que le rôle régulateur des institutions, l’analyse sociétale nous paraît la démarche la plus appropriée pour ce travail. Nous recourons à une analyse sociétale actualisée voire revisitée, enrichie des critiques et développements susnommés, prenant en compte les développements historiques et les contextes politiques. Le rôle des instances de régulation internationales, au premier lieu l’Union Européenne, ainsi que les niveaux intermédiaires de régulation, par exemple régional – d’autant plus dans le cadre de l’Allemagne fédérale où le pouvoir central compose avec des centres politiques régionaux – est exploré dans ce travail.
Justifions d’emblée notre choix d’une comparaison franco-allemande. Il a tout d’abord été le fruit d’un intérêt personnel pour ce pays, développé au cours de plusieurs séjours de longue durée et d’une pratique régulière de la langue. Ensuite, nous avons fait intervenir des considérations pratiques : la proximité géographique de l’Allemagne facilitait le travail de terrain ; nous avons pu avoir accès à des bibliothèques universitaires germanophones, à Bâle par exemple, ainsi qu’à l’université pédagogique (pädagogische Hochschule) de Ludwigsburg ; des ouvrages en allemand sont disponibles au sein de l’Université de Strasbourg. Ces conditions nous ont permis d’élaborer un cadre théorique bilingue44. Ce choix était ensuite logique compte tenu de l’emplacement de notre université. Mulhouse se situe en effet dans le Dreiländereck (triangle des trois nations), entre la France, l’Allemagne et la Suisse. Les projets de recherche comparative y sont fréquents et notre université dispose de structures favorisant le travail interculturel et transfrontalier45.
Avant de débuter notre travail comparatif, nous avons tenté d’identifier les biais qui, issus des catégories de pensée mentionnées plus haut, pourraient faire frein à une pleine compréhension de la situation allemande. Il fallait pour cela être consciente des différences institutionnelles et politiques entre les deux pays, le risque étant de projeter sur l’Allemagne les spécificités d’un système centralisé et par exemple de surestimer le rôle de la Conférence permanente des ministres et sénateurs en charge de l’éducation (Kultusministerkonferenz, ou KMK46). Comme l’indique Cécile Vigour, « le comparatiste doit éviter au maximum de projeter ses attentes, de considérer comme point de référence les catégories de pensée propres à son éducation et à sa culture, les institutions qui régissent son univers47 ». Le biais ethnocentrique réduit les apports heuristiques de la comparaison, car au lieu d’accéder à une meilleure compréhension de son propre contexte par le détour d’un autre, le deuxième est perçu à l’aune du premier. Ajoutons également qu’il peut exister des jugements de valeur, lorsque la comparaison a un enjeu politique. Cela peut être le cas dans les comparaisons franco-allemandes, lorsque l’Allemagne est érigée en « modèle » non questionné48. L’orientation vers la recherche de « bonnes pratiques » n’est pas en soi condamnable, car cela permet de conjuguer objectif de connaissance et réflexion prospective, mais il faut dans ce cas définir d’emblée quelle est sa posture et distinguer demande sociale et questions de recherche. Dans le cas présent, notre objectif n’est pas tant de dévoiler de « bonnes pratiques » en éducation aux médias ou des modalités « idéales » d’acculturation de l’école au numérique, mais plutôt d’enrichir notre regard et d’en tirer une meilleure compréhension de notre propre contexte. La comparaison a alors, comme indiqué précédemment, une fonction heuristique.
Frank Esser a repéré cinq fonctions de la comparaison dans la recherche en sciences sociales, qui permettent d’en identifier les enjeux et de donner un programme pour notre recherche49 : la compréhension de sa propre culture en confrontant ses structures et routines à d’autres systèmes ; la conscience « d’autres systèmes, schémas de pensée et d’action, met en lumière nos propres schémas de communication politique et nous permet de le contraster de manière critique avec ceux qui prévalent dans d’autres pays50 » ; la généralisation théorique, obtenue en testant des théories dans différents contextes ; la relativisation, qui dans le même temps empêche les chercheurs de sur-généraliser en se fondant sur leurs propres expériences et schémas de pensée ; et l’émergence d’options et de solutions alternatives pour régler des problèmes similaires dans le pays d’origine.
Médiation des savoirs et éducation aux médias
Notre démarche comparative s’applique aux enjeux communicationnels de la médiation des savoirs. La médiation désigne la relation entre l’individuel et le collectif et permet d’analyser les formes d’appropriation et de négociation de pratiques et de normes par essence collectives dans les pratiques individuelles. Elle rend possible le vivre-ensemble au sein d’une société ; elle se situe ainsi au centre de la construction du social.
La notion de médiation introduit l’idée de tiercéité, d’intermédiaire, d’interface. Les tiers médiateurs peuvent être des sujets, mais également des dispositifs techniques. Pour Jean Caune, ces tiers se situent entre les signes (symboles) et les référents (le Monde) et articulent discours et conception du monde. Le caractère essentiel du phénomène de médiation, en tant qu’expérience humaine passant par le langage, réside selon lui « dans une relation entre : une intention élaborée par une pensée ; un dispositif qui intègre des éléments langagiers et des choses qui interviennent comme référents51 ». La notion est polysémique. Cependant, on peut affirmer que « celle-ci intervient pour faciliter la circulation de sens et l’appropriation du message initial même si le sens donné à la réception n’est prévisible ni par l’émetteur ni par d’éventuels médiateurs52 » ; il s’agit de mettre en relation deux entités jusque-là distinctes pour établir une communication. Quant à l’expression de « médiation des savoirs », celle-ci :
• évoque les formes de médiations épistémique et sémio-cognitive qui constituent l’objet privilégié des sciences de l’information et de la communication : ce sont ces formes de médiation qui sont à l’œuvre notamment dans la communication éducative et la vulgarisation scientifique53.
La médiation des savoirs concerne plus particulièrement le partage et la circulation de ces derniers. Ceux-ci ont un sens social, ils sont collectifs et renvoient à des institutions, alors que la connaissance est du ressort des individus particuliers, issue de l’expérience que chacun fait du monde54. Elle se construit à partir de l’information. Ce processus s’insère toujours dans un contexte de communication, qu’elle soit interpersonnelle ou médiée par des documents, et prend une forme cyclique :
Le savoir pour les SIC est la somme des connaissances socialement reconnues, il constitue un tout objectivé. La connaissance revêt un caractère personnel et subjectif, alors que le savoir est un ensemble d’éléments constitutifs d’une science. À partir du moment où le savoir est objectivé il peut à son tour se transformer partiellement en informations échangeables. Ainsi, la connaissance est propre à l’individu, elle se construit à partir de l’information et se transmet par l’information. On parle alors de processus de signification. La signification est donc le résultat d’un processus de normalisation, de légitimation et offre des objets de sens partageables55.
L’éducation aux médias est définie par le Groupe de Recherche sur la Médiation des Savoirs (GREMS) comme « l’ensemble des enseignements, des processus et des activités éducatives favorisant le développement de la littératie médiatique des individus56 », la littératie désignant elle-même l’ensemble des compétences et des savoirs des individus sur les médias ; nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ces définitions dans notre première partie.
L’éducation aux médias est donc une forme particulière de médiation des savoirs, puisqu’elle recouvre une variété de processus éducatifs formels et non-formels ; elle est le fait d’« une multiplicité d’acteurs […] : enseignant·es, associations et centres de ressources, milieu familial, industrie des médias… constitués en communautés plus ou moins structurées, partageant des objectifs plus ou moins convergents et des savoirs et compétences propres57 ». La Conférence permanente des directeurs.trices des unités de recherche en SIC (CPDIRSIC), dans son ouvrage sur les dynamiques actuelles des recherches en sciences de l’information et de la communication, indique que « la question des compétences requises pour la lecture des médias, pour l’utilisation des techniques informationnelles numériques et, plus largement, la problématique de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), constitue un champ de recherche majeur, en raison des difficultés conceptuelles qu’il oppose msais aussi parce que ses implications éducatives et sociales sont déterminantes58 », le tout dans un contexte de débat social et politique « vif et contradictoire ».