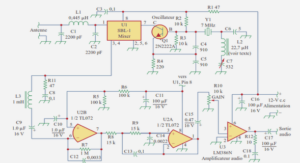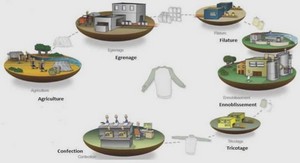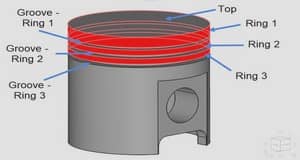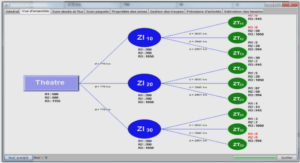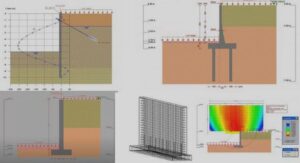Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Le développement selon la RMDH publié par le PNUD
La notion de développement et ses corrélations sous développement et pays en développement sont apparues dans le cadre du nouvel ordre mondial résultant de la seconde guerre mondiale. Le terme « développement » est un concept et il évolue dans le temps et dans l’espace.
Selon le RMDH, on entend par développement : « un processus qui permet d’élargir la gamme de choix qui s’offre à l’individu durant son existence ». Il s’agit de lui donner toutes les chances de vivre longtemps et en bonne santé. Ainsi, l’on est passé du développement économique des années 60 70 au développement humain qui a émergé dès les années 80
Le développement selon F. PERROUX
F. PERROUX précise que : « le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son production réel global » 1En effet cette théorie combine deux notions fondamentales : le développement est une modification du comportement individuel et social, son premier objectif est économique et quantitatif. Le développement est donc un phénomène induit c’est -à-dire une réaction qui se déclenche à l’intérieur de l’individu et de son groupe social, sous l’influence conjuguée et interdép8endante d’incitation extérieur et de tendance et impulsion intérieur. En d’autre terme, c’est une croissance économique et une mutation sociologique voulue et assimilée et se développe, ce n’est pas seulement acquérir quelque chose, c’est surtout devenir quelqu’un c’est-à-dire exploiter et épanouir ses virtualités.
La notion de développement économique
Par « développement économique nous entendons ici un processus sociologique continu entrainant un accroissement progressif de la production moyenne par habitant dans la collectivité considérée. Pour cela, il faut évidemment que la production globale augmente plus vite que la population.2
Si nous parlons de processus « continu », c’est qu’il ne s’agit pas d’obtenir une amélioration isolée, acquise une fois pour toute, il s’agit là d’un domaine essentiellement gouvernemental, même si les plans qui s’y rapportent démurant parfois insuffisants ou incomplètement appliquées.
Approche sociologique
L’importance de la confiance dans les rapports sociaux « La confiance est un important lubrifiant des rapports sociaux
Elle est extrêmement efficace : cela évite beaucoup de complication que de pouvoir faire raisonnablement, confiance à la parole d’autrui. Malheureusement ce n’est pas une marchandise que vous pouvez acheter très facilement. Il n’existe pas de marché ouvert sur lequel il soit techniquement possible d’échanger ce bien, en supposant même que cela ait un sens ». Kenneth Arrow, the limits of organization, 1974
Pour inspirer cette confiance, en matière de crédit, il faut que l’organisme de crédit démontre par l’attitude de tous ses employés, qu’elle vise réellement à rendre service.
« Le degré de rationalité d’une action quelque soit sa nature dépend de la structure du champ où l’agent agit socialement ».3
Le rayon de prévision, la capacité de mettre en rapport les moyens et les buts dans leur évolution dans le temps et selon des critères objectifs d ’efficacité, le pouvoir créateur même de la volonté ou de la pensée, ce sont là des éléments qui s’organisent en dehors de l’individu qui va déterminer sa façon pratique d’adaptation.
La nécessité d’une formation
Nombreux pensent que la pratique se perfectionne sur le tas dans l’exploitation, pourtant, ils se plaignent d’une insuffisance de connaissance générale de base qui ne leur permet pas de progresser et surtout de s’adapter rapidement d’où l’importance de la formation. Selon J LECAILLON : Seul la spécialisation des fonctions permet à chaque individu, à chaque région et à chaque Nation de tirer le meilleur parti possible de toutes leurs aptitudes et de toutes leurs ressources »4
L’avantage d’une formation donnée sur de tells bases serait d’être accélérée. Elle irait droit au but, elle n’enseignerait pas toute la physique pour faire saisir quelques principes de mécanique agricole, ou toute la chimie pour faire comprendre comme doivent être utilisés les engrais, ou toute la botanique pour expliquer comment les plantes cultivée réagissent face aux divers sols, climats ou pratiques culturales. Il ne serait inculqué de chacune de ces branches que les notions nécessaires pour la conduite de l’exploitation. La personne est invitée non pas à meubler sa mém oire, mais à constamment remonter par le raisonnement aux causes, à savoir discerner les liens constats existants entre des phénomènes variables.
Caractéristiques des sociétés paysannes et inaccessibilité au crédit
L’agriculture paysanne s’apparente sur beaucoup de points à l’agriculture commerciale. Comparée à l’entreprise industrielle moyenne, la ferme-type de la plupart des pays opère à échelle plus réduite, que l’on considère la main d’œuvre employée, les capitaux investis ou le chiffre d’affaires annuel. Tributaire des conditions atmosphériques, tenue de veiller attentivement aux cultures et au bétail, astreinte enfin à une succession irrégulière d’opérations, elle est moins à même de se mécaniser et de normaliser sa production. Cet ensemble de contingence oblige à régler étroitement les travaux agricoles en fonction de conditions naturelles variables, cependant que l’absence de tout moyen de pointage mécanique et l’étendue matérielle de l’exploitation par rapport aux quantités produits et à la main-d’œuvre employée rendent généralement le contrôle de l’élément travail plus difficile que dans le secteur industriel, aussi, les dimensions exprimées en main d’œuvre employée et en quantités produites, sont elles plus faibles. Du fait de cette dimension réduite, de la plus grande difficulté d’appréciation des risques techniques, enfin des risques commerciaux additionnels inhérents à certaines facteurs, le secteur agricole se prêt moins bien à la constitution d’un capital fixe par actions. Il lui est en même temps difficile de réunir des fonds par d’autres moyens, tant en raison des risques eux mêmes que par suite des larges différences de fertilité qui compliquent l’évaluation des terres, de l’importance nécessairement attribuée aux qualités personnelles de compétence et d’intégrité des emprunteurs
Catégories sociales et capacité de remboursement
Les gens riches peuvent s’équiper afin de produire plus, ce qui leur permet d’avoir de gros revenus, alors que les pauvres n’ont pas les moyens d’investir et de sortir de leur état.
On constate d’autre part l’existence d’une sorte de cycle de vie :
– Les jeunes exploitants qui n’ont pas des revenus élevés doivent lourdement s’endetter pour s’équiper. Leurs possibilités de remboursement sont faibles.
– Les exploitants plus âgés, installés depuis longtemps que grâce à leurs revenus relativement élevés peuvent épargner et ont pu se désendetter. Leur capacité de remboursement est élevée. Dans la commune de Tsararano, certains paysans représentent un risque et un danger pour l’organisme prêteur parce que leur capacité de remboursement est faible
Théorie Durkheimienne
La division du travail concerne la répartition des rôles et les fonctions entre les membres d’une société. Elle jouerait un rôle beaucoup plus important que celui qu’on lui attribue d’ordinaire. Elle ne servirait pas seulement à doter nos sociétés d’un luxe, elle serait une condition de leur existence. C’est surtout par elle que serait assurée la cohésion.
Il y a cohésion lorsque la société conser ve son unité : elle est capable de faire coexister ensemble et de façon harmonieuse les individus qui la constituent.
Approche psychosociologique
Les caractères propres à la personnalité de l’agriculteur
L’attitude de l’agriculteur est déterminée par la formation particulière que lui donne son métier et par les caractères du milieu ou il vit. Il ne perçoit donc pas la réalité de la même manière que le citadin. Alors que le citadin témoigne, dans l’ensemble, d’un esprit rationnel et tourné vers l’analyse, on rencontre chez l’agriculteur un esprit d’intuition qui est plutôt tourné vers la synthèse. Ces démarches de la pensée sont différentes mais elles sont également valables en regard de la science. Leur association devrait donner de bons résultats.
Deux traits caractérisent véritablement l’exploitant agricole : il exerce son activité dans le milieu biologique, il est un pôle de décision.
L’agriculteur opère dans le milieu biologique
L’agriculteur travaille une matière vivant, dont les composantes sont interdépendantes les unes par rapport aux autres. Il ne lui est pas possible de modifier l’un des éléments de cet équilibre biologique sans agir sur la totalité. La décision de l’agriculteur est donc, toujours caractérisée par une certaine incertitude : ses activités mettent en cause une structure complexe : jamais il ne sait de quelle manière exactement cette structure se trouvera modifiée. Cette formation biologique apporte à l’agriculteur- la notion de temps : devant un évènement nouveau, le paysan emprunte volontiers l’attitude qui lui est propre dans ses champs, quand il a semé, il sait attendre la levée du grain. On interprète souvent comme de la routine la réticence du paysan à modifier avant expérience des mécanismes qui lui sont familiers.
– l’habitude de la synthèse : parce qu’il gère un ensemble complexe, l’agriculteur doit avoir une vision globale des problèmes. La crainte de se tromper en raison de l’oubli d’une vision de l’oubli d’une donnée susceptible d’influencer sa décision contribue à expliquer la routine et même la méfiance de l’agriculteur. Cette méfiance apparait en particulier chez les agriculteurs peu-formés. Toutefois, au fur et à mesure que sa formation s’améliore, il modifier son attitude.
L’agriculteur est un pôle de décision
L’agriculteur assume des responsabilités dans l’exploitation et dans ses organisations professionnelles.
L’exploitation pose toujours à celui qui la gère une multitude de problème qu’il doit résoudre simultanément. Cela est vrai plus particulièrement pour l’agriculteur, dont le travail se prêt mal à la spécialisation en raison du grand nombre d’intervention différentes, successives et de durée limitée qui s’échelonnent au cours des saisons.
On constate que l’ouverture au progrès croit assez régulièrement avec la surface des exploitations car une grande surface permet un meilleur équipement et donne à ceux qui la recherchent pour progresser, une disponibilité accrue.
Dans la commune, nombreux sont ceux qui veulent pratiquer des nouvelles techniques, mais par peur d’échouer, ils procèdent aux essais avant de se lancer ce qui influe beaucoup leur comportement face au crédit.
Approche structurelle dans les pays sous-développés
En adoptant une approche structurelle, l’économie d’un pays développé apparaît comme une machine, toutes les activités qui agissent dans la vie économique sont solidaire : industrie, banque, consommateurs… sont d’un rouage d’une vaste machine. Par contre, l’économie d’un pays sous-développé ne présente pas une telle cohésion. Des éléments de la machine économique n’embraye pas les uns sur les autres et ceci pour deux principales raisons : l’économie est désarticulée en plusieurs secteurs plus ou moins indépendants ; elle est influencée par des facteurs extérieure qui empêche l’engrainage de tourner.
L’économie des pays sous-développés est une économie dominée. Elle subit à la fois des dominations intérieures et extérieures.
Domination intérie2ur
Les structures agraires empêchent les agriculteurs de vivre aisément et d’embrailler sur la vie moderne. En outre, les pareilles cultivées ne permettent pas une culture intensive, s’ajoutant à ceci, le manque de connaissance ne permet pas une utilisation correcte du sol. En plus, le métayage largement utilisé freine l’effort des paysans : pourquoi produire plus alors que la majeure partie revient au propriétaire ? Cette situation fait que le paysan de l’intérieur est doublement exploité : les collecteurs fixent le prix des produits de part le manque d’infrastructure routière mais encore, les propriétaires terriens prélèvent une partie de la production sans avoir apporté un quelconque soutien tout au long du processus cultural.
Domination extérieure
Les groupes internationaux investissent et créent des enclaves qui désarticulent l’économie. Par besoin de budget, l’Etat va demander de l’aide à l’extérieur et raffermit de ce faite la situation de dépendance de l’économie nationale par rapport au pays dominant.
L’économie des pays sous-développés est donc à la fois désarticulée et dominée et c’est la nature profond de la cause du sous-développement. La lutte pour le développement doit donc passer par la restructuration de l’économie, la lutte contre la désarticulation tant sociologique. Economique, la transformation des dominations en simple interdépendance. L’économie de la commune de Tsararano subit une domination intérieure du fait de la situation socio-économique encore défavorisée.
Approche participative
Nombreux étaient les modèles de développement avancés en vue de lutter contre la pauvreté. Mais, les méthodes d’approches utilisées n’arrivaient pas à atteindre la grande majorité des paysans. L’approche participative semble apporter les éléments nécessaires pour combler cette lacune.
En effet, elle vise à responsabiliser la communauté, à analyser tous les facteurs de dévelop2pement essentiel et les amener à une structure locale du travail. Ainsi, des techniques quantitatives y sont utilises. Elle facilite la collecte des donnés et la recherche par la participation effective des sujets eux-mêmes.
Etat du secteur de la micro finance
Cette section nous donnera plus de détails sur la micro finance et le microcrédit, ainsi que l’historique de création des institutions de micro-finance.
La micro finance
La micro finance consiste en une collecte d’épargne et un financement des petits producteurs ruraux et urbains, relativement pauvre ou tout du moins exclus du système bancaire traditionnel.
Entre autre, la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005, relative à l’activité et au contrôle des institutions de micro finance comme étant : « un offre à titre habituel de services financiers de proximité à des personnes physiques ou mor ales n’ayant généralement pas accès au système bancaire traditionnel. Ce sont des services générateurs de revenu permettant à cette catégorie de la population d’améliorer son niveau de vie, atteindre une meilleure intégration sociale et d’accéder à un développement humain durable ».
La micro finance a deux objectifs :
– Favoriser l’accès des petits producteurs exclus du circuit bancaire à des services financiers adaptés à la taille de leurs activités.
– Réaliser une meilleure collecte d’épargne des ménages et des petits entrepreneurs par la réinjecter dans le circuit économique.
Le microcrédit
Puisque le crédit constitue la raison d’être de ce mémoire, il convient de définir le microcrédit.
Le microcrédit consiste en un accord de prêt à des personnes physiques ou morales pour l’utiliser à leur façon, à leur profit et qui doit être remboursable à une certaine échéance.
Le microcrédit est l’une des services de la micro finance.
Par ailleurs, la loi n° 2005-016 du 29 septembre 2005, relative à l’activité et au contrôle des institutions de micro finance comme étant : « un acte par lequel une institution de micro finance met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’un tiers, personne physique ou morale, ou prend dans l’intérêt de ce tiers un engagement par signature, un cautionnement ou une garantie ».
Les principaux objectifs du microcrédit sont : l’incitation à la production, l’accroissement de la productivité et la lutte contre la thésaurisation afin de réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie.
Autres définitions
Epargne
– Sont considérés comme épargne « les fonds reçus de leurs membres par les institutions de micro finance mutualistes, sous forme de dépôts, autres que les apports en capital, les droits d’adhésion et les cotisations, avec le droit d’en disposer dans le cadre de leurs activités, à charge pour elles de les restituer »ne sont pas considérées comme « épargne » « fonds de garantie » qui ne seraient déposés par le client qu’après décision d’octroi de crédit.
Les épargnes sont à vue et à terme. Les dépôts à vue qui constituent la plus grande partie de l’épargne mobilisés ne sont pas rémunérés tandis que les dépôts à terme sont rémunérés de 4,5 à 6,5% par an.
les fonds de garantie
Ce sont des sommes reçues en garantie du remboursement des crédits allouées déposées par les clients après décision d’octroi de crédit
Dépôts obligatoires :
Ce sont les sommes d’argents nécessaires à l’obtention de crédit.
Historique de la création des institutions de micro finances.
La promotion des institutions de Micro finances remonte dans les années 90. Les défaillances du système bancaire, surtout en milieu rural, ont incité le Gouvernement malgache à les promouvoir.
La fin des années 90 a vu l’émergence de ces IMFs, si auparavant, le secteur de la micro finance était le privilège de la Banque Nationale BTM. La BTM accordait certes des crédits au paysannat, mais celle-ci n’atteignant qu’une frange limitée de la population rurale. La création des IMFs a été favorisé par 5
– Le gouvernement malgache, par le biais de la mise en place de cadre institutionnel pour le développement et la régulation du secteur d e la micro finance.
– Les Bailleurs de fonds (Banque Mondiale, Programme des Nations Unies /Fonds d’Equipement des Nations Unies, Union Européenne, Agence Française de Développement, Coopération allemande….)
– Les Agences d’Implantation et de Développement internationaux (AJD) ou les opérateurs qui assurent l’encadrement technique des IMFs, tels que le Développement
International Desjardins, le FERT ou Formation et Epanouissement pour le Renouveau de la Terre), l’IRAM (Institution de Recherche Agronomique de Madagascar). CIDR (Centre International pour le Développement de la Recherche).
La période qui va de 1990 à 1995 a ainsi vu la création de nombreux IMFs qui peuvent être catégorisées en 2 types :
– Les Institutions Financières Mutualistes (IFM) : CECAM, AECA, OTIV, TIAVO.
– LesInstitutions Financières non mutualistes (IFNM) : SIPEM, VOLAMAHASOA, APEM, EAM, CEM.
Depuis 1996, les réseaux de micro finance se sont consolidés et étendus dans plusieurs régions de l’île. Le réseau OTIV ou « Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola » fera l’objet de la présente étude.
Ce chapitre a été conçu pour nous faire part des différentes approches que nous avons adoptés pour notre étude que ce soit conceptuelle ou sociologique ou psychosociologique et participative car l’organisation et l’exploitation des donnés de terrain doit respecter une certaine ligne d’approche. Mais utiliser ces approches semble insuffisant si on ne se réfère pas à la monographie, c’est la raison d’être du chapitre suivant.
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I-CADRE THEORIQUE ET PRESENTATION GENERALE
Chapitre I-Aspects théoriques
Section1-Approche conceptuelle
1-Le développement selon le RMDH
2-Le développement selon F. PERROUX
3-La notion de développement économique
Section 2-Approche sociologique
1-L’importance de la confiance dans les rapports sociaux
2-Le degré de rationalité d’une action
3-La nécessité d’une formation
4-Caractéristiques des sociétés paysannes et inaccessibilité au crédit
5-Catégories sociales et capacités de remboursement
6-Théorie Durkheimienne
Section 3-Approche psychosociologique
1-L’agriculteur opère dans le milieu biologique
2-L’agriculteur est un pole de décision
Section 4-Approche structurelle dans les pays sous développés
1-Domination intérieure
2-Domination extérieure
Section5-Approche participative
Section6-Etat du secteur de la micro finance
1-La micro finance
2-Le microcrédit
3-Autres définitions
4-Historique de la création des institutions de micro finance
Chapitre II-Profils monographiques
Section1-Historique, situation géographique, délimitation administrative
1-Historique
2-Situation géographique et délimitation administrative
Section 2-Données socio-économiques
1-Données démographiques
2-Education
3-Santé et assainissement
4-Sécurité
5-Sports et culture
6-Transport et infrastructures routières
7-Activités lucratives
8-Les organismes et intervenants opérant dans la commune
PARTIEII-DYNAMIQUE PAYSANNES ET MICROCREDIT A TSARARANO
Chapitre III-Dynamique social global
Section1- Situation de dynamique de groupe
1-Les difficultés de la population
2-La nécessité d’un projet de développement
3-Les projets de développement
Section 2-Les forces productives et rapport de production
1-Les forces productives
2-Les rapports de production
Chapitre IV-Intervention de l’OTIV dans la commune
Section 1-Présentation de l’OTIV
Section 2-Collecte d’épargne
1-Le dépôt à vue
2-Le dépôt spécialisé
3-Le dépôt à terme
4-L’épargne retraite
Section 3-Le crédit
1-Caractéristiques du crédit
2-Définition et objectif du microcrédit
3-Les conditions et procédures d’octroi de crédit
Section 4-Les forces et faiblesses de l’OTIV
1-Les forces
2-Les faiblesses
Chapitre V-Résultats des enquêtes et analyses
Section 1-Caractéristique des enquêtés
Section 2-Les obstacles à l’accessibilité au crédit
1-Absence d’épargne
2-L’inexistence de biens matériels qui peuvent servir de garanties
3-Absence de solidarité
Section 3-Analyse de ces facteurs de blocage
1-Perte de valeur de la solidarité
2-Les difficultés financières
3-La structure foncière
Section 4-Impacts directs /indirects de l’accessibilité au crédit
1-L’octroi de crédit a permis de finir à temps le travail
2-L’octroi de crédit a permis d’acheter des intrants agricoles
3-L’octroi de crédit a permis d’étendre la superficie cultivée
4-Le crédit a permis de subvenir aux périodes de soudure
Section 5-Analyse des comportements des riziculteurs face au crédit
1-Situation financière
2-La formation
Section 6-Les facteurs déterminants la capacité de remboursement
1-Le comportement des riziculteurs face au crédit
2-L’ancienneté
Section 8-Approche comparative
1-Le système tsanga-kazo ou vary maitso
2-Le prêt-paysan fourni par l’OTIV
3-L’entraide
PARTIE III-APPROCHE PROSPECTIVE
Chapitre VI-Bilan
Section 1-Analyse sociologique
Section 2-Bilan
Chapitre VII-Recommandations
Section 1- Au niveau de l’Etat
Section 2-Au niveau de l’OTIV
1-Personnel et conditions de travail
2-Sur le plan technique et pratique
Section 3-Au niveau des bénéficières
Section 4-Le travail social et les travailleurs sociaux
CONCLUSION GENERALE