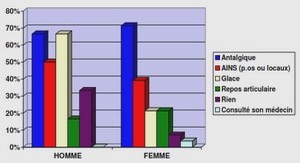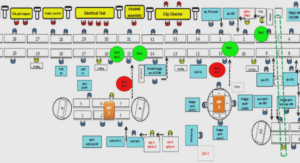DE LA DISPOSITION ORIGINAIRE AU BIEN DANS LA NATURE HUMAINE.
Relativement à sa fin, nous l’envisageons, comme il est juste, dans trois classes, éléments de la destinée de l’homme :
1. La disposition de l’homme à l’animalité en tant qu’être vivant;
2. Sa disposition à l’humanité, en tant qu’être vivant et tout ensemble raisonnable;
3. Sa disposition à la personnalité, en tant qu’être raisonnable et susceptible en même temps d’imputation 1.
1. La disposition à l’animalité dans l’homme peut être rangée sous le titre général de l’amour de soi physique et simplement mécanique, c’est-à-dire tel qu’il n’implique pas de la raison. Elle comporte trois espèces qui nous portent, premièrement, à notre conservation personnelle; deuxièmement, à la propagation de notre espèce, par l’instinct sexuel, et à la conservation de ce que procrée le rapprochement des sexes; troisièmement, à l’entretien de relations avec les autres hommes, ce qui est l’instinct social. – Sur cette disposition peuvent être greffés des vices de tout genre (mais ils n’en proviennent pas comme d’une racine dont ils seraient les rejetons). On peut les appeler des vices de la grossièreté de la nature, et, quand ils s’écartent au plus haut point de la fin naturelle, on leur donne le nom de vices bestiaux; ce sont : l’intempérance, la luxure, le mépris sauvage des lois (dans les relations avec les autres hommes).
2. Les dispositions à l’humanité peuvent être rangées sous le titre général de l’amour de soi physique, il est vrai, mais pourtant comparé (ce qui requiert de la raison); puisque c’est seulement comparativement à d’autres que l’on se juge heureux ou malheureux. De cet amour de soi dérive le penchant de l’homme à se ménager une valeur dans l’opinion d’autrui; originairement, sans doute, l’homme veut simplement l’égalité, satisfait de ne concéder à personne la suprématie sur lui-même, mais constamment préoccupé que les autres puissent y tendre; et cette crainte peu à peu donne naissance à l’injuste désir d’acquérir la suprématie sur les autres. Sur ce penchant, je veux dire sur la jalousie et sur la rivalité, peuvent être greffés les vices les plus grands, des inimitiés secrètes et publiques contre tous ceux que nous considérons comme nous étant étrangers; pourtant, à proprement parler, la jalousie et la rivalité ne proviennent pas de la nature comme d’une racine dont elles seraient les rejetons, mais, en raison de la crainte où nous sommes que d’autres acquièrent sur nous une supériorité que nous haïssons, elles sont des penchants qui, pour notre sécurité, nous portent à nous ménager, comme moyen de précaution, cette prépondérance sur autrui; alors que la nature voulait seulement employer comme mobile ayant la civilisation pour fin l’idée d’une pareille émulation (laquelle n’exclut point l’amour réciproque des hommes). Les vices qui se greffent sur ce penchant peuvent conséquemment être appelés des vices de la civilisation, et quand ils atteignent le degré de méchanceté le plus élevé (n’étant alors simplement que l’idée d’un maximum du mal, chose qui dépasse l’humanité), comme c’est le cas, par exemple, dans l’envie, dans l’ingratitude, dans la joie des maux d’autrui, etc., ils reçoivent le nom de vices sataniques.
3. La disposition à la personnalité est la capacité d’éprouver pour la loi morale un respect qui soit un mobile suffisant par lui-même du libre arbitre. Cette capacité d’éprouver simplement du respect (Empfänglichkeit der blossen Achtung) pour la loi morale en nous, serait le sentiment moral qui, par lui-même, ne constitue pas une fin de la disposition de la nature, mais qui a besoin, pour le devenir, d’être un mobile du libre arbitre. Or, la seule chose qui puisse lui donner cette qualité, c’est qu’il soit accepté par le libre arbitre dans sa maxime; et l’essence du libre arbitre qui prend pour mobile ce sentiment, est d’avoir la bonté pour caractère ; ce caractère bon, comme en général tous les caractères du libre arbitre, est une chose qui peut seulement être acquise, mais qui a besoin pour être possible de trouver dans notre nature une disposition sur laquelle ne peut être greffe absolument rien de mauvais. Sans doute, l’idée de la loi morale, en y comprenant le respect qu’on ne saurait en séparer, ne peut pas justement être appelée une disposition à la personnalité; elle est la personnalité même (l’idée de l’humanité considérée d’une manière tout à fait intellectuelle). Mais, dans le fait que nous acceptons ce respect pour mobile dans nos maximes, intervient le principe subjectif, qui paraît être une addition faite à la personnalité et mériter conséquemment le nom d’une disposition sur laquelle s’appuie la personnalité.
Si nous considérons ces trois dispositions sous le rapport des conditions de leur possibilité, nous trouvons que la première n’a aucune raison pour base, que la deuxième est sans doute un produit de la raison pratique, mais d’une raison mise au service d’autres mobiles, tandis que la troisième seule a pour racine la raison pratique par elle-même, c’est-à-dire édictant des lois inconditionnellement. Toutes ces dispositions dans l’homme ne sont pas seulement (négativement) bonnes (en ce sens qu’elles ne sont pas en opposition avec la loi morale), mais elles sont même encore des dispositions au bien (en ce sens qu’elles encouragent à l’accomplir). Elles sont originelles, car elles tiennent à la possibilité de la nature humaine. L’homme peut détourner les deux premières de leurs fins et en faire un mauvais usage, mais il ne saurait en détruire aucune. Par les dispositions d’un être nous entendons non seulement les parties essentielles qui doivent le constituer, mais encore les formes suivant lesquelles l’union de ces parties s’opère, pour que l’être en question existe. Ces dispositions sont originelles, si elles sont nécessairement impliquées dans la possibilité de cet être; et contingentes si, même sans ellles, l’être était possible en soi. Il faut encore remarquer qu’il n’est question d’aucune autre disposition que de celles qui se rapportent immédiatement à l’appétition (Begehrungsvermögen) et à l’usage du libre arbitre.
DU PENCHANT AU MAL DANS LA NATURE HUMAINE.
Par penchant (propensio) j’entends le principe subjectif de la possibilité d’une inclination (d’un désir habituel [concupiscentia]), en tant que cette inclination est contingente pour l’humanité en général 1. Le penchant se distingue d’une disposition foncière (Anlage) en ce que, s’il peut être inné, il ne doit pas pourtant être représenté comme tel; il peut au contraire être conçu (s’il est bon) comme acquis, ou (s’il est mauvais) comme contracté par l’homme lui-même. – Mais il n’est question ici que du penchant à ce qui est le mal à proprement parler, c’est-à-dire le mal moral ; lequel n’étant possible qu’en qualité de détermination du libre arbitre, et ce libre arbitre ne pouvant être jugé bon ou mauvais que d’après ses maximes, doit consister dans le principe subjectif où se fonde la possibilité d’avoir des maximes opposées à la loi morale, et, si l’on a le droit d’admettre ce penchant comme inhérent universellement à l’homme (par conséquent au caractère de l’espèce), pourra être appelé un penchant naturel de l’homme au mal. – On peut encore ajouter que la capacité du libre arbitre à adopter la loi morale pour maxime, ou son incapacité à l’admettre ainsi, ayant toutes les deux pour cause un penchant naturel, sont appelées le bon cœur ou le mauvais cœur.
On peut, dans le penchant au mal, distinguer trois degrés : c’est, en premier lieu, la fai-blesse du cœur humain impuissant à mettre en pratique les maximes adoptées, d’une manière générale, ou la fragilité de la nature humaine; c’est, en second lieu, le penchant à mêler des mobiles immoraux aux mobiles moraux (même quand ce serait dans une bonne intention et en vertu de maximes du bien), c’est-à-dire l’impureté du cœur humain ou de la nature humaine ; c’est, enfin, le penchant à l’adoption de maximes mauvaises, c’est-à-dire la méchan-ceté de la nature humaine ou du cœur humain.
En premier lieu, la fragilité (fragilitas) de la nature humaine est même exprimée dans la plainte d’un Apôtre : « J’ai bien la volonté, mais l’exécution fait défaut » ; ce qui revient à dire : Je prends le bien (la loi) pour maxime de mon libre arbitre, mais ce bien qui est objectivement, dans l’idée (in thesi), un mobile invincible, est, subjectivement (in hypothesi), quand il faut suivre la maxime, dans la pratique, le plus faible mobile (comparé à l’incli-nation).
En second lieu, l’impureté (impuritas, improbitas) du cœur humain consiste en ce que la maxime, tout en étant bonne quant à l’objet (quant à l’intention que l’on a de mettre la loi en pratique), et peut-être même assez puissante pour qu’on passe à l’acte, n’est pas cependant moralement pure, c’est-à-dire n’a pas, comme ce devrait être, admis en elle la loi morale seule comme mobile suffisant, mais a encore besoin le plus souvent (peut-être toujours) que d’autres mobiles se joignent à celui-ci pour déterminer le libre arbitre à ce qu’exige le devoir. Autrement dit, l’impureté consiste en ce que des actions conformes au devoir ne sont pas accomplies purement par devoir.
Enfin, la méchanceté (vitiositas, pravitas) ou, si l’on aime mieux, la corruption (corruptio) du cœur humain est le penchant du libre arbitre à des maximes qui subordonnent les mobiles tirés de la loi morale à d’autres mobiles (qui ne sont pas moraux). Elle peut encore s’appeler la perversité (perversitas) du cœur humain, parce qu’elle pervertit l’ordre moral relativement de concept (tels l’instinct industrieux chez les animaux, ou l’instinct sexuel). Après l’inclination vient encore un dernier degré du pouvoir d’appétition, la passion (Leidenschaft), et non l’affection (der Affekt), car cette dernière appartient au sentiment de plaisir et de peine, laquelle est une inclination qui exclut tout empire sur soi-même.] aux mobiles d’un libre arbitre, et si malgré cela des actions (légales), bonnes au regard de la loi (gesetzlich gule), peuvent toujours être faisables, il n’en est pas moins vrai que la manière de penser est ainsi corrompue dans sa racine (pour ce qui est de l’intention morale) et que l’homme est par là marqué comme méchant.
Notez que le penchant au mal (en ce qui regarde les actes) est ici présenté comme inhérent à l’homme, même au meilleur d’entre les hommes, et que cela est nécessaire pour qu’on puisse prouver l’universalité du penchant au mal chez les hommes, ou démontrer, ce qui revient au même, qu’il est intimement lié à la nature humaine.
Entre un homme de bonnes mœurs (bene moratus) et un homme moralement bon (moraliter bonus), pour ce qui est de l’accord des actes avec la loi il n’y a pas de différence (il ne doit pas du moins y en avoir) ; seulement ces actes chez l’un ont rarement la loi, si même ils l’ont jamais, pour mobile unique et suprême, tandis qu’ils l’ont toujours chez l’autre. On peut dire du premier qu’il observe la loi quant à la lettre (c’est-à-dire pour ce qui est de l’acte que cette loi commande), et du second qu’il l’observe quant à l’esprit (et l’esprit de la loi morale veut que cette loi seule soit un mobile suffisant). Tout ce qui ne vient pas de cette loi est péché (sous le rapport de la manière de penser). Car si, pour déterminer le libre arbitre à des actions conformes à la loi, d’autres mobiles que la loi même sont requis (par exemple, le désir de l’honneur, l’amour de soi en général, ou même un instinct de bonté, du genre de la compassion), c’est simplement d’une manière contingente qu’ils s’accordent avec la loi, car ils pourraient tout aussi bien pousser l’homme à la transgresser. La maxime, dont la bonté doit servir à apprécier toute la valeur morale de la personne, n’en est pas moins opposée à la loi et, malgré des actions qui seraient toutes bonnes (bei lauter guten Handlungen), l’homme cependant est mauvais.
L’explication suivante est encore nécessaire pour déterminer le concept du penchant au mal. Tout penchant est physique ou moral ; il est physique s’il appartient au libre arbitre de l’homme en tant qu’être de la nature ; il est moral s’il appartient au libre arbitre de l’homme en tant qu’être moral. – Il n’existe point de penchant physique au mal moral ; car il faut que le mal moral provienne de la liberté ; et un penchant physique (qui est fondé sur une impulsion sensible) à faire de la liberté un usage quelconque, soit pour le bien, soit pour le mal, est une contradiction. Un penchant au mal ne peut donc affecter que le pouvoir moral du libre arbitre (dem moralischen Vermögen der Willkühr ankleben). Or il n’y a de mal moral (c’est-à-dire de mal susceptible d’imputation) que celui qui est notre propre fait. On entend au contraire par le concept d’un penchant un principe subjectif de détermination du libre arbitre et ce principe, étant antérieur à tout fait, n’est donc pas encore lui-même un fait. Il y aurait par conséquent une contradiction dans le concept d’un simple penchant au mal, si le mot fait n’était pas susceptible d’être en quelque façon pris dans deux sens différents, mais qui tous les deux cependant peuvent être conciliés avec le concept de la liberté. Or le mot fait en général peut tout aussi bien s’appliquer à cet usage de la liberté d’où résulte l’adoption dans le libre arbitre de la maxime souveraine (conforme au contraire à la loi) qu’à cet autre usage d’où sortent les actions elles-mêmes (considérées dans ce qui en est la matière, c’est-à-dire sous le rapport d’objets du libre arbitre [die Objecte der Willkühr betreffend]) exécutées conformément à la maxime admise. Le penchant au mal est un fait, dans le premier sens donné à ce mot (peccatum originarium), et c’est en même temps le principe formel de tout fait, entendu dans le second sens, qui est opposé à la loi, avec laquelle il est en contradiction sous le rapport de la matière, ce qui le fait appeler vice (peccatum derivativum); et, de ces péchés, le premier demeure, alors même que le second (provenant de mobiles qui ne consistent pas dans la loi même) pourrait être évité de plusieurs manières. Le premier est un fait intelligible, qui n’est connaissable que par la raison, sans aucune condition de temps ; le second est un fait sensi-ble, empirique, donné dans le temps (factum phænomenon). C’est surtout par comparaison avec le second que le premier de ces péchés est appelé simple penchant ; et il est dit inné parce qu’il ne peut pas être extirpé (car pour cela la maxime suprême devrait être celle du bien, tandis que, dans ce penchant même, a été adoptée la maxime mauvaise), et surtout parce que nous ne pouvons pas expliquer pourquoi le mal en nous a précisément corrompu la maxime suprême, bien que pourtant ce mal soit notre propre fait, pas plus que nous ne pou-vons indiquer la cause d’une propriété fondamentale inhérente à notre nature. – Les explica-tions qui précèdent font voir pour quel motif, au début du présent article, nous cherchions les trois sources du mal moral uniquement dans celui qui affecte, suivant des lois de liberté, le principe suprême qui nous fait adopter ou suivre nos maximes, et non dans celui qui affecte la sensibilité (en tant que réceptivité).
L’HOMME EST MAUVAIS PAR NATURE. Vitillis nemo sine nascitur. (Horat.)
Cette proposition : l’homme est mauvais, ne peut, d’après ce qui précède, vouloir dire autre chose que ceci : l’homme a conscience de la loi morale, et il a cependant adopté pour maxime de s’écarter (occasionnellement) de cette loi. Dire qu’il est mauvais par nature, c’est regarder ce qui vient d’être dit comme s’appliquant à toute l’espèce humaine : ce qui ne veut pas dire que la méchanceté soit une qualité qui puisse être déduite du concept de l’espèce humaine (du concept d’homme en général), car elle serait alors nécessaire, mais que, tel qu’on le connaît par l’expérience, l’homme ne peut pas être jugé différemment, ou qu’on peut supposer le penchant au mal chez tout homme, même chez le meilleur, comme subjectivement néces-saire. Or, comme ce penchant doit être lui-même considéré comme moralement mauvais et que, par suite, on doit y voir non pas une disposition physique, mais quelque chose qui puisse être imputé à l’homme ; comme il doit consister conséquemment dans des maximes du libre arbitre contraires à la loi, et que, d’autre part, ces maximes, en raison de la liberté, doivent être tenues pour contingentes en elles-mêmes – ce qui, de son côté, ne saurait s’accorder avec l’universalité de ce mal, à moins que le principe suprême subjectif de toutes les maximes ne soit, peu importe comment, étroitement uni avec l’humanité et comme enraciné dans elle – nous pourrons nommer ce penchant un penchant naturel au mal, et puisque il faut toujours pourtant que ce penchant lui-même soit coupable, nous pourrons l’appeler dans la nature humaine un mal radical et inné (dont nous sommes nous-mêmes la cause néanmoins).
Qu’il y ait, enraciné dans l’homme, un penchant dépravé de cette espèce, nous pouvons bien nous dispenser d’en faire la démonstration formelle, étant donnée la multitude d’exem-ples frappants que l’expérience étale devant nos yeux dans les faits et gestes des hommes. Veut-on emprunter ces exemples à l’état dans lequel plusieurs philosophes espéraient rencontrer par excellence la bonté naturelle de la nature humaine et qu’on a nommé l’état de nature ? Il suffit, en ce cas, de comparer avec l’hypothèse en question les scènes de froide cruauté qu’offrent les carnages de Tofoa, de la Nouvelle-Zélande, des Iles des Navigateurs, et aussi les massacres incessants qui se commettent dans les vastes déserts du nord-ouest de l’Amérique (comme ils sont rapportés par le capitaine Hearne), sans que nul homme en tire le plus mince avantage 1, pour se convaincre que dans l’état de nature règnent plus de vices de barbarie qu’il n’en faut pour détruire l’opinion de ces philosophes. Est-on au contraire d’avis que la nature humaine se fait mieux connaître dans l’état civilisé (où les dispositions de l’homme peuvent se développer plus complètement) ; il faudra, dans ce cas, prêter l’oreille à la longue et mélancolique litanie des plaintes de l’humanité, qui récrimine contre la secrète fausseté s’insinuant même dans l’amitié la plus intime, si bien que les meilleurs amis regardent la modération de la confiance dans leurs épanchements réciproques comme une maxime universelle de prudence dans les relations ; contre un penchant qui pousse l’obligé à ressentir à l’égard de son bienfaiteur une haine à laquelle ce dernier doit toujours s’attendre ; contre une bienveillance cordiale qui donne pourtant lieu à cette observation « qu’il y a dans le malheur de nos meilleurs amis quelque chose qui ne nous déplaît pas entièrement »; et contre beaucoup d’autres vices qui se dissimulent encore sous l’apparence de la vertu, sans parler de ceux qui ne prennent pas de déguisement, parce que c’est déjà pour nous être un homme de bien que d’être un mauvais homme de la classe générale ; et l’on trouvera assez de vices de culture et de civilisation (les plus humiliants de tous) pour aimer mieux détourner ses regards des relations qu’entretiennent les hommes que de tomber soi-même dans un autre vice, celui de la misanthropie. Si l’on n’est pas encore satisfait, il suffit de considérer l’état merveilleusement composé par la juxtaposition des deux autres, je veux parler de l’état inter-national, où les nations civilisées vivent les unes par rapport aux autres dans les termes du grossier état de nature (sur le pied de guerre perpétuelle) dont elles ont même pris la ferme résolution de ne jamais se départir, pour voir que les principes fondamentaux des grandes sociétés, appelées États 2, sont en contradiction directe avec les prétentions publiques, que cependant ils sont indispensables, et qu’aucun philosophe n’a pu encore mettre ces principes d’accord avec la morale, ni même (qui pis est) en proposer de meilleurs qui se puissent concilier avec la nature humaine, de sorte que le chiliasme philosophique, qui espère un état de paix perpétuelle fondé sur l’union des peuples en une république mondiale, mérite, tout autant que le chiliasme théologique, qui s’attend à l’achèvement pour le genre humain tout entier de l’amélioration morale, d’être tourné en ridicule en qualité d’extravagance.
Le principe de ce mal ne peut pas : 1° se trouver, comme on le prétend communément, dans la sensibilité de l’homme, ni dans les inclinations naturelles qui ont la sensibilité pour base. Ces inclinations, en effet, n’ont pas de rapport immédiat avec le mal (elles donnent plutôt à la vertu, manifestation de la force particulière à l’intention morale, l’occasion de se produire) ; nous ne sommes pas non plus responsables de leur existence (nous ne pouvons même pas l’être, parce qu’elles existent en nous naturellement et sans nous avoir pour auteurs), tandis que le penchant au mal engage notre responsabilité, puisque, affectant la moralité du sujet et se trouvant par suite en lui comme en un être libre dans ses actes, il doit pouvoir lui être imputé comme une faute dont il s’est lui-même rendu coupable, et cela nonobstant les profondes racines qu’a ce mal dans le libre arbitre, où il est tellement ancré que l’on est obligé de le dire inhérent par nature à l’homme. – Le principe de ce mal ne peut pas non plus : 2° consister dans une perversion de la raison moralement législatrice ; ce qui supposerait que la raison pourrait elle-même détruire en soi l’autorité de la loi et renier l’obligation qui en découle : chose absolument impossible. Se considérer comme un être libre dans ses actes et se figurer cependant que l’on est affranchi de la loi qui régit les êtres de ce genre (de la loi morale) reviendrait à vouloir concevoir une cause agissant sans aucune loi (car la détermination résultant de lois physiques ne peut pas avoir lieu à cause de la liberté) : ce qui est contradictoire. – Conséquemment, pour fournir le principe du mal moral dans l’homme, la sensibilité contient trop peu ; car elle fait de l’homme, en éliminant les mobiles qui peuvent sortir de la liberté, un être purement animal (bloss thierischen) ; une raison affranchie de la loi morale et pour ainsi dire perverse (une volonté absolument mauvaise) contient trop au contraire, parce qu’elle érige en mobile l’opposition contre la loi même (le libre arbitre ne pouvant se déterminer sans mobiles) et qu’elle ferait ainsi du sujet un être diabolique. – Or, l’homme n’est ni bête, ni démon.