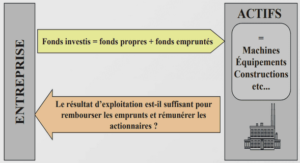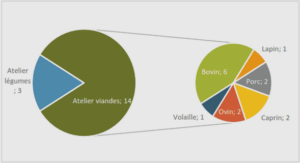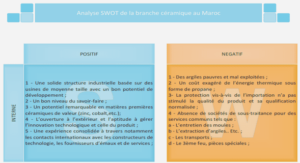Trois générations, trois origines, trois parcours distincts : une biographie croisée :
La formation d’Álvaro Enrigue, de Mario Bellatin et de Roberto Bolaño, qui s’est déroulée dans un contexte intellectuel singulier – la crise du discours moderne et le débat sur la postmodernité des années 80-90 –, est primordiale étant donné qu’elle transparaît dans leurs récits et fait de chacun d’eux des hommes de leur siècle, mais aussi – et surtout – un « échantillon » de la littérature postmoderne latino-américaine.
Bolaño, Enrigue et Bellatin sont issus de lieux et d’époques différentes. Nous avons affaire à un Chilien (Roberto Bolaño), un Mexicain (Álvaro Enrigue) et un Mexico-péruvien (Mario Bellatin). Effectivement, bien que Mario Bellatin soit né au Mexique (México D.F.), il est le fils de deux Péruviens et passa une grande partie de son enfance et de son adolescence au Pérou. Ils sont tous trois nés dans une capitale (Santiago de Chile ou México D. F.) et ont donc été plongés dans un univers urbain dès leur plus jeune âge – ce qui ne les empêcha pas de nourrir une fascination pour le monde rural. Ils ont été confrontés aux modifications urbanistiques constantes qui empruntaient le chemin du progrès. Cette société en « mutation » se retrouve d’une façon ou d’une autre (dans la structure, dans la thématique, dans l’atmosphère) dans les récits desdits auteurs. 1953, 1960 et 1969. Ce sont les dates de naissance respectives de Bolaño, Bellatin et Enrigue. Elles reflètent l’appartenance à des générations différentes. Celle d’Enrigue est pleinement mondialisée et globalisée – quoique cela n’apparaisse que peu d’un point de vue thématique, puisqu’il est passionné par les anciennes civilisations. Celle de Bolaño est à la croisée entre deux mondes, l’un moderne et l’autre postmoderne. Il décida d’ancrer la plupart de ses récits dans cet « entre-deux » ou dans un flou temporel. Quant à Bellatin, il se sent éminemment postmoderne. Il ne cesse de mettre en évidence les ravages de cette période charnière sur le corps, mais aussi sur la langue.
Trois écrivains postmodernes qui se rejoignent dans leur mobilité. Ils parcourent le monde. C’est d’ailleurs le fait de côtoyer diverses cultures qui rendra leur narration hybride. Bolaño passa son enfance dans plusieurs villes du Chili (telles Quilpué, Cauquenes, Viña del Mar ou Los Ángeles). En 1968, il accompagna sa famille à México D. F. pour y suivre la fin de son enseignement secondaire. En 1973, il retourna au Chili pour soutenir le gouvernement socialiste de Salvador Allende, mais fut arrêté par les troupes d’Augusto Pinochet et incarcéré durant huit jours180. L’année suivante, il rentra au Mexique, où il fonda le Mouvement infrarréaliste. Entre 1975 et 1977, il erra entre plusieurs pays : le Chili, le Mexique, le Salvador, la France et l’Espagne. En 1978, il se rapprocha de sa mère qui vivait à Barcelone et y connut la période postfranquiste. Quelques années après, il rencontra sa femme Carolina et s’établit à Blanes, en Gérone, où ses enfants, Lautaro et Alexandra, virent le jour. Il décéda finalement à Barcelone en 2003 d’une maladie dégénérative du foie. Ses multiples déplacements s’apparentent à ceux des professeurs de littérature de « La parte de los críticos » (2666).
Deux toponymes reviennent sans cesse dans les romans d’Enrigue : México et Washington D. C. Cela n’est pas un hasard, car il s’agit des deux points primordiaux de son existence : son lieu de naissance (México D. F.) et son lieu de travail en tant que professeur de littérature (Washington D. C., puis New-York). Dans la fiction Vidas perpendiculares, le protagoniste naît dans le village mexicain de Lagos de Moreno, Jalisco, et poursuit ses études aux États-Unis (Baltimore, Washington D. C., New-York, Delaware). Il mêle peu à peu anglais et mexicain dans son discours, tel un jeu de langues visant à créer un idiome propre enrichi par son hybridité.
La vie de Bellatin fut, tout comme celle de Bolaño, ponctuée de déplacements. Après quelques années passées dans la ville de México D. F., Bellatin déménagea au Pérou avec ses parents. Il suivit le Séminaire Santo Toribio de Mogrovejo de la capitale et fut diplômé en Sciences de la Communications à l’Université de Lima. En 1987, une bourse lui permit de quitter le Pérou pour l’île de Cuba afin d’y étudier le Cinéma. Deux ans plus tard, il regagna le Pérou, avant de retourner dans sa ville natale en 1995 et et de devenir directeur du Département de Sciences Humaines de l’Université du Cloître de Sor Juana.
Bien que l’écrivain latino-américain émigré soit un être globalisé – spectateur et acteur de la globalisation –, ne contribue-t-il pas parallèlement, dans sa condition d’auteur délocalisé, en déplacement181, à l’élaboration d’une nouvelle « esthétique nomade » au niveau national ? En d’autres termes, la globalisation, qui favorise les déplacements (voyages, exils) des auteurs, ne permet-elle pas une « rénovation » de la littérature nationale en apportant un regard, un point de vue extérieur au pays d’origine182, distant, réfléchi, continental, global, « total ».
Malgré la concision et la sobriété qu’il prône, Bellatin est un auteur résolument prolixe. Il a publié à l’heure actuelle pas moins de trente romans, dont, entre autres, Mujeres de sal (1986), Efecto invernadero (1992), Canon perpetuo (1993), Salón de Belleza (1994) et Damas chinas (1995), Poeta ciego (1998), Salón de belleza (1999), El jardín de la señora Murakami (2000), Flores (2002), Perros héroes (2003), Lecciones para una liebre muerta (2005), El gran vidrio (2007), Disecado (2011) et El libro uruguayo de los muertos (2012). L’auteur mexicain a pour objectif d’atteindre le nombre 100, comme le suggère son projet nommé « Los Cien Mil Libros de Mario Bellatin ». Bolaño peut s’apparenter à Bellatin de par la quantité impressionnante de publications à l’heure de sa mort – prématurée – en 2003. En effet, son premier roman La literatura nazi en América (1996), qui mêle deux registres – le grotesque et l’horreur –, puisque l’ouvrage ébauche de portraits d’intelectuels défendant l’idéologie de dictateurs européens, laissa place à une série de publications. Parmi elles : les romans Estrella distante (1996), Los detectives salvajes (1998), Amuleto (1999), Nocturno de Chile (2000), Ámberes (2002), Una novelita lumpen (2002), El gaucho insufrible (2003), 2666 (2004), El Tercer Reich (2010) et Los sinsabores del verdadero policía (2011) ; les recueils de nouvelles Llamadas telefónicas (1997), Putas asesinas (2001) et Diario de bar (2006), El secreto del mal (2007) ; et les recueils de poèmes La Universidad Desconocida (2007) et Tres (2007). Au total, l’on comptabilise treize romans, sept recueils de poèmes, cinq recueils de nouvelles et deux essais.
Le plus jeune de nos auteurs, Álvaro Enrigue, a certes moins de productions à son actif que Bolaño ou Bellatin, mais il n’en demeure pas moins que ses dix romans partagent un même dessein unitaire. Son premier roman, La muerte de un instalador (1996), laisse transparaître son penchant pour la fragmentation, la polyphonie et l’hybridation générique, que l’on retrouve d’ailleurs dans toutes les œuvres suivantes : Virtudes capitales (1998), El cementerio de sillas (2002), Hipotermia (2004), Vidas perpendiculares (2008), Decencia (2011), Retorno a la ciudad del ligue (2012), El amigo del héroe (2012) et Muerte súbita (2013). Il semblerait qu’Enrigue ne cache pas son propos : réécrire à l’infini un même roman afin d’approcher un idéal.
La prolixité des écrivains s’est avérée être un véritable atout pour mon travail car elle m’a permis de sélectionner un ouvrage clé – synecdotiques, représentatifs – de chaque auteur : Flores (2000) de Bellatin, 2666 (2004) de Roberto Bolaño et Vidas perpendiculares (2008) d’Enrigue. L’autre avantage d’une prolifération d’œuvres réside dans une plus grande facilité à reconstituer le « système » de l’écrivain – ou univers littéraire.
Nos trois auteurs dotent leur récit d’une dimension cinématographique, qui s’explique en partie par le culte qu’ils vouent à l’image. Il suffit pour ce d’observer les photographies qui émaillent les textes de Bellatin ou les ekphrasis de Bolaño (description de photos). Mais nous pourrions aussi penser au rythme saccadé des scènes faisant office de déouement, qui rappellent sans conteste les plans successifs d’une séquence d’action d’un film. Parfois, la passion pour les arts visuels se prolonge dans la vie de l’auteur. En l’occurrence, à 27 ans (en 1987), Mario Bellatin se vit octroyer une bourse pour poursuivre ses études de cinématographie à l’École Internationale de Cinéma et de Télevision Latino-américaine de San Antonio de los Baños (Cuba). Puis, de 1999 à 2005, il fut l’un des membres du Système National des Créateurs du Mexique (Sistema Nacional de Creadores de México) et dirigea le département de Lettres et Sciences Humaines de l’Université du Cloître de Sor Juana. En 2001, de nouveau au Mexique, il créa et dirigea l’École Dynamique d’Écrivains (Escuela Dinámica de Escritores), un institut expérimental dont la règle d’or donnée aux futurs écrivains est de ne pas écrire. Par la suite, il a même réalisé les films Bola negra: el musical de Ciudad Juárez (2013) et Salón de belleza (2013). Pour lui, arts visuels et littérature sont intrinsèquement liés, à tel point que certains de ses textes sont illustrés de photographies et/ou émaillés de procédés cinématographiques, donnant une nouvelle dimension à l’œuvre.
Prenons l’exemple de Perros héroes (2003), dont les photographies figurent dans la deuxième partie intitulée « Dossier instalación ». Elles font penser au supplément d’un journal, qui permettrait de comprendre le récit à un autre niveau et de rappeler au lecteur la dimension visuelle de l’écriture ou la dimension textuelle de l’art. L’image et le texte sont permutables. Soit le roman est un objet d’art qui nécessite une légende textuelle, soit il est un texte qui nécessite un support visuel. Bellatin nous montre à travers son roman la relation intrinsèque qu’entretiennent la littérature et la photographie. Finalement, il nous pousse à nous demander : La littérature, est-ce un texte, ou une image mentale ? Par ailleurs, se suffit-elle à elle-même ?
Le Mexicain ne cache pas son attachement au cinéma, duquel il s’inspire profondément pour rédiger ses textes. Il révèle les clés de sa poétique dans une entrevue accordée à Gabriel Agosín de Página/12 : ¿De qué elementos se nutrió para dar con su estilo? –En parte por el cine y particularmente por el montaje: ver realidades comprimidas y cómo se puede encapsular el tiempo con reglas tan definidas. A partir de lo que escribo, que a veces son muchísimas páginas, empiezo a cortar, quitar todo lo que no tiene nada que ver o que más bien fue pie para que apareciera lo que realmente me pudiera interesar. Ahí viene una labor de montaje para crear efectos, pero a partir de una autenticidad que es esa aparición de la escritura.183
Cette citation laisse transparaître une écriture cinématographique, qui condense (capture) et altère le temps, qui repose sur une opération de montage, et plus particulièrement de compression, comme le suggèrent les verbes « cortar » et quitar », comme si le but ultime était de ne conserver que l’essence.
Si l’expérimentalisme de Bellatin réside dans son interdisciplinarité, celui d’Enrigue est spatiotemporelle, puisqu’il pratique le simultanéisme à outrance. Bolaño, quant à lui, place la narration au cœur de son expérience littéraire. Après avoir rédigé un roman constitué d’à peine quelques phrases, dont une qui s’étend sur une centaine de pages (Nocturno de Chile), il propose un discours dense constitué uniquement de questions afin de traduire le flux de pensée de l’un de ses personnages, Fate :
¿Qué es para mí lo sagrado?, pensó Fate. ¿El dolor impreciso que siento ante la desaparición de mi madre? ¿El conocimiento de lo que no tiene remedio? ¿O esta especie de calambre en el estómago que siento cuando miro a esta mujer? ¿Y por qué razón experimento un calambre, llamémoslo así, cuando ella me mira y no cuando me mira su amiga? […] (BOLAÑO, 2004, p. 398-399)
Les questions relatives à la création littéraire sont au cœur de l’Œuvre du Chilien. Il les pose par l’intermédiaire de ses personnages ou les applique directement stylistiquement parlant, comme dans l’exemple ci-dessus.
C’est leur conception expérimentale propre de l’écriture postmoderne, qui se reflète dans leur esthétique, et le projet unitarisant et totalisant qu’ils partagent, qui font de Mario Bellatin, Álvaro Enrigue et Roberto Bolaño, trois écrivains incontournables de l’aire hispano-américaine.
La posture idéologique : modernité vs. postmodernité : i. Des personnages modernes et/ou postmodernes :
Personnage malade = monde malade ?
Comme le souligne la sémioticienne Alicia Vaggione dans son étude intitulée Literatura/enfermedad: el cuerpo como desecho. Una lectura de Salón de Belleza de Mario Bellatin » (2009), « […] se opera un deslizamiento en el que el cuerpo enfermo deviene puro desecho, puro material en el que ya no puede inscribirse ninguna forma de identidad ni ninguna forma de derecho.184 » Le fait de mettre toujours en scène des personnages (réduits d’ailleurs à de simples corps) mutilés, monstrueux et malades correspond à une vision du monde – un monde en déperdition, en souffrance, corrompu, putréfié, contaminé, vide, un « desecho ». Le mal (tant la maladie que le concept moral) se dissémine à grande allure et se transmet à tous les personnages, comme s’il était irrécupérable. La tonalité qui l’emporte est donc pessimiste, fataliste et l’espoir n’a plus sa place. Ainsi, les personnages des œuvres de Bellatin, Bolaño et Enrigue témoignent d’un désir de représenter une société malade, tout autant que le sont les personnages, bien que sous différentes formes chez chacun d’eux. Si les personnages de Bellatin souffrent le plus souvent d’une infirmité, la solitude et l’isolement sont le lot quotidien de ceux de Bolaño, tandis que la corruption et la multiplication185 affecte ceux d’Enrigue. Quoi qu’il en soit, les protagonistes des trois auteurs sont marginaux. Ils vivent en marge d’une société dans laquelle ils ne trouvent ni leur place, ni leur identité. C’est le reflet d’une société malade, amputée, mutilée, mutante, immatérielle et vide – postmoderne – que l’on voit à travers eux.
La forme comme témoignage d’une inscription dans la (post)modernité :
Les oeuvres des trois auteurs cristallisent elles aussi la position qu’ils affichent face àvis-à-vis de la postmodernité. Par exemple, Condición de las flores (2008) de Bellatin, un recueil de maximes et de phrases sur l’écriture, révèle les « […] procesos de escritura de Mario Bellatin o qué supone para él la condición de ser escritor y trabajar perpetuamente con palabras (flores) que está obligado a intentar hacer que perduren aunque esto suponga sustraerles gran parte de su frescura y olor.186 » Ledit livre dévoile quelques clés de l’interprétation de l’Oeuvre du Mexicain – particulièrement de Flores (2000) –, comme la métaphore florale, qui renvoie au processus de création littéraire, aux mots, disséminés tels des pétales dans ses oeuvres, et comme la prégnance du pessimisme et du thème métaphysique de la mort dans ses écrits (« sustraerles gran parte de su frescura y olor. »). Cette dernière citation met en lumière l’esthétique de Bellatin, qui repose sur la « dévitalisation » des mots, sur l’extraction de leur carapace, de leur enveloppe appétante, séduisante, pour y dénicher leur (quint)essence, leur sens profond. La fleur est donc une métaphore métafictionnelle ; Bellatin l’effeuille pour accéder au pistil, de la même façon qu’il dés-écrit pour accéder au sens caché d’un mot, et par extension, de la réalité, du monde. Il dissèque, ce qui vaut le titre Disecado à son roman de 2011. Cette métaphore de la fleur est révélatrice du choix esthétique assumé par Bellatin ; l’écriture fragmentaire postmoderne.