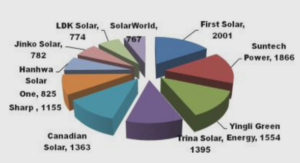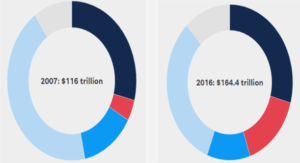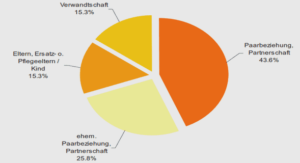Le développement coopératif en Afrique jusqu’aux années 1990 Patrick Develtere
Il est bien rare de devoir repartir de zéro dans quelque situation que ce soit et cela se vérifie certainement pour le secteur coopératif en Afrique. Le regain d’intérêt affiché par les groupes communautaires, les agences gouvernementales et même les bailleurs de fonds pour les entreprises coopératives s’accompagne d’un réveil des anciennes coopératives et d’un taux de création rapide de nouvelles structures de ce type. Néanmoins, tous les acteurs impliqués opèrent dans un environnement largement influencé par l’histoire, tant culturellement qu’institutionnellement. Aussi motivés qu’ils puissent l’être pour prendre un nouveau départ ou éviter les erreurs commises auparavant, leur marge de manœuvre est limitée par les expériences passées, les habitudes et modèles culturels, les relations établies et les cadres juridiques et institutionnels. L’histoire a laissé sa marque. Si l’objectif de ce livre est de dresser un état des lieux précis de l’action coopérative en Afrique et d’identifier de nouvelles trajectoires prometteuses, nous devons être conscients de la délicate dépendance des acteurs et des décideurs à l’égard des conditions initiales, passées et présentes. C’est pourquoi nous étudierons en profondeur l’évolution du secteur coopératif africain dans son contexte historique, sur la base des travaux de Charles Kabuga (2005), d’Ada Souleymane Kibora (2005), de Jan Theron (2005), de Manuel Canaveira de Campos (2005) et de Patrick Develtere (2005).
Pourquoi étudier les traditions coopératives ?
Deux raisons justifient que nous attachions une telle importance à l’étude des traditions et des trajectoires passées du développement coopératif en Afrique. D’abord, le modèle coopératif en Afrique est une transmission et ensuite, le secteur coopératif porte un lourd héritage qui conditionne son cheminement.
Tout d’abord, le secteur coopératif en Afrique fut introduit par des agences extérieures, au premier rang desquelles les autorités coloniales. Les coopératives furent donc souvent perçues comme des institutions étrangères, dans presque tous les territoires. Les Britanniques, les Français, les Portugais, les Espagnols, les Allemands et les Belges apportèrent à leurs colonies respectives leur vision des coopératives. Outre leur représentation du rôle de ces structures dans un environnement colonial, ils introduisirent des mécanismes pour stimuler le développement coopératif, notamment des cadres juridiques, des programmes incitatifs et des systèmes de financement. Ces initiatives donnèrent le ton au développement coopératif en Afrique. Le secteur coopératif ne fut donc pas la résultante d’un mouvement local ou spontané mais celle de pratiques coloniales dans la sphère socio-économique. Par conséquent, il n’eut dès le départ que peu de liens, voire aucun, avec les systèmes pré-coloniaux, «traditionnels» ou endogènes existants en matière de solidarité ou d’économie, et cela bien que de tels systèmes subsistent, jusqu’à aujourd’hui encore, dans tous les pays concernés. Une documentation abondante montre en effet que l’idir en Ethiopie, les tontines au Cameroun et dans d’autres régions d’Afrique de l’Ouest, les stokvels en Afrique du Sud, les groupes de partage du travail et les sociétés funéraires de la plupart des pays impliquent toujours largement la population. Contrairement aux formes modernes de coopération et de mutualisme, ces systèmes endogènes ne possèdent pas de mécanismes intégrés d’expansion ou de croissance et sont – dans la plupart des cas – mobilisés sur une base ad hoc ou accidentelle. Il est également remarquable que dans les pays n’ayant pas connu de longues périodes de colonialisme ou non soumis au régime colonial comme l’Ethiopie ou le Liberia, le «coopérativisme moderne» ne soit pas issu de ces systèmes locaux mais de politiques délibérées des autorités inspirées des expériences internationales en matière de développement coopératif. Nous savons aujourd’hui que les coopératives «modernes» sont d’autant plus prospères qu’elles s’appuient sur des normes et des valeurs en accord avec celles inhérentes aux systèmes pré-existants ou parallèles (même si, sur un plan institutionnel, il n’y pas de liens entre les unes et les autres). Il est donc primordial de comprendre comment les coopératives ont été introduites, sur quelle philosophie elles s’appuyaient et comment cela était relié au comportement coopératif, tant social qu’économique, observé dans la région.
Deuxièmement, le développement coopératif est largement influencé par ce que les économistes et autres spécialistes des sciences sociales appellent la «path dependency», terme anglophone que l’on pourrait traduire par la «dépendance au chemin parcouru». Les conditions antérieures et les choix ou décisions passés déterminent le chemin qu’il emprunte. Les institutions demeurent et il est difficile de s’en défaire même si elles sont notoirement anachroniques ou, pire encore, font obstacle à de nouveaux choix ou décisions. Cela apparaît évident, par exemple, quand nous constatons combien le développement coopératif était lié à la stratégie des autorités en matière de cultures d’exportation plutôt qu’aux stratégies de commercialisation des coopérateurs. Cela fut au départ un choix délibéré des administrations coloniales qui percevaient les coopératives comme de simples instruments au service de leur stratégie d’exportation de marchandises. Les coopératives devaient contribuer à organiser les petits et les grands producteurs de café, de cacao, de bananes, de coton ou d’autres cultures d’exportation et assuraient le contrôle de la qualité, les traitements après récolte, le transport et l’exportation pour le compte des autorités coloniales. Les gouvernements en place après l’indépendance conservèrent cette structure et même généralisèrent et renforcèrent le lien coopérative-exportation en transformant les coopératives agricoles en sous-traitants, exécutants ou filiales des puissants offices de commercialisation. Le rapport spécifique établi dans la plupart des colonies entre gouvernement et coopératives est un autre exemple de «path dependency». Le gouvernement prit la direction des coopératives alors que selon l’opinion internationalement reconnue, ces organisations sont avant tout fondées sur l’adhésion, le volontariat et l’autonomie. En Afrique, les praticiens et les décideurs du monde coopératif savent très bien combien la tutelle du gouvernement continue à étouffer l’initiative coopérative privée et l’innovation. La culture coopérative, avec le discours, le jargon et les habitudes propres aux mouvements ou secteurs coopératifs d’un pays spécifique, est aussi largement tributaire d’une trajectoire entamée il y a quelques dizaines d’années. L’étude de ces traditions nous aide à comprendre pourquoi, dans certains pays, les participants concluent chaque assemblée générale annuelle par un hymne la gloire de la coopérative tandis que dans d’autres, ils l’ouvrent avec une prière. Certains pays auront une culture coopérative formelle et d’autres seront plus pragmatiques. Dans certains milieux, les coopératives seront une affaire d’hommes; dans d’autres, relativement plus rares, la participation des femmes mais aussi les valeurs féminines seront appréciées. Dans certaines régions, les coopératives s’exposeront et seront perçues comme des rassemblements d’hommes pauvres (ou de travailleurs) qui remplissent essentiellement des fonctions sociales; dans d’autres régions, elles seront présentées comme les instruments sociaux et économiques d’une classe animée par un esprit d’entreprise. Les cultures coopératives sont ainsi dépendantes du chemin parcouru.
Cette dépendance caractérise également les structures et les réseaux coopératifs. Le secteur coopératif se compose de coopératives primaires, de coopératives secondaires, de fédérations, d’organisations faîtières, d’agences de promotion, de centres de formation, etc. Les coopératives sont en relation avec des organismes d’Etat et intégrées ou liées à des entités supranationales ou internationales qui peuvent être de type coopératif ou pas. Ce composant structurel du secteur coopératif est aussi très dépendant de sa trajectoire historique et des nombreuses interactions avec les agents nationaux et internationaux ayant participé à la construction du secteur ou du mouvement.
Cette dépendance caractérise également les structures et les réseaux coopératifs. Le secteur coopératif se compose de coopératives primaires, de coopératives secondaires, de fédérations, d’organisations faîtières, d’agences de promotion, de centres de formation, etc. Les coopératives sont en relation avec des organismes d’Etat et intégrées ou liées à des entités supranationales ou internationales qui peuvent être de type coopératif ou pas. Ce composant structurel du secteur coopératif est aussi très dépendant de sa trajectoire historique et des nombreuses interactions avec les agents nationaux et internationaux ayant participé à la construction du secteur ou du mouvement.
Le poids de l’histoire est lourd mais nous n’en déduisons pas pour autant que les coopératives et les secteurs coopératifs sont totalement et indéfiniment enfermés dans une certaine tradition immobile. Si tel avait été le cas, nous n’aurions pas identifié autant de variantes et d’évolutions. Au contraire, nous constatons que les trajectoires des coopératives ont changé au fil du temps et qu’elles sont spécifiques aux contextes. Elles ne sont ni linéaires ni irréversibles mais amendables. Les populations et leurs coopératives sont créatives; elles connaissent les paramètres de la tradition coopérative dont elles font partie, peuvent identifier ses pièges et engager des modifications ponctuelles ou des transformations radicales.
Cinq traditions coopératives en Afrique
Il est tentant de relier les traditions coopératives aux origines ou aux expériences coloniales en Afrique. Il y aurait simplement la tradition coopérative britannique, celle de la France, de la Belgique et du Portugal. Il est indéniable que ces quatre puissances coloniales ont, de façons différentes, introduit la coopération moderne dans leurs anciennes colonies. En fait, il n’est pas difficile d’identifier des similitudes entre les systèmes coopératifs du Kenya et du Ghana, deux anciennes colonies britanniques, de même qu’il est relativement aisé de comparer les expériences sénégalaise et togolaise dans ce domaine, issues toutes deux du colonialisme français.
Néanmoins, quatre bonnes raisons au moins militent en faveur de l’abandon de cette approche des traditions coloniales dans l’étude des coopératives africaines. Premièrement, les autorités coloniales dirigèrent effectivement le développement du secteur coopératif dans leurs territoires mais ne procédèrent pas de la même manière partout. Deuxièmement, le modèle coopératif fut reçu très différemment selon les lieux. Troisièmement, faire des racines ou des origines coloniales d’un modèle les références majeures porte à croire qu’elles ne sont que les prolongations coloniales de systèmes testés dans le pays colonisateur. Mais, comme nous le verrons, les promoteurs des coopératives coloniales ne pensaient pas que l’expérience acquise dans leur pays d’origine serait facilement reproductible dans les colonies. Enfin, le paysage coopératif a considérablement changé depuis l’introduction des premières coopératives en Afrique et faire référence aux traditions coloniales ne nous aide pas à nous représenter ces évolutions.
C’est pourquoi nous nous appuyons sur un schéma de caractérisation systémique et suggérons cinq traditions pour déterminer l’identité coopérative. Les caractéristiques de ce schéma peuvent avoir des origines coloniales mais pas forcément. Et si c’est le cas, cela ne signifie pas que ces dernières sont «génétiquement» enracinées. Elles sont plus ou moins apparentes et peuvent varier.
Nous identifions donc une tradition de modèle unifié, une tradition d’économie sociale, une tradition de mouvements sociaux, une tradition de producteurs et une tradition indigène. Précisons tout de suite que les secteurs coopératifs des pays africains peuvent s’inspirer de plusieurs de ces traditions à la fois. Chacun de ces secteurs est donc une configuration unique renvoyant à une ou plusieurs traditions, modelée par des acteurs différents à des époques différentes.
La tradition de modèle unifié trouve son origine dans la tentative des Britanniques, dans leur pays comme dans les colonies, d’élaborer un mouvement coopératif unique. Les promoteurs de ce modèle suggèrent donc un système à plusieurs niveaux avec des coopératives primaires à la base et une seule organisation faîtière au sommet. Entre les deux, on trouve des coopératives secondaires (sous forme de sections, fédérations et unions régionales) qui participent l’intégration horizontale et verticale du mouvement. Ce modèle a pour dénominateur commun la forme juridique des coopératives.
Dans la tradition d’économie sociale, fortement représentée dans beaucoup de pays francophones et hispaniques, une coopérative n’est qu’une des nombreuses entités juridiques ou institutionnelles qui rassemblent des personnes poursuivant les mêmes objectifs sociaux et économiques. Les mutuelles, les associations, les fondations et les trusts sont des formes apparentées aux coopératives et peuvent remplir les mêmes fonctions. Dans cette tradition, les parties partagent des objectifs, pas les vertus d’un modèle coopératif.
Dans la tradition des mouvements sociaux, assez différente des deux précédentes, un groupe d’intérêt ou une organisation sociale établie comme syndicat, association de femmes ou d’agriculteurs conduit ses membres à se rassembler au sein d’une coopérative. Cette dernière est un instrument d’action collective, parmi beaucoup d’autres. Le système de coopération belge est solidement ancré dans cette tradition et a influencé la pensée et la pratique coopératives en Afrique centrale.
Dans la tradition des producteurs, les coopératives sont perçues comme des véhicules économiques pour les producteurs agricoles. Ce sont des instruments fonctionnels au service des entrepreneurs ou des ménages en zone rurale qui les aident à se procurer des objets de consommation de qualité et à commercialiser leurs produits. Leur rôle économique consiste à se rapprocher des objectifs sociaux. Très bien enracinée dans le système coopératif portugais, cette tradition a inspiré la stratégie coloniale portugaise de développement coopératif en Afrique.
Ces quatre traditions importées en Afrique par des entités externes – coloniales – n’ont jamais constitué un panorama coopératif complet de ce continent. Elles ont laissé de la place pour la cinquième tradition coopérative baptisée sui generis, c’est-à-dire auto-générée ou indigène. Celle-ci concerne les pays qui furent peu exposés au colonialisme comme l’Ethiopie, la Sierra Leone, le Liberia ou l’Egypte, où la coopération moderne fut initiée par des agents locaux qui expérimentèrent une combinaison d’idées empruntées et d’adaptations locales pour répondre aux problèmes socio-économiques.
Les débuts
Comme nous l’avons exposé dans les pages précédentes, les coopératives africaines furent créées essentiellement par des agents extérieurs en réponse des nécessités sociales et économiques. Il convient maintenant d’identifier les conditions qui déclenchèrent l’établissement des coopératives. Les réponses diffèrent selon les régions et les colonisateurs.
Vers un modèle coopératif unique dans les colonies britanniques
Concernant les territoires anglophones en Afrique, Kabuga (2005) affirme juste titre que les coopératives n’auraient jamais dû émerger à l’époque où elles l’ont fait, ni de la même manière, si ce n’était en raison des cultures de rente introduites par les Britanniques. Le développement rapide de ces cultures d’exportation finit par être dominé par quelques puissantes entreprises familiales d’Asiatiques et d’Européens solidement établies qui achetaient, transformaient et exportaient les récoltes au travers d’intermédiaires. Le rôle des agriculteurs se limitait à produire des denrées payées chichement par les intermédiaires. Souvent, les premières coopératives furent établies en Afrique en protestation contre les conditions commerciales peu avantageuses que les intermédiaires imposaient aux paysans. En Ouganda, par exemple, et dès 1913, des agriculteurs décidèrent de commercialiser leurs récoltes dans un cadre coopératif et d’autres associations de cultivateurs les imitèrent par la suite. En 1920, cinq groupes d’agriculteurs formèrent la Buganda Growers Association (association des planteurs de Buganda) qui devint plus tard l’Uganda Growers Cooperative Society (coopérative des planteurs d’Ouganda) qui avait pour finalité principale de commercialiser le coton et de représenter ses membres auprès du gouvernement.
Dans le même ordre d’idée, la Kilimanjaro Native Farmers Association in Tanganyika (association des agriculteurs du Kilimandjaro au Tanganyika) (en Tanzanie) fut la première association indigène de producteurs africains de café, constituée en 1925, qui lutta contre le monopole détenu par des colons européens.
Au Ghana, le cacao représentait des revenus cruciaux pour l’Etat. Dès les années 1920, les Ghanéens découvrirent les avantages des actions collectives pour négocier des droits sur les terres et partager la charge de l’entretien des jeunes cacaoyers. Cependant, le commerce d’exportation restait aux mains d’entreprises européennes. Voulant à tout prix augmenter leur part des revenus des exportations de cacao, celles-ci formèrent une structure d’achat secrète qui permettrait à quatorze d’entre elles de contrôler les prix payés aux courtiers africains. Les groupes coopératifs eurent vent de cet arrangement et jouèrent un rôle déterminant dans le «hold up du cacao» qui amena les agriculteurs à retirer cette denrée du marché pour provoquer une hausse des cours. L’administration coloniale britannique abhorrait ce genre de groupes organisés car ils menaçaient le statu quo politique et économique. Cela explique qu’initialement, toute couverture légale ait été refusée aux groupes coopératifs au Ghana et dans d’autres pays anglophones.
Les responsables coloniaux libéraux en Afrique s’inspirèrent du modèle de coopération britannico-indien développé en Inde et à Ceylan (l’actuel Sri Lanka) à partir de 1904. L’idée de base était, comme Münkner (1989: 103) l’a observé, «de pallier l’absence d’initiative et de savoir-faire technique de la population locale en recourant aux services de fonctionnaires d’un organisme d’Etat spécialisé (département des coopératives) dirigé par le Registrar, ce qui, à terme, permettrait de créer de coopératives autonomes». Dans les années 1930 et 1940, des Cooperative Societies Ordinances (ordonnances sur les sociétés coopératives) furent promulgués dans beaucoup de pays africains sous tutelle anglophone et des départements pour le développement coopératif furent créés. Une tradition de coopération constructive, non antagoniste et selon un modèle unique fut donc institutionnalisée. Les départements devaient créer des coopératives, les promouvoir et les conseiller pour qu’elles gèrent leurs activités conformément à des principes internationalement reconnus. Les Registrars disposaient de fonctions étendues, de pouvoirs discrétionnaires et d’un nombre considérable d’assistants, auditeurs, comptables et superviseurs, très largement supérieurs à ceux du Registrar britannique des Friendly Societies (mutuelles) de l’époque.
Des coopératives semi-publiques aux sociétés mutuelles dans les colonies françaises
Contrairement à la Grande-Bretagne, la France opta pour une intervention directe dans l’organisation et l’administration des structures locales en Afrique. En Algérie, par exemple, et dès 1875, les autorités coloniales créèrent des banques céréalières au sein des communautés locales pour éviter les pénuries alimentaires et la famine. Une loi de 1893 fixa le cadre des sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels (SIP). Fort de l’expérience acquise auprès de ces sociétés en Algérie, en Tunisie et en Indochine, le gouvernement de l’empire colonial prescrivit par décret en 1910 l’établissement de sociétés de prévoyance en Afrique occidentale française. Ces sociétés remplissaient des tâches multiples: constitution et tenue d’un stock de marchandises, fourniture d’outils agricoles, transformation de produits agricoles, assurance en cas de sinistre et d’accidents, octroi de prêts, amélioration des méthodes de production, entres autres. L’idée d’origine était d’encourager les initiatives de prévoyance traditionnelles et spontanées dans un cadre coopératif et volontaire moderne mais les autorités françaises leur donnèrent vite un caractère systématique et obligatoire. La base territoriale de ces institutions semi-publiques s’étendait bien au-delà du village. Leur administration était assurée par des fonctionnaires coloniaux.
Après la Seconde Guerre mondiale, des sociétés coopératives autonomes fonctionnant parallèlement aux sociétés de prévoyance purent voir le jour grâce à l’extension aux territoires d’outremer de la législation française sur les coopératives. Cependant, contrairement aux Britanniques, les Français n’intervinrent pas dans la promotion et la supervision de ces coopératives. Ils réagirent seulement lorsque le mouvement coopératif émergent commença à montrer sa force politique, en bloquant l’intégration naissante du mouvement et en s’impliquant dans le fonctionnement quotidien des coopératives. L’implication d’organismes publics et semi-publics pourtant nombreux dans le développement coopératif ne déboucha jamais sur une stratégie coopérative globale comparable à celle des Britanniques. Les Français s’appuyèrent principalement sur la méthodologie d’«animation rurale» dans l’organisation des coopératives. C’était un moyen d’orchestrer l’implication des paysans dans le cadre de plans agricoles conçus à un niveau central. Avec la transformation des sociétés de prévoyance en sociétés mutuelles de production rurale puis en sociétés mutuelles de développement rural, les Français indiquèrent clairement que leur objectif ultime était le développement rural et que les coopératives n’étaient pas la seule forme institutionnelle et juridique privilégiée.
La double voie coopérative en Afrique centrale belge
Au Congo belge et dans le territoire appelé à l’époque Rwanda-Urundi, les indigènes furent autorisés à mettre sur pied leurs propres coopératives dès les années 1920. Le cadre de référence, à savoir la très libérale législation métropolitaine belge sur les coopératives, ouvrit la porte aux entreprises semi-publiques appelées coopératives dans les colonies, qui devaient à la fois générer des revenus pour les structures administratives tribales établies et produire des avantages pour la population locale. Ce système hybride ressemblait aux sociétés coopératives municipales (publiques) créées en Belgique (Lambert, 1963). En Afrique centrale, les activités de ces coopératives étaient très variées: produits laitiers, construction et «industries tribales» (poterie, huileries et tannage). Nombre de ces coopératives publiques faisant concurrence à des entrepreneurs européens privés, ce système dut être révisé dans les années 1940. Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités coloniales belges commencèrent à promouvoir les coopératives indigènes en tant que vecteurs de leur politique sociale, éducative et agricole. Des départements des coopératives furent créés au sein des autorités nationales et provinciales. Les gouverneurs des provinces étaient directement impliqués dans la stratégie de développement coopératif. Ils devaient enregistrer les nouvelles coopératives et fixer les prix auxquels elles achèteraient la production de leurs membres. Les gouverneurs devaient également nommer les comités éducatifs et les conseillers des coopératives, ce qui était caractéristique de l’approche paternaliste des Belges. Deux des quatre membres de ces comités devaient avoir la nationalité belge. Le gouverneur nommait également un «contrôleur» chargé de l’inspection financière et disposant d’un droit de veto. L’équipe de gestion était nommée par le «commissaire de district».
Mais le cadre juridique plutôt libéral et la politique originale de laissez-faire des autorités belges laissèrent de l’espace aux acteurs locaux dans les colonies. Les missionnaires catholiques, pour beaucoup issus de familles très impliquées dans les coopératives des mouvements de travailleurs et d’agriculteurs catholiques en Belgique, créèrent des coopératives d’épargne ou de crédit (COOPEC). Des coopératives indigènes en mauvais termes avec les autorités coloniales parce qu’elles faisaient concurrence à des hommes d’affaires belges reçurent le soutien et l’appui de missionnaires. Lorsque les problèmes persistèrent et que les autorités coloniales refusèrent de reconnaître les sociétés ou unions coopératives locales, les missionnaires et les coopérateurs indigènes se tournèrent vers des pré-coopératives, des associations ou des unions professionnelles.