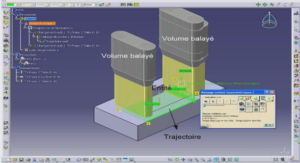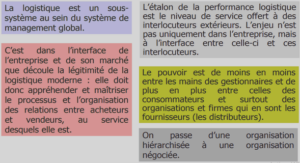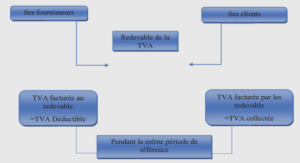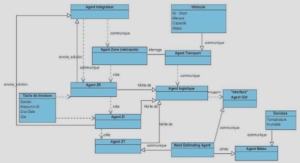IDENTITÉ (S), UN MOT VALISE POUR DES APPROCHES MULTIPLES
Dans son sens premier, selon le Petit Robert, l’identité est le caractère de ce qui est identique (unité). Le mot vient du bas latin identitas, dont la racine est idem, « le même ». Dans un sens second, c’est le caractère de ce qui est UN (unicité, unique). Dans un troisième sens, l’identité est le caractère de ce qui demeure identique à soi même (permanence). Ces trois sens forment la base définitoire du concept, mais il reste ambigü. D’ailleurs, pour Erik H. Erikson, qui a introduit le concept d’identité dans les sciences humaines, « plus on écrit sur ce thème et plus les mots s’érigent en limite autour d’une réalité aussi insondable que partout envahissante.» Ce qu’il écrivait il y a plus de quarante ans est encore plus vrai aujourd’hui, compte-tenu de l’emploi massif du concept, aussi bien dans la terminologie scientifique que dans le langage social. Dans la vie courante, deux représentations de l’identité semblent dominer. L’une est substantialiste : l’identité collective est conçue comme la richesse d’un groupe humain qui se transmet de génération en génération et qu’ « il ne faut pas perdre ». L’autre est –si l’on peut dire– animiste : c’est-à-dire qu’elle voit en l’identité « l’âme » d’une population, son être profond. Ces deux représentations ne sont d’ailleurs pas incompatibles et le patrimoine culturel est parfois perçu comme le symbole de l’âme collective. Personnellement, je suggère d’aborder l’identité davantage comme une représentation que l’on produit que comme une réalité que l’on reproduit. L’identité est un construit, pas une donnée. Nous avons tous une identité individuelle, qui a plusieurs facettes. Il y a, à la fois, l’appartenance à un sexe, à une génération, à une famille, à un milieu social, à une collectivité… avec des intersections et, avec, éventuellement, des contradictions. Il n’y a pas formule plus fausse que «depuis toujours ». Rien n’existe « depuis toujours », ni dans la nature ni dans la moindre construction humaine. Les historiens Alain Croix et Jean Yves Veillard précisent : « Culture, patrimoine, identité ont (donc) toujours été ouverts aux apports extérieurs et c’est particulièrement vrai dans une région qui a fondé sa richesse et une large part de sa culture sur l’ouverture. Les Bretons sont des immigrés, un peu anciens certes -mais quinze siècles sont si peu à l’échelle de l’histoire-, ils ont sans cesse importé œuvres d’art et idées, accueilli des créateurs en tout genre -de la peinture à la conserve alimentaire-, exporté tout autant.» Ce qui est différent, dans l’identité, aujourd’hui, par rapport à des temps plus anciens où chacun était conditionné dans son identité (un serf, sous l’ancien régime, opprimé par son appartenance sociale, avait peu de choix…), c’est la subjectivité. Il est possible de bricoler son identité. Nous sommes libres de nous identifier ou pas à nos communautés d’appartenance. En lien, explique Michel Wierviorka , la notion d’ethnicité combine trois éléments : l’individualisme hérité des Lumières, les appartenances communautaires et la subjectivité qui mélange les deux.
L’identité bretonne, une identité ouverte
Ces concepts d’identité et d’ethnicité forgent un modèle qui semble faire majorité chez les Bretons, selon des observateurs comme Ronan Le Coadic ou Pierre-Jean Simon : celui d’enchâssement identitaire plus visualisable sous l’image de « poupées gigognes », un emboîtement de différentes identités. Une identité peut-être multidimensionnelle, tout en faisant preuve d’une relative unité, à la condition sans doute que les poupées s’emboîtent correctement les unes dans les autres. On peut être, tout à la fois, de son quartier, de son village, de son département et de bord de mer, de l’intérieur des terres, des îles, d’une grande ville… On peut-être d’une identité territoriale qui se croise avec son identité professionnelle, sexuelle… comme l’exprime bien la vice-présidente aux solidarités internationales de la Région Bretagne, Farough Salami, au journal Ouest-France, le 7 février 2016 : « Oui, je suis française, et bretonne, et européenne et aussi iranienne. Ces identités ne s’excluent pas, elles se conjuguent harmonieusement.» .
J’en ferai la démonstration, les Bretons se sentent du groupe social des Bretons. Selon Ronan Le Coadic, « toute identité collective est une représentation sociale chargée de beaucoup d’émotion, et non pas une réalité concrète invariable dans l’espace et dans le temps.» .
L’identité bretonne ne fait pas exception. Les matériaux dont elle est constituée, images mentales d’origine parfois très ancienne, ont toujours été et sont encore un objet de luttes symboliques dont l’enjeu varie selon les époques mais relève toujours de la politique, au sens large du terme. C’est une construction de l’esprit.
Stigmates et effets du retournement de l’identité négative en Bretagne
En quelques décennies, l’appréciation de l’identité bretonne a beaucoup changé. D’abord déconsidérée, elle a ensuite été revendiquée, avant de devenir prisée. Cependant, la société bretonne actuelle garde vivantes les traces de cette histoire récente. Ainsi, l’identité dite négative n’a pas totalement disparu ; des stigmates honteux subsistent. Le sociologue Fañch Elegoët a bien décrit le phénomène de l’identité négative comme une réponse au mécanisme mis en œuvre pour faire disparaître la langue bretonne en y substituant le français. Cet auteur traduit les trois sentiments qui amènent un peuple à abandonner sa langue : la honte, l’impuissance devant le fait de se sentir un individu arriéré, le désir d’accéder à la langue française considérée comme la langue du maître, et corrélativement, du progrès. Selon lui, les personnes de la deuxième génération nées entre les deux guerres ont fortement intériorisé l’idéologie du système social dominant. À leurs yeux, leurs productions culturelles propres sont profondément dévaluées. Ils interviennent pour interdire la pratique de ce patrimoine et se font l’agent de la censure sociale. Ces locuteurs natifs mènent alors un refus violent de tout matériel ou symbole de l’identité bretonne en affirmant que « maintenant, c’est moderne, c’est le progrès !». «Le breton est parti parce que les gens avaient honte de parler breton. On riait de ceux qui parlaient breton » , dit une personne au sociologue qui relève par ces entretiens le sentiment de domination qu’ont subi ces populations et les conséquences induites de « dominé». La stratégie du dominé consiste -selon lui- en une tentative de conformation maximale aux normes dominantes, linguistiques entre autres, et par des tentatives d’auto destruction. La domination a pu se traduire par de la passivité, de l’apathie, de la résignation à cette fatalité. C’est ainsi que, même après avoir appris parfaitement le français et avoir fait des études supérieures à leurs enfants, nombre de Bretons auraient toujours peur d’être de nouveau rejetés dans l’obscurité de l’humiliation. Ils peuvent alors devenir, à leur tour, les pires détracteurs de leur langue maternelle et de leur culture. « Un monde mourait à toute vitesse -notre monde. Le temps était venu du rejet de soi-même, du dégoût. Une sorte de frénésie nous gagnait : si nous avions pu, nous nous serions même arrachés la peau » écrit Michel Le Bris et, Fañch Elegoët complète : « Nous avons compris que notre monde était vieux, nos maisons sales, notre langue… bref, que nous n’étions pas civilisés […] Le dominant agit fondamentalement par l’infériorité, le dénigrement systématique, la dévalorisation de l’existence entière du dominé. Et ceci s’intériorise. Cette pratique entraîne pour l’autre une honte de soi, en d’autres termes, induit une impossibilité à assumer son identité.» .
Introduction |