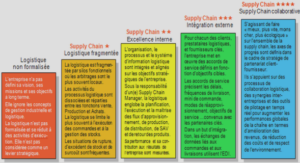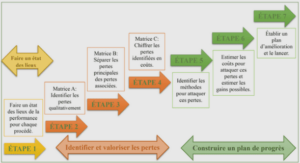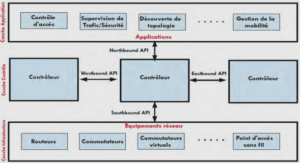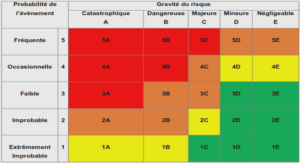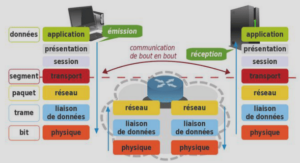Démarche générale pour limiter la douleur en élevage
La douleur est un élément du bien-être animal qui doit être pris en compte au cours des différentes étapes des systèmes d’élevage des animaux de production. Les moyens d’agir pour prévenir et contrôler la douleur doivent impérativement être adaptés aux besoins individuels des animaux et ils doivent aussi prendre en compte leurs caractéristiques comme l’espèce, la race, l’âge, leurs particularités comportementales et le type de procédure douloureuse réalisée, ainsi que l’étendue de l’atteinte tissulaire et l’intensité de la douleur provoquée (Bufalari et al., 2007).
Les experts du comité Brambell ont explicité en 1965 les cinq droits fondamentaux (de l’anglais, « the five Freedom ») des animaux destinés à la production de denrées alimentaires (Brambell, 1965). Ces cinq points définissent les critères minimaux pour assurer le bien-être des animaux d’élevage :
• L’absence de faim, de soif et de malnutrition, par un accès permanent à de l’eau potable et à une alimentation couvrant les besoins physiologiques ; • L’absence d’inconfort, par un accès à un environnement approprié à l’espèce, incluant des zon
es de repos ; • L’absence de douleurs, de blessures et de maladies, par des soins vétérinaires préventifs, des diagnostics rapides et des traitements adéquats ; • La possibilité d’exprimer les comportements normaux appartenant au répertoire de l’espèce, par l’accès à des espaces suffisants, à des infrastructures adéquates et en compagnie de congénères de la même espèce ; •
L’absence de situations génératrices de peur et d’anxiété, en assurant des conditions d’environnement et des traitements qui évitent la souffrance mentale. La prise en charge de la douleur chez les animaux d’élevage devrait donc faire partie intégrante des systèmes de production.
La règle des « 3S » comme principe à prendre en compte pour limiter la douleur chez les animaux d’élevage L’usage des animaux de laboratoire (rongeurs, lagomorphes, porcs, petits ruminants,…) dans le cadre de l’expérimentation animale est un domaine où historiquement l’utilisation des animaux par l’homme avait révélé des insuffisances en matière de bien-être animal.
Les progrès dans ce domaine ont été considérables et la démarche suivie pour les animaux de laboratoire est exemplaire pour toute démarche visant à améliorer le sort d’animaux utilisés par l’homme. Sans remettre en question l’intérêt de l’utilisation des animaux par l’homme dans un but scientifique,
la question éthique de limiter au plus les maltraitances et les douleurs des animaux de laboratoire s’est imposée dès la fin du XIXème siècle (Autissier, 2008). Ce sont les principes de William Russell et Rex Burch (1959) qui ont fondé la manière actuelle d’appréhender le problème de l’utilisation des animaux de laboratoire.
Reconnaissant que tout être capable de souffrance mérite de la considération (Singer, 1977), il a été proposé que tout devait être entrepris pour remplacer les animaux par des approches alternatives, pour en réduire le nombre au minimum nécessaire lorsque leur utilisation était incontournable, et enfin d’améliorer (raffiner) les procédures employées pour qu’elles causent le moindre mal, les moindres douleurs et les moindres souffrances (Flecknell, 2002).
Ces considérations (nommées les « 3R » : Replace, Reduce, Refine), initialement négligées et peu prises en compte, se sont finalement imposées et régissent désormais l’utilisation des animaux en recherche expérimentale. Elles influencent toute la réglementation sur le contrôle de l’expérimentation animale et elles sont reprises dans plusieurs textes législatifs (ex.
L’Animal Procedures Act au Royaume-Uni). Ces règles ont orienté la façon de rechercher les solutions pratiques permettant de limiter et de rationnaliser. l’utilisation des animaux de laboratoire et elles ont été incitatrices de travaux scientifiques à mener sur ce sujet.
De plus, la mise en place d’un système permettant de guider la recherche de solutions au problème de la douleur et des souffrances animales a eu des répercussions positives sur la qualité des résultats scientifiques et sur les conditions de travail des personnels en contact avec ces animaux (Flecknell, 2002).
Un aspect particulièrement probant de la réussite en matière de prise de conscience de la douleur et de sa prise en charge chez les animaux de laboratoire a été l’apparition de comités d’éthique locaux ; ils sont chargés de surveiller et de juger du respect de l’intégrité des animaux de laboratoire lors de leur utilisation (Autissier, 2008). Ces postes sentinelles sont rapidement devenus obligatoires et ils se portent garants que l’utilisation des animaux est justifiée et que toutes les mesures sont bien prises afin d’appliquer la règle des « 3 R ».
La professionnalisation et la réglementation des procédures visant à la prévention de toute souffrance inutile passent ainsi par la qualification et les compétences de l’expérimentateur, l’engagement de sa responsabilité, la justification du processus de recherche et le recours à des comités d’éthiques pour en évaluer les protocoles et garantir la légitimité de la démarche entreprise (Autissier, 2008).
La démarche suivie pour les animaux de laboratoire mérite d’être considérée pour améliorer la situation des animaux d’élevage. Même si les solutions pratiques doivent être envisagées au cas par cas et en adéquation avec les conditions propres à chaque filière de production, il n’est pas irréaliste de penser qu’une approche plus globale des questions posées permettrait de proposer des solutions génériques visant à éviter ou limiter la douleur chez les animaux de ferme.
On peut même anticiper que ces solutions pourraient être bénéfiques à la qualité de la production ainsi qu’aux conditions de travail des personnels impliqués. A titre d’exemple d’une démarche plus globale visant à limiter la douleur chez les animaux d’élevage, citons le dispositif réglementaire de l’office vétérinaire fédéral suisse sur la protection des animaux.
Un texte intitulé « Exigences légales en matière d’intervention sur des animaux vivants » (2005) sert de cadre pour éviter autant que faire se peut les interventions douloureuses et lorsqu’elles sont inévitables, d’avoir recours à une substance anesthésique*. Afin de faciliter l’usage des antalgiques ou des anesthésiques par les éleveurs procédant eux-mêmes aux interventions, l’accès à ces médicaments a été encadré.
Parallèlement, la formation des éleveurs à leur usage raisonné a été mise en place. Dans le même esprit, les conditions d’élevage et des mesures de gestion appropriées pourraient permettre d’éviter certaines interventions douloureuses ou de les remplacer par des méthodes moins génératrices de douleurs. Il est cependant périlleux de préjuger des pratiques qui amélioreraient les conditions de vie des animaux sans faire appel aux données scientifiques.
Nous envisagerons dans ce chapitre de présenter à titre d’exemples certaines mesures qui semblent possibles compte tenu des travaux scientifiques existants, et de les classer dans un ordre basé sur une règle des « 3 S » en analogie aux « 3 R » :
les solutions visant à supprimer certaines pratiques d’élevage à l’origine de douleur, les solutions visant à substituer ces pratiques lorsqu’elles sont améliorables mais indispensables et les solutions visant à soulager la douleur lorsque celle-ci n’est pas évitable (Mellor et al., 2008). Une traduction possible des « 3S » est : Suppress, Substitute and Soothe.