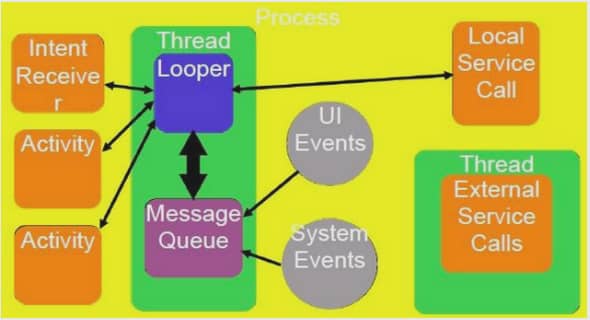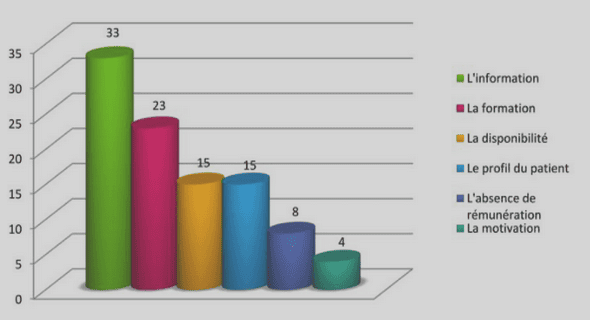Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
La lutte contre le changement climatique
L’atténuation
Pour faire face aux bouleversements engendrés par le changement climatique, les premières mesures concernant le climat sont prises lors du Sommet de la Terre en 1992 à travers un accord multilatéral global : la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUC). Les différents pays du monde sont définis désormais comme des parties prenantes du problème climatique et doivent notamment se répartir l’effort de réduction des émissions anthropiques de GES. La réduction des émissions des GES, appelée « atténuation », et « l’adaptation au changement climatique » sont désignées comme les principales stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique et réduire le risque climatique (Simonet, 2011 ; Aykut et Dahan, 2014). L’atténuation doit s’attaquer directement à la source du phénomène : elle est la principale solution envisagée dans le but de stabiliser les concentrations de GES dans l’atmosphère à un niveau qui limiterait toute perturbation anthropique excessive du système climatique. La stratégie d’atténuation s’articule autour de deux piliers : d’une part, limiter les émissions de GES afin de maintenir la hausse de la température moyenne terrestre au-dessous de 1,5°C supplémentaires d’ici à 2100 ; d’autre part protéger et améliorer les puits de GES, comme les forêts et les sols. Le premier volet est formalisé en 1997 dans le Protocole de Kyoto, en vigueur depuis 2005, qui met en place un système de quotas d’émissions de GES et un « marché carbone » dans le cadre duquel il devient possible d’échanger des permis d’émission de GES. Le deuxième volet fait l’objet de projets dédiés, à partir de 2008, avec la mise en place du programme de « réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation forestière » (REDD, puis REDD+) par l’ONU (Boulier et Simon, 2010 ; Tsayem Demaze, 2010). Ces deux mesures phares ont fait l’objet de nombreuses critiques, notamment liées à l’expansion du capitalisme à travers la financiarisation de la nature (Keucheyan, 2014). En effet, elles mobilisent toutes deux des mécanismes de marché, évidents dans le cadre du « marché carbone » instauré par le Protocole de Kyoto. Dans le cadre de la REDD, certaines ONG ont dénoncé l’inefficacité d’un programme fondé sur un système de marché qui implique des risques d’appropriation du système par les élites locales et peut même avoir des effets néfastes sur les populations locales (risque d’expulsion des forêts, tensions liées aux entrées d’argent dans des communautés où elles ont peu cours) (Desvallées, 2014).
L’adaptation
Après une première génération de politiques climatiques donnant la priorité à l’atténuation, depuis la fin des années 2000, la notion d’adaptation au changement climatique occupe désormais le devant de la scène. L’émergence de ce thème correspond l’implication des pays en développement, qui remettent en cause le cadrage en termes d’atténuation alors qu’ils subissent les premiers les dommages dus à l’industrialisation des pays développés (Simonet, 2016) : en 2008, les pays fortement industrialisés des Nords comptent 18,8% de la population mondiale mais sont à l’origine de 72.7% des émissions mondiales de CO2 depuis 1850 (Malm, 2017). Lors de la Conférence de Bali en 2007, les pays en développement parviennent donc à imposer les stratégies d’adaptation comme un deuxième objectif de la CCNUC, aussi crucial que celui de l’atténuation. Pour certains, c’est aussi l’échec des stratégies d’atténuation, et notamment du Protocole de Kyoto, qui explique l’importance qu’a pris le concept d’adaptation (Euzen et al., 2017). Ainsi, en 2009, la COP de Copenhague reconnait l’écart grandissant entre le diagnostic scientifique du GIEC qui se fait de plus en plus alarmant et l’insuffisance des efforts de réduction des émissions de GES (Aykut, 2020) : malgré la multiplication de politiques visant à limiter les GES, ceux-ci ont continué à augmenter entre 2000 et 2010 et sont aujourd’hui plus élevées que jamais (GIEC, 2014).
Définition
L’adaptation au changement climatique apparait pour la première fois dans le titre du deuxième rapport du GIEC, en 1995. Elle est ensuite définie dans le rapport du GIEC de 2007 comme l’ensemble des « initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus ». L’adaptation est alors considérée comme une « réponse palliative », éludant toute possibilité de transformation (Simonet, 2015). Puis, dans le cinquième rapport du GIEC, paru en 2014, l’adaptation au changement climatique, à laquelle sont consacrés quatre chapitres, devient prépondérante. Elle est décrite comme une « démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences, de manière à en atténuer les effets préjudiciables et à en exploiter les effets bénéfiques ». Si l’atténuation est une stratégie négociée à l’échelle globale, l’adaptation est au contraire « spécifique en fonction du lieu et du contexte » (GIEC, 2014) et doit tenir compte des spécificités géographiques, climatiques, socio-économiques du territoire considéré et regroupe donc un répertoire d’actions large et encore peu défini (Van Gameren et al. 2014).
L’adaptation : entre flou et souplesse
En pratique, si l’adaptation relève aussi des modifications spontanées des comportements individuels ou des groupes sociaux (Van Gameren et al., 2014 ; Taylor, 2015), par exemple des agriculteurs qui changeraient de types de cultures, des familles qui partiraient d’une région particulièrement exposée aux risques, ces pratiques spontanées sont vues comme insuffisantes et la nécessité de planifier est fortement mise en avant : l’adaptation doit être un processus de transition organisé et coordonné de l’échelle globale à l’échelle locale. Pourtant, la majorité de la littérature s’intéressant à l’adaptation au changement climatique reconnait qu’il s’agit d’une notion « floue » (Simonet, 2009 ; François et al., 2016 ; Dhénain et Barreteau, 2018), « vague » (Simonet, 2011), « mal définie » (Bertrand et Richard, 2015) ou encore « incertaine » et « ambiguë » (Rocle, 2015). Ce « flou », qui dans un vocabulaire à connotation plus positive renvoie aux adjectifs multidimensionnel » (Simonet, 2009), « souple » et « polymorphe » (Sinou, 2018), est caractéristique du tournant vers la soft law qu’a pris la gouvernance climatique depuis les Accords de Paris en 2015 qui ont acté la fin de l’approche contraignante et répressive, notamment sur la question des émissions de GES des grands pays pollueurs (États-Unis qui se sont de toute façon retirés des accords en 2017, Chine, Inde, Brésil, Canada et Russie) (Aykut, 2020). En termes de droit de l’environnement, la soft law s’oppose à la hard law, elle propose « une logique anticipatrice et préventive », « une alternative diplomatique » sans sanction qui s’oppose aux techniques « ‘répressives’, basées sur une logique thérapeutique, réparatrice des dommages causés à l’environnement, ou plus strictement coercitive, et servie par tout un arsenal juridique d’actes de droit positif » (Sinou, 2018). Programmes d’action, lignes directrices et stratégies – autant de termes qui correspondent bien à ce que nous avons pu lire dans les recommandations du GIEC au sujet de l’adaptation au changement climatique – sont les instruments privilégiés de la soft law : ils proposent un « canevas juridique à finalité programmatoire auquel les États et les institutions peuvent facilement adhérer » (Sinou, 2018).
Au sein même des stratégies d’adaptation, certains auteurs distinguent deux types de leviers d’action (Sovacool, 2001) : la hard adaptation ou « adaptation structurelle » en français qui correspond aux mesures concernant les infrastructures lourdes, en dur, à forte intensité de capital (digues, barrages, projets d’irrigation, routes) ; et la soft adaptation que R. Weikmans (2013) traduit par « adaptation comportementale » ou « adaptation régulatrice ». Ce type d’adaptation trouve une place centrale dans le rapport du GIEC de 2014 qui considère l’adaptation comme un processus dynamique qu’il associe au vocabulaire du « changement » et de la « transformation ». Il insiste notamment sur la nécessité de planifier l’adaptation dans « trois sphères de changement » qu’il identifie comme :
la sphère fonctionnelle, dans laquelle il faudrait procéder à des innovations techniques et sociales, faire évoluer les pratiques managériales et institutionnelles ;
la sphère politique, dans laquelle les « prises de décisions et les actions politiques, sociales, culturelles et écologiques doivent se rendre compatibles avec la réduction de la vulnérabilité et des risques et soutenir les stratégies d’adaptation, d’atténuation et de développement durable » ;
la sphère personnelle, qui concerne les « présupposés, croyances, valeurs et visions du monde qui influencent les réponses au changement climatique ».
Ainsi, l’adaptation se trouve finalement au croisement du droit et de la politique. Parmi les mesures d’adaptation douce, on trouve par exemple la modification de la tarification de l’eau et des énergies ou la mise en œuvre des « Solutions Fondées sur la Nature » visant à reproduire ou à restaurer des processus naturels pour servir d’un même coup les stratégies d’atténuation et d’adaptation (les zones humides, par exemple, fonctionnent à la fois comme des puits de carbone et comme des éponges qui peuvent absorber les eaux de crue, atténuant ainsi les effets des inondations) (Rey et al., 2018).
Les stratégies d’adaptation telles qu’envisagées par le GIEC proposent donc d’« intégrer les défis posés par les effets du changement climatique dans la transformation des sociétés, en prônant des activités et des régulations différentes de celles qui ont prévalu jusqu’ici » (Van Gameren et al., 2014) dans le but de se préparer à vivre dans un monde à + 1,5°C.
Les villes, laboratoires de l’adaptation au changement climatique
Dans le contexte d’une urbanisation qui va croissante à l’échelle de la planète – selon l’Organisation des Nations Unies, en 2050, 70% de la population planétaire vivra en ville – c’est dans les villes que les conséquences du changement climatique devraient se faire sentir pour le plus grand nombre. Les villes se trouvent donc au cœur d’une contradiction : elles ont à la fois un poids considérable dans les émissions de GES et sont une force motrice du changement climatique, mais elles sont aussi les lieux les plus exposés aux problèmes environnementaux. Les villes sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique : la forte concentration de population, la densité importante d’infrastructures et de biens matériels ainsi que la complexité d’organisation du système urbain multiplient les enjeux face aux aléas climatiques, qu’ils correspondent à des vagues de chaleur, des sécheresses qui posent des problèmes d’approvisionnement en eau, des inondations ou des cyclones (Boyer, 2020a).
Dans le cadre des politiques d’atténuation des émissions de GES, certaines villes ont pu agir sur la forme urbaine (maîtriser l’étalement urbain par exemple), les mobilités (privilégier les modes piéton ou cycliste) et les bâtiments (réviser le code de la construction et de l’habitation pour améliorer l’efficacité énergétique) ( Bulkeley et Betsill, 2003 ; Otto-Zimmermann, 2011 ; Bulkeley, 2013). Le GIEC mais aussi l’ONU considèrent les villes comme des laboratoires de l’adaptation au changement climatique (UN-Habitat, 2011). L’échelle des villes leur semble particulièrement pertinente pour mettre en place des stratégies d’adaptation. En effet, elles fonctionnent comme des systèmes intégrés dans lesquels les différents réseaux (d’eau, d’électricité, de transport, etc) ainsi que le tissu économique et social sont imbriqués et fonctionnent ensemble (Pelling, 2010 ; Tommasi et Boyer, 2018). Les maires des grandes villes du monde se sont d’ailleurs réunis dans des réseaux de coopération transnationale dans le but de lutter contre les émissions de GES et de promouvoir l’adaptation au changement climatique. Dès 1993, est créé le réseau International Council for Local Environmental Initiatives qui vise à mettre en œuvre des stratégies d’atténuation à travers le programme Climate Protection. Puis en 2005, le maire de Londres est à l’initiative de la création du Cities Climate Leadership Group (C40) qui regroupe aujourd’hui une centaine de grandes métropoles (parmi lesquelles New-York, Los Angeles, Mexico, Paris, Milan, etc) (Zeppel, 2013) et représente 600 millions d’habitants, 25% du PIB mondial et 70% des émissions de GES selon le site Web du réseau 12, rejoint par Phoenix en janvier 2020.
La mise en œuvre de l’adaptation est caractéristique du processus de « climatisation du monde » remarqué par S. Aykut (2020) : la question climatique se diffuse dans des domaines de plus en plus nombreux de nos sociétés (débats politiques, luttes sociales ou activité des entreprises privées). En effet, elle ne tient pas qu’au seul pouvoir municipal mais implique d’autres catégories d’acteurs, des acteurs privés et notamment une mobilisation forte de la société civile (pressions des ONG militantes environnementalistes, émergence de figures de proue comme Greta Thunberg en 2018) qui porte les réflexions sur les changements sociaux, politiques et culturels. A l’échelle de la ville, les associations écologistes locales peuvent jouer un rôle clé pour inciter une municipalité à mettre en œuvre une action de lutte contre le changement climatique (Bulkeley et al., 2015). Elles promeuvent bien souvent des mesures simples à mettre en œuvre, inspirées des savoirs vernaculaires et mobilisant des technologies à faible intensité énergétique et matérielle appelées low-tech (Bihouix, 2014) dans le but de façonner une ville plus sobre qui puisse consommer moins de ressources et produire moins de déchets dans ses activités et dans la production de l’espace urbain même (Florentin et Ruggeri, 2019). L’adaptation est donc une forme d’« expérimentation » : elle correspond un ensemble de tentatives pour « démontrer, expérimenter, apprendre et questionner les possibilités de réponses au changement climatique à travers une multitude d’interventions, de projets et de dispositifs différents13 » (Bulkeley et al., 2015).
En effet, contrairement à ce que l’omniprésence de l’expression « adaptation au changement climatique » laisse croire, dans la plupart des villes, les politiques d’adaptation au changement climatique n’en sont qu’à un stade exploratoire. En effet, leurs mises en place se heurtent à plusieurs difficultés (Moser et Ekstrom, 2010). Tout d’abord, le terme d’adaptation reste globalement assez imprécis et donne lieu à diverses interprétations, ce qui freine sa traduction en stratégies opérationnelles (Simonet, 2015). Ensuite, si la mise en œuvre des politiques d’atténuation s’appuyait sur des cadres préexistants (plans d’urbanisme, de politiques de transport ou encore de lutte contre la pollution de l’air), ce n’est pas le cas des politiques d’adaptation qui ne disposent pas de bases préfabriquées (Bulkeley et Betsill 2003; Bertrand et Richard, 2014) et sont donc à construire de toutes pièces. La ville considérée comme un système intégré permet la mise en œuvre d’actions cohérentes à l’échelle urbaine mais peut aussi être à l’origine d’inerties dans les réponses à apporter aux effets du changement climatique en lien avec la lourdeur de la bureaucratie municipale et la définition des priorités politiques locales (Bulkeley, 2010). Enfin, cette vision de la ville reste toute théorique dans la mesure où, notamment dans les pays en développement, une partie de la croissance urbaine se fait de façon informelle et donc peu maîtrisée. Ce sont ainsi surtout les villes riches qui peuvent aujourd’hui mettre en œuvre des politiques ambitieuses d’adaptation au changement climatique (Davis, 2002). Elles sont des acteurs puissants qui disposent de moyens d’action importants.
“municipalities, private and civil society actors seek to demonstrate, experience, learn and challenge what it might mean to respond to climate change through a multiplicity of interventions, projects and schemes”.
Aux racines de l’adaptation
Avant de rejoindre le vocabulaire de la gouvernance climatique mondiale, la notion d’adaptation a circulé à travers diverses disciplines ce qui explique qu’elle soit chargée de plusieurs sens ou de connotations particulières (Simonet, 2011 ; Van Gameren et al., 2014). La discipline d’origine du concept d’adaptation est la biologie, notamment à travers la théorie de l’évolution développée au cours du XIXe siècle, d’abord par Lamarck qui analyse l’adaptation comme « un effort continu du vivant pour tirer profit du milieu dans lequel il évolue » où les idées de résistance et de survie sont centrales (Simonet, 2011) ; puis, dans la deuxième moitié siècle, à travers la théorie de Darwin qui fait de la sélection naturelle le moteur principal de l’adaptation et de l’évolution, processus qui se réalisent graduellement et lentement. Au début du XXe siècle, dans le contexte des fortes transformations socio-culturelles induites par l’industrialisation, la théorie évolutionniste trouve un écho chez les penseurs sociaux qui posent la question de l’adaptation des individus à leur nouvel environnement, plus ouvrier, plus urbain et plus pollué. C’est le cas notamment de W. Lippmann, un éditorialiste étatsunien à l’origine du colloque Lippmann en 1938, souvent considéré comme un événement fondateur du néolibéralisme ». Le but de ce colloque est de proposer un libéralisme renouvelé aux lendemains de la crise économique de 1929 (Audier, 2019 ; Stiegler, 2019). Ainsi, l’« Agenda du libéralisme », proposé à l’issue du colloque rend possible l’intervention de l’État (en matière de protection sociale, de recherche, d’enseignement, de défense) et préconise l’avènement d’un gouvernement d’experts (les plus aptes) pour transformer et adapter « par le haut » la société, jugée immobile et rétive à l’industrie moderne et au libre marché. Ainsi, « l’injonction à s’adapter » (Stiegler, 2019), omniprésente aujourd’hui, plongent ces racines dans les théories darwiniennes, récupérées par les premiers néolibéraux pour justifier l’intérêt de la compétition dans la route vers le progrès.
Ce terme reste discuté, souvent peu défini, il est fréquemment utilisé pour dénoncer le camp opposé dans un contexte de lutte politique et idéologique. Cette partie retrace de manière synthétique les raisons pour lesquelles certains auteurs (engagés) interprètent l’adaptation comme une stratégie « néo-libérale ».
La psychologie s’est aussi inspirée de la biologie et mobilise le concept d’adaptation pour étudier les interactions entre l’individu et le monde dans lequel il évolue. Ensuite, l’anthropologie a utilisé ce concept pour analyser les ajustements biologiques et culturels des individus et groupes à leur environnement, notamment pour leur survie (Harrison, 1993 ; Taylor, 2015). Aux côtés des notions d’assimilation, d’insertion et d’intégration, la sociologie, notamment l’École de Chicago, s’est quant à elle intéressée à l’adaptation sociale, c’est-à-dire aux changements d’un individu pour s’intégrer ou se sentir appartenir à un groupe (Reghezza, 2007).
En géographie, l’idée d’adaptation n’est pas nouvelle non plus et s’est développée en lien avec la notion de « milieu », défini comme le résultat des interactions entre des composantes naturelles et les actions des sociétés. Au XIXe siècle se développent d’une part l’idée que l’humanité est bien en train de modifier son milieu, et d’autre part l’idée que le milieu physique exerce une influence sur les humains, leur culture, leurs traits de caractère et détermine un genre de vie. Ces deux pistes de réflexions sont ensuite amendées par Vidal de La Blache qui prend en considération la capacité à agir des sociétés et définit l’adaptation comme un choix délibéré des sociétés qui cherchent à s’émanciper des contraintes du milieu dont les pratiques donnent lieu à des « genres de vie » différents (Reghezza, 2007 ; Simonet, 2011). Ainsi, l’adaptation renvoie au fait que les sociétés humaines ont toujours été confrontées au problème des contraintes naturelles et des variabilités climatiques qu’elles sont parvenues à maitriser pour s’installer dans pratiquement toutes les zones climatiques de la planète.
Cependant, le changement climatique se caractérise aujourd’hui par des modifications environnementales importantes dont le rythme est de plus en plus soutenu, ce qui accroit fortement la vulnérabilité des sociétés et vient mettre au défi le long héritage de la capacité des sociétés à s’adapter.
L’adaptation au changement climatique : une politique d’ajustement
Le concept d’adaptation se trouve pris aujourd’hui au cœur des enjeux du changement climatique. Cependant, l’adaptation au changement climatique fait l’objet de critiques (Zaccaï, 2019), notamment chez les auteurs qui étudient les liens entre crise climatique et capitalisme (Keucheyan, 2014 ; Bonneuil et Fressoz 2013 ; J-B. Comby, 2015 ; Taylor, 2015 ; Felli, 2016). Selon ces auteurs, l’idée d’adaptation au changement climatique a été mise en œuvre depuis les années 1970 pour permettre une extension du marché capitaliste dans tous les domaines. En effet, c’est dans les années 1970-1980 aux États-Unis, dans un contexte politique néolibéral, qu’est mobilisée pour la première fois la notion économique de flexibilité dans la question climatique. Alors que la prise de conscience des limites de la planète s’accentue, il s’agit de participer à la justification d’une flexibilisation générale de la société qui doit se rendre plus adaptable dans un monde contemporain de plus en plus perçu comme incertain (Felli, 2016). Dans la logique du
free market environmentalism » qui met l’accent sur les marchés comme solution aux problèmes environnementaux (Anderson et Leal, 1998) et de la « croissance verte » qui voit les investissements dans des secteurs innovants dits « verts » (énergies renouvelables, efficacité énergétique) se multiplier, le problème climatique est ainsi rendu comparable aux problèmes économiques (Combes, 2010 ; Bonneuil et Fressoz, 2013). Il doit dès lors faire l’objet de politiques climatiques qui s’efforcent d’être les plus conformes au marché et mobiliser les instruments de ce dernier, comme on l’a vu déjà dans la mise en œuvre des stratégies d’atténuation. Le terme « d’ajustement », employé par le GIEC dans sa définition de l’adaptation au changement climatique, n’est d’ailleurs pas sans rappeler les politiques d’inspiration libérale et l’injonction à la bonne gouvernance promue par l’économie du développement dans les années 1980-1990. De même, la balance à équilibrer entre « effets préjudiciables » et « effets bénéfiques », décrite comme l’un des objectifs de l’adaptation, renvoie aux enjeux de stabilisation au cœur de ces politiques qui visaient l’amélioration des structures économiques des pays en voie de développement et dont les conséquences ont été bien souvent pointées du doigt : l’accroissement des inégalités économiques et sociales et l’aggravation de la vulnérabilité de certaines parties de la population (Felli, 2016). Dans cette perspective, les stratégies d’adaptation ne seraient envisagées que dans la mesure où elles permettent d’assurer la survie et la reproduction de l’économie capitaliste, productiviste et consumériste. Pourtant, la question se pose de savoir si ce modèle est en mesure de résoudre les problèmes posés par le changement climatique alors qu’il en est en grande partie responsable (Tanuro, 2015). Le discours de l’adaptation au changement climatique est donc fortement ancré dans des questions de relations de pouvoirs et de modes de production (Taylor, 2015).
La sur-responsabilisation des individus dans la crise climatique
Au cœur des logiques néolibérales se trouve la priorité donnée à l’action libre des individus qui se traduit dans la prise en charge de la question climatique – problème collectif s’il en est un – par des politiques publiques qui visent avant tout le changement des comportements individuels, à travers la promotion « des petits gestes du quotidien » pour protéger la planète (par exemple, installer des ampoules basse consommation, éteindre la lumière en quittant une pièce ou encore limiter sa production de déchets ménagers) (J-B. Comby, 2009). Cependant, les effets probables des efforts de changement de comportements individuels sont moindres (Zaccaï, 2019) : ils pourraient ne constituer que 5 à 10% de l’empreinte carbone totale des activités humaines (Dugast et Soyeux, 2019). Ainsi, selon J-B. Comby (2019), « si ces leviers d’action continuent d’être activés, c’est donc moins pour leur efficacité que pour créer les conditions légitimant la responsabilité du plus grand nombre ». Pour lui, ils constituent l’un des facteurs principaux du processus de dépolitisation des enjeux écologiques aujourd’hui (J-B. Comby, 2015 ; 2017). Ces politiques publiques environnementales mobilisent les instruments de la soft law et de la soft adaptation, présentés comme neutres : la communication, puisqu’il s’agit d’« irriguer la société de mots d’ordre », et la fiscalité comportementale pour orienter les choix des consommateurs ainsi que l’innovation technologique dans le but de « ne pas entamer nos besoins tout en réduisant l’empreinte environnementale liée à leur satisfaction » (J-B. Comby, 2019). Elles visent à façonner un éco-citoyen modèle, au sens de bon élève mais aussi au sens d’individu -type. En effet, selon J-B. Comby (2019), l’éco-citoyen correspond à « une figure consensuelle » qui présuppose un individu sans contraintes, imperméable aux normes sociales et aux goûts de ses proches. Tous les individus seraient ainsi génériques et interchangeables, (…) en apesanteur des réalités collectives, comme isolés. Aussi, en situation d’information pure et parfaite grâce aux campagnes de communication, ils calculeraient et agiraient rationnellement, pour eux, pour les autres, pour la planète, pour leur prochain. (…) Dès lors, les idées, les mots, l’éducation, la sensibilisation, la communication, les médias ou la culture auraient des effets importants sur ce que les individus pensent et font. Il faudrait ainsi mobiliser le plus grand nombre (…) en changeant les mentalités pour que chacun prenne conscience des enjeux et agisse en conséquence. (…) [L’individualisation des responsabilités de la crise écologique] est protéiforme et s’appuie sur des visions ‘comportementalistes’ et psychologisante de l’individu. Elle n’encourage pas à interroger les structures sociales qui pèsent sur nos comportements (…). Autrement dit, la dilution des problèmes environnementaux dans un tourbillon de mots, d’idées, d’images, de slogans ou de mot d’ordre célébrant le respect de l’environnement, tout en ne contestant que rarement, ou alors du bout des lèvres, l’organisation sociale qui le détruit, constitue un aspect majeur de la dépolitisation des enjeux.
Table des matières
Introduction
Partie I – Outils conceptuels pour penser l’adaptation à la rareté de l’eau
Chapitre 1 – Le changement climatique : enjeux et limites de l’injonction à s’adapter
Chapitre 2 – Changements environnementaux et rapports de pouvoirs : une approche de political ecology
Chapitre 3 – Définir la rareté de l’eau dans le Sud-Ouest étatsunien
Chapitre 4 – S’adapter à la rareté de l’eau
Conclusion de la première partie
Partie II – Confronter discours et pratiques de l’adaptation à la rareté de l’eau : matériaux et méthodes
Chapitre 5 – Phoenix et Tucson, villes-oasis du désert de Sonora
Chapitre 6 – Questionner les discours et les pratiques de l’adaptation à la rareté de l’eau : un pluralisme méthodologique
Conclusion de la deuxième partie
Partie III – Déconstruire les discours dominants sur la rareté de l’eau
Chapitre 7 – Faire face à la rareté de l’eau : un état des lieux au prisme de la presse quotidienne locale (1999 – 2018)
Chapitre 8 – Faire consensus ? La fabrique du discours de gestion de la demande sur Twitter : la campagne Water Use It Wisely
Conclusion de la troisième partie
Partie IV – Documenter les pratiques émergentes d’adaptation à la rareté de l’eau : entre alternatives et compromis
Chapitre 9 – “Think of your house as a watershed!” La récupération des eaux de pluie à Tucson, en Arizona : vers la diversification de l’approvisionnement en eau dans le Sud-Ouest étatsunien ?
Chapitre 10 – Le retour de l’eau dans la rivière Santa Cruz : Tucson Water ou l’art du fix socio écologique
Chapitre 11 – De la luzerne aux masterplanned communities : obstacles et limites à la gestion de la demande sur un front d’urbanisation, le cas de Buckeye
Conclusion de la quatrième partie
Conclusion générale
Annexes
Références bibliographiques
Table des Figures
Table des Tableaux
Table des Encadrés
Table des matières