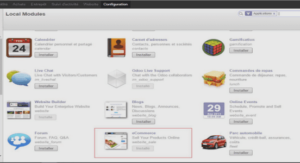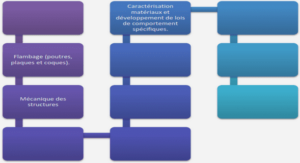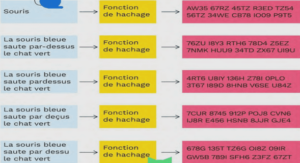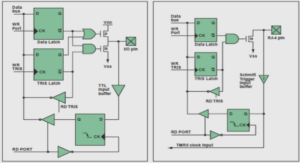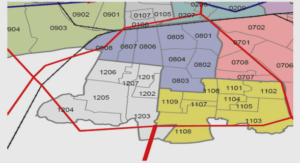Aspects législatifs et réglementaires
Dans le souci de protéger l’environnement et la santé des populations, la législation sénégalaise a élaboré un cadre juridique qui réglemente entre autres, l’usage des ressources en eaux du Sénégal ainsi que de leur protection. Le secteur de l’assainissement est régi par différents textes de lois répartis dans trois codes : le code de l’eau, le code l’hygiène et le code de l’environnement. La gestion des eaux usées domestiques occupe une place importante dans ces codes (Mbéguéré, 2002).
Il ressort de l’étude de ces différents textes de lois que les institutions et les réglementations sont plutôt orientées vers la gestion des eaux usées et de la qualité de l’environnement en général mais ne sont pas spécifiquement tournés à la gestion des boues de vidange.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Boues de vidange
Définition des boues de vidange
Les boues fécales sont définies comme des boues de consistance variable qui s’accumulent dans les fosses septiques, dans les latrines à fosse ou latrines traditionnelles et dans les toilettes publiques. Elles sont composées essentiellement de différentes matières fécales solides flottantes ou sédimentées ainsi que d’autres matières non fécales (Strauss et al, 1998).
Production de boues fécales
D’après des investigations menées au Ghana, la production journalière des boues de vidange s’élève à environ 0,20 litre/habitant pour les latrines à fosse, à 1 litre/habitant pour les fosses septiques et à 2 litres/habitant pour les toilettes publiques non raccordées au réseau d’égout (Koné, 2003).
La production journalière de boues de vidange à Dakar s’élèverait à 0,75 litre/jour. Ainsi, la production annuelle à été évaluée, en 2005, à 1350 m3/jour produits par 75% d’une population estimée à près de 2,4 millions de personnes (Tounkara, 2007).
Qualité des boues fécales
Contrairement aux boues de station d’épuration d’eaux usées municipales, les caractéristiques des boues fécales sont très variables selon les localités. Elles diffèrent de ménage à ménage; des quartiers périphériques à ceux du centre-ville, et de ville en ville (Strauss et al, 2003). Plusieurs facteurs sont à l’origine de la variation de la qualité des boues fécales dont les plus importants sont:
– la durée de stockage,
– le mélange à de la graisse ou à des déchets organiques de cuisine,
– l’ajout d’eau pour vider les latrines à fosse (ou le plus souvent l’eau grise),
– la température pendant le stockage,
– la performance des fosses septiques,
– la technologie de vidange des fosses (Strauss et al, 1998).
Les concentrations en DBO, en DCO et en azote total dans les eaux usées domestiques varient respectivement de 110 à 350 mg/litre, 250 à 800 mg/litre et 20 à70 mg/litre (Metcalf & Eddy, 2003). L’ammonium et les polluants organiques ont des concentrations qui sont 10 à 100 fois plus élevées dans les boues fécales que dans les eaux usées municipales. Par conséquent, les boues de vidange sont très différentes des eaux usées urbaines, comme le prouvent aussi les paramètres suivants :
– le rapport de la DCO des boues fécales et celle des eaux usées urbaines se situe entre 20 et 150,
– les boues fécales sont moins biodégradables que les eaux usées municipales: le rapport DCO/DBO varie de 5 à 10,
– seul 5 à20% de la DBO est conservés dans les solides en suspension (Strauss et al.1999).
Dans de nombreuses régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, les helminthiases, notamment les infections de nématodes (Ascaris, Trichuris, Ankylostoma, Strongyloides, etc.) sont très répandues. Les œufs d’Ascaris sont particulièrement persistants dans l’environnement. L’essentiel des œufs d’helminthes contenus dans les matières fécales ou dans les eaux usées finit dans les boues générées au cours du traitement. Par conséquent, dans de nombreux endroits, les œufs de nématodes sont les indicateurs de choix pour déterminer la qualité hygiénique que les boues doivent avoir pour être utilisées comme amendement de sol et d’engrais. La concentration des œufs d’helminthes dans les boues est largement tributaire de la prévalence et de l’intensité de l’infection dans la population auprès de laquelle les boues ou les eaux usées sont collectées. Lorsque l’utilisation de boues en agriculture est une pratique courante, le traitement doit viser à réduire les œufs d’helminthes et leur viabilité ; aussi, le temps de stockage des boues doit être suffisamment long pour atteindre la réduction souhaitée (Martinet al).
Typologie des boues fécales
Les boues fécales sont classées en deux types :
Type A: cette boue est dite de haute consistance ; ce sont les boues des toilettes publiques ou des seaux d’aisance. Elles sont fraîches et ne sont habituellement stockées que de quelques jours à plusieurs semaines. Les concentrations sont très élevées et vont respectivement de 20000-50000 mg/L et de 2000-5000 mg/L respectivement pour la DCO et l’azote ammoniacal.
Type B: cette boue est de faible consistance et elle est généralement stockée plusieurs années dans des fosses septiques. Elle est beaucoup moins chargée que le type A ; la DCO et l’azote ammoniacal dépassent rarement 10000 mg/L et 1000 mg/L, respectivement (Strauss et al, 1997). Les boues fécales du Sénégal peuvent être généralement classées dans la catégorie des boues de faible consistance. (Tounkara, 2007) En effet :
les fosses septiques sont largement utilisés bien que ne répondant pas souvent aux exigences techniques,
les toilettes publiques ne sont pas fréquentes,
les boues issues des latrines sont minéralisées et solidifiées après deux années d’isolement.
Options de traitement
Différentes technologies sont utilisées pour le traitement des boues de vidange de systèmes d’assainissement individuel. Elles tournent autour de la sédimentation/épaississement, de la digestion anaérobie et de la déshydratation par lits de séchage la sédimentation/épaississement : les boues brutes sont prétraitées dans un réservoir de sédimentation qui sépare les particules solides de la phase liquide. Les particules sédimentent et constituent la boue épaissie. Cette dernière est envoyée aux lits de séchage. Les solides sédimentés représentent 15 à 20 % du volume de boues brutes soit un rapport de 0,15 à 0,20 m3/m3 de boues fécales envoyées dans des bassins de sédimentation/ épaississement exploités à des cycles de plusieurs semaines (Strauss et al, 1998) ;
la digestion anaérobie est principalement utilisée pour les boues non stabilisées qui sont difficiles à sédimenter (par exemple boues fraîches provenant des toilettes publiques en général);
la déshydratation se fait sur des lits de séchage nus ou plantés. Les lits de séchage des boues, non plantés, visent à séparer et à réduire la charge polluante dans la percolation ; les solides sont séchés et peuvent également être compostés ou éliminés (Cofie et al, 2006). Les lits plantés sont généralement utilisés pour séparer les solides et les liquides et pour réduire la concentration des éléments nutritifs dans le percolât avec l’avantage d’accepter de hautes charges de matières solides en suspension.
Ces options de traitement produisent toutes des surnageants concentrés qui ont besoin d’être traités par d’autres systèmes qui sont :
– le bassin de stabilisation : cas de l’Argentine,
– le co-traitement avec les eaux usées domestiques : exemple de la déposante de Cambérène au Sénégal,
– le traitement sur culture fixée : système de biofilms; filtre intermittent de sable, lits bactériens etc. (Tounkara, 2007).
Ces options de traitement de boues de vidange ont été expérimentées dans quelques endroits à travers le monde.
Quelques expériences menées
* Bangkok: Zones humides et étangs de stabilisation des boues de vidange
Des lits plantés de roseaux ont été étudiés à l’Institut Asiatique de Technologie (AIT) comme options pour le traitement des boues de vidange. La stabilisation et la déshydratation des boues sont combinées en un seul processus de traitement. Le procédé est basé sur les zones humides et nécessite une gestion soigneuse du niveau d’eau par un pounding. Le percolât résultant d’une charge de matières solides de 250 kg/m2/an doit faire l’objet d’un traitement ultérieur. (Strauss et al.1998).
Techniques de séparation solide-liquide
Il existe différentes techniques de séparation solide/liquide dont des techniques thermiques et mécaniques. Ces dernières peuvent être divisées en trois grandes familles :
• La décantation
C’est un procédé permettant de séparer :
– soit une phase de matières en suspension dans un liquide de masse volumique moindre,
– soit deux phases liquides non miscibles de densités différentes.
Dans les deux cas l’action consiste à laisser reposer les phases en contact et à attendre un temps suffisant pour qu’elles se séparent sous l’action de la pesanteur. C’est une action simple mais longue ne nécessitant que peu de matériel, donc peu coûteuse, mais peu sélective. Elle ne met en jeu qu’une force extérieure constante, la pesanteur, et ne nécessite que d’éviter toute agitation ou toute action de mélange une fois que la séparation est faite. (Blazy, 2007).
• La centrifugation
Dans cette technique également appelée décantation (ou sédimentation) centrifuge, la séparation des phases est due à la différence de densité des constituants soumis au champ centrifuge. La décantation centrifuge obéit à des lois analogues à celles de la décantation statique, appelée aussi décantation gravitaire. Cependant, le champ de la pesanteur est remplacé par un champ de forces beaucoup plus intenses, ce qui permet de réduire la durée de la séparation, le volume des appareils, et d’augmenter le rendement de l’opération. . (Techniques de l’ingénieur, 2007)
• La filtration
La filtration est un procédé permettant de séparer une phase continue (liquide ou gazeuse) et une phase dispersée (solide ou liquide) initialement mélangées. La séparation se fait en faisant passer le mélange au travers d’un milieu filtrant, milieu poreux adapté aux caractéristiques de la suspension à filtrer sous l’action d’une force de pression fournissant
à la suspension l’énergie nécessaire qui lui permet de traverser le milieu poreux. Elle suppose donc de définir le média filtrant adapté, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, c’est-à-dire le filtre et son environnement.
Pratiquement l’application de la filtration aux méthodes analytiques ne concerne que les suspensions (solides dispersés dans un liquide) ou les fumées (solides dispersés dans un gaz) qui font appel au même milieu de filtration. (techniques de l’ingénieur, 2007)
Principe de la décantation
La décantation est une opération unitaire, parmi les techniques de séparation liquide-solide basées sur le phénomène de sédimentation, qui consiste à séparer d’un liquide les particules en suspension en utilisant les forces gravitaires (Techniques de l’ingénieur, 2007) :
Lors de la décantation, les particules, dont la densité est supérieure à l’eau, vont avoir tendance à s’accumuler au fond du décanteur sous l’effet de la pesanteur. Les particules seront éliminées du fond du bassin périodiquement et l’eau clarifiée se situant à la surface peut être évacuée.