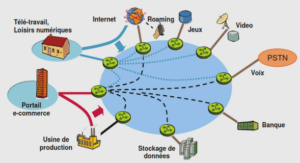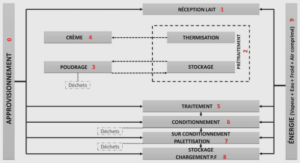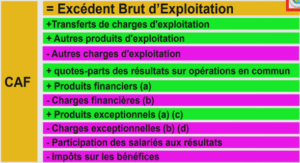Les orphelins de la politique : de la défection à l’exode
Le caractère décentralisé du réseau -qui favorise la prise de parole individuelle sans pour autant nier le potentiel d’auto-organisation des luttes- s’accorde particulièrement bien, d’un point de vue purement technologique, à l’aspiration à la participation directe et au rejet croissant de formes d’organisation centralisées ou délégataires. Une des phrases-clés du rapport qui existe entre mouvements sociaux et Internet comme scène pourrait être cette revendication qui s’est exprimée lors de nombreuses assemblées générales du mouvement de novembre-décembre 1995 : « Maîtriser sa parole de bout en bout ».
Cette revendication à une maîtrise de sa propre parole va, de notre point du vue, bien au-delà du concept de « prise de parole », développé par Albert Hirschman dans son travail intitulé Défection et prise de parole42. Il ne s’agit plus seulement, pour reprendre la définition qu’il en donne, d’adresser des pétitions individuelles ou collectives à des directions ou à des pouvoirs en place, de mener des actions de sensibilisation ou, plus largment d’adhérer à une organisation ou de « descendre dans la rue » pour faire entendre sa voix. La fonction de la parole dans le corpus de sites auquel nous avons eu accès a de fait un « pouvoir constituant » selon le concept développé par Antonio Négri, c’est-à-dire une parole directement en prise avec l’action sans avoir à être médiatisée, interprétée ou reformulée par une organisation43. À l’opposé des thèses d’Hirschman, on peut dire qu’il n’y a pas dans ce cas très précis de contradiction absolue entre défection et prise de parole. Bien au contraire la défection apparaît comme une des conditions même de la prise de parole et de l’action politique. À cet égard, on peut se demander si, après l’éclipse des luttes sociales des années quatre-vingt, quatre-vingt-dix, après ce que Florian Schneider et Geert Lovink, deux théoriciens de cet activisme électronique, qualifient de « temps post-moderne sans mouvement44 », la défection ne devient-elle pas une stratégie politique par excellence ?
Considérant les travaux sur la question de la fin des militants et du désengagement de Jacques Ion à Olivier Fillieule, on peut se demander s’il s’agit d’une crise qui traverse l’action politique ou s’il n’y a pas au contraire une crise des organisations elles-mêmes, de leur forme, de leur rapport au pouvoir, à la subjectivité, etc. Confondre les deux pourrait nous conduire à croire qu’il n’y a plus – ou de moins en moins – d’investissement politique, de mobilisation collective alors que ce seraient simplement les espaces perçus comme pertinents qui seraient désormais ailleurs. S’il y a effectivement défection, qui se manifeste comme l’explique Olivier Fillieul par un fort turn over dans les organisations, il convient de ne pas négliger l’idée mise en avant par Doug McAdam dans Freedom Summer45, montrant que les trajectoires d’engagement ne doivent pas être analysées seulement du point de vue de l’organisation mais aussi de celui des trajectoires biographiques de l’engagement. Ainsi, Olivier Fillieul explique qu’il convient de s’intéresser : « à ce que deviennent les orphelins d’un cycle de mobilisation, comment ils reconvertissent leurs ressources militantes dans leur activité professionnelle ou éventuellement contribuent par un apport de savoir-faire et de savoir-penser, à la naissance de nouvelles luttes. Cette attention à la circulation des militants dans l’espace des mouvements sociaux était d’autant plus précieuse qu’elle offrait des instruments utiles pour penser la manière dont le développement d’un champ de lutte contre le SIDA a contribué à une renaissance d’un mouvement homosexuel46 ».
Nous verrons tout au long de ce travail que, pour beaucoup d’activistes qui se mobilisent sur la scène d’Internet, il y a de nombreux « orphelins de la politique », c’est-à-dire des activistes ayant eu des engagements politiques ou associatifs très forts (dans le mouvement autonome, écologiste, féministe, etc.) et ayant trouvé dans l’activisme électronique, une manière de « recycler » et de prolonger cet engagement. Avec ces orphelins, nous voyons que l’exit, loin de coïncider avec un quelconque désengagement, est une condition de l’action politique.
La défection est sur Internet une valeur, presque une condition sine qua non. On pourrait trouver de nombreux exemples, notamment dans des forums ou des listes de discussion où la parole individuelle est la seule qui puisse avoir une quelconque pertinence.
Tout discours qui serait suspecté d’être partisan est appréhendé avec beaucoup de réticences et même parfois proscrit. Il convient de bien mesurer ici l’influence d’un personnage comme Hakim Bey qui se situe à la croisée de la culture américaine contestataire des années soixante-dix et qui apparaît comme un des fondateurs de la cyberculture47. Dans un de ces plus célèbres essais, intitulé TAZ, Zone Autonome Temporaire – lecture incontournable pour qui veut comprendre la « philosophie du réseau » -, Hakim Bey fait l’apologie de la défection en montrant que la TAZ est avant tout une tactique inspirée des méthodes de la guérilla révolutionnaire et des préceptes issus de l’Internationale Situationniste :
« Nous ne cherchons pas à vendre la TAZ comme une fin exclusive en soi, qui remplacerait toutes les autres formes d’organisation, de tactiques et d’objectifs. Nous la recommandons parce qu’elle peut apporter une amélioration propre au soulèvement, sans nécessairement mener à la violence et au martyr. La TAZ est comme une insurrection sans engagement direct contre l’État, une opération de guérilla qui libère une zone (de terrain, de temps, d’imagination) puis se dissout, avant que l’État ne l’écrase, pour se reformer ailleurs dans le temps et dans l’espace48 ».
Le principe défendu par Hakim Bey est très proche de celui des guérillas dont la principale tactique est celle du « frappez, fuyez ! ». Il confirme cette idée qui érige la défection en mode d’action politique :
« La TAZ est un campement d’ontologistes de la guérilla : frappez et fuyez. Déplacez la tribu entière, même s’il ne s’agit que de données sur le Réseau. La TAZ doit être capable de se défendre ; mais ‘l’attaque’ et la ‘défense’ devraient, si possible, éviter cette violence de l’État qui n’a désormais plus de sens. L’attaque doit porter sur les structures de contrôle, c’est-à-dire sur les idées. La défense, c’est l’invisibilité – qui est un art martial- et l’invulnérabilité – qui est un art occulte dans les arts martiaux. La ‘machine de guerre nomade’ conquiert sans être remarquée et se déplace avant qu’on puisse en tracer la carte49 ».
Contrairement aux mouvements sociaux qui se « manifestent » de manière visible et bruyante, les thèses d’Hakim Bey privilégient la défection, la disparition et l’invisibilité. Si Hakim Bey n’est pas réellement pris au sérieux dans les études universitaires sur la question des mobilisations politiques, il nous apparaît que son discours doit être écouté tant il pèse sur les représentations et sur les pratiques de ces activistes.
Ce discours n’est d’ailleurs pas très éloigné de celui de Paolo Virno qui insiste, pour sa part sur la notion d’exode. Pour lui, l’exode constitue la forme suprême de la subversion des rapports capitalistes de production post-fordistes qui se manifeste par l’institution d’une sphère publique non étatique. Dans ces conditions, il convient d’appréhender de manière radicalement nouvelle la question de la démocratie en en se fondant sur les traits marquant de l’expérience post-fordiste que sont : la virtuosité servile, la valorisation du langage, la relation inévitable avec la « présence d’autrui », etc. Ainsi, Paolo Virno propose-t-il de faire défection en mettant en avant la notion d’exode et en la situant non seulement en contre point du pouvoir d’État mais aussi de celui des organisations du mouvement social :
« J’appelle ‘Exode’ la défection de masse hors de l’État, l’alliance entre le general intellect et l’Action politique, le transit vers la sphère publique de l’Intellect. Le terme ne désigne nullement donc une simple stratégie existentielle, pas plus qu’une sortie discrète par une porte dérobée, ou encore la recherche de quelque interstice à l’intérieur duquel nous pourrions nous réfugier. Par ‘Exode’, j’entends au contraire, un modèle d’action à part entière, capable de se mesurer aux ‘choses ultimes’ de la politique moderne50 ».
Loin d’être un retrait des affaires publiques comme pourraient l’entendre les théories de la défection dans le sillage du paradigme binaire d’Hirschman, l’exode est chez Virno une « soustraction entreprenante » ou un « congé fondateur ». Pour lui, la fuite, loin d’être passive, modifie les conditions de l’action plutôt que de les présupposer comme fixes.
« La défection consiste en une invention sans préjugé qui modifie les règles du jeu et affole la boussole de l’adversaire. Il suffit de penser à la fuite massive des ouvriers américains au milieux du XIXe siècle : outrepassant la ‘frontière’ pour coloniser des terres à bas prix, ils saisirent l’occasion véritablement extraordinaire, de rendre réversible’ leur propre condition de départ51 ».
• cet égard, Yann Moulier-Boutang va presque plus loin dans son travail sur l’esclavage du salariat en avançant l’hypothèse que « les changements constitutionnels majeurs, historiques, avancent par la fuite […] C’est la défection anonyme, collective, continuelle, inlassable qui transforme le marché du travail en marche vers la liberté52 ».
L’enjeu de la défection, de l’exit ou de l’exode nous apparaît être un des enjeux majeurs de la science politique et de la sociologie du travail. Il ne s’agit pas seulement de constater – sinon de regretter – que les militants fassent défection ; il convient de bien comprendre le sens de cette défection. Retrait communautaire, individualisme ou acte constituant peuvent aussi viser à tenter de refonder la politique. C’est à partir de cette ligne de clivage que l’on doit s’interroger sur le sens de cette désaffiliation.
Nous aurons recours, tout au long de ce travail, à la notion de resignification. Cette notion, qui recouvre l’ensemble des productions, discours, etc. qui visent à reformuler ou à réinterpréter des discours ou des pratiques dominantes, s’inscrit dans ce geste de rupture et d’exit. L’expression « affoler la boussole de l’adversaire » qu’emploie Virno est assez heureuse. La caractéristique des formes d’activisme que nous allons étudier dans ce travail réside dans leur capacité à affoler cette boussole sans qu’il soit possible de savoir d’où et par qui est portée l’attaque. Ce constat vaut d’ailleurs aussi pour le chercheur qui d’un point de vue méthodologique rencontre des difficultés théoriques à bien cerner le groupe qu’il étudie et à en préciser les méthodes qui s’avèrent extrêmement mouvantes et diversifiées.
De la curiosité à l’expérimentation : l’innovation technique comme expérimentation politique
Avec la fin des certitudes, des grands récits de la modernité, véritable révolution copernicienne en politique, nous assistons peut-être aujourd’hui à une déstabilisation des formes de production du savoir tant scientifique que politique qui réactive cette culture de la curiosité.
Ainsi, on trouve chez Paolo Virno de longs développements sur la question de la curiosité dans sa Grammaire de la multitude. Le philosophe italien n’hésite pas à ériger cette propension morale, souvent considérée comme inconvenante, au rang de nouvelle vertu épistémologique de la condition post-fordiste. Pour lui, la curiosité se situe dans un no-man’s land, un moment d’exode qui s’insinue entre un non plus et un pas encore : » Non plus une trame de traditions consolidées, capable de protéger la pratique humaine de l’aléatoire et de la contingence ; pas encore la communauté de tous ceux qui n’ont aucune communauté préexistante sur laquelle compter53″.
La curiosité s’inscrit dans le répertoire des ressources cognitives mobilisables, des instruments d’apprentissage et d’expérimentation pour faire face à la métamorphose permanente des modèles opératoires et des styles de vie.
« Chaque exode exige un grand effort d’adaptation, de souplesse, de rapidité et de réflexe. Ainsi, avec un grand nombre de ses penchants, que la philosophie morale avait jugé avec sévérité, en soulignant leur caractère corrupteur et morbide, se révèlent être des qualités précieuses pour s’adapter avec souplesse à ce no-man’s land pris entre le non plus et le pas encore54».
En insistant sur la dimension expérimentale et même épistémique de la curiosité, nous nous rapprochons d’une autre définition de la curiosité, celle qui s’inscrit comme un moment particulièrement structurant dans l’évolution de la pratique scientifique55
Le régime de la curiosité est en effet, au XVIIe siècle, un régime narratif d’énonciation et de probation du fait scientifique, qui se démarque à la fois de la tradition aristotélicienne fondée sur la recension des lieux communs et de celle des savoir-faire secrets des alchimistes.
Rappelons-nous qu’en imposant le régime de l’experimentum, privilégiant la mise à l’épreuve artificielle, les savants-expérimentateurs du XVIIe siècle tentent de faire apparaître des phénomènes échappant aux perceptions ordinaires. Ce régime de probation, fondé sur le caractère spectaculaire, merveilleux de l’expérience scientifique, est par ailleurs inséparable de sa publicisation dans un espace de légitimité à travers un réseau de sociabilité qui réunit des témoins.
C’est la raison pour laquelle de nombreux commentateurs ont pu parler de « recherche de plein air ». Traditionnellement, c’est-à-dire depuis le XIIIe siècle, la légitimité scientifique se construit à travers une série de déplacements (intéressement, enrôlement, mobilisation et éventuellement dissidence), des traductions, dans lesquels certains groupes s’érigent en porte-parole d’un ou de plusieurs groupes : « La Traduction, qui apparaît comme un fondu enchaîné, est une machinerie destinée à changer la vie des profanes mais sans les associer à la conception et à la mise en œuvre de ce changement56 ».
• chacune de ses étapes, affirment Callon, Lascoumes et Barthe, la traduction est marquée par la violence des spécialistes qui prennent congé des profanes et qui clôturent la recherche sur elle-même, contribuant à un « Grand enfermement » de la recherche scientifique dans des laboratoires de plus en plus isolés du public.
Face à cette violence, Les sociologues montrent que :
« Non seulement un tel fossé [entre pensée savante et pensée ordinaire] n’existe pas, mais que, de plus en plus, il est possible, il est nécessaire, de considérer l’existence d’une recherche de plein air prête à s’engager dans des coopérations avec la recherche confinée. Oui, les profanes peuvent et doivent intervenir dans le cours des recherches scientifiques, en mêlant leur voix à celles de ceux qu’on nomme spécialistes57 ».
Cette notion de curiosité est, de notre point de vue inséparable, dans le domaine des technologies de l’Internet, de celle d’expérimentation. Technologie particulièrement instable, récente et prise, aujourd’hui encore, dans une tension très vive entre innovations et usages, Internet favorise cette propension à l’expérimentation. Comme le démontre Thierry Vedel dans son texte intitulé « L’idée de démocratie électronique, origine, vision et question58 », la notion d’expérimentation traverse l’histoire de la « démocratie électronique ».
L’expérimentation de plein air demeure en effet pour lui un des traits fondateurs des trois âges de la démocratie électronique, depuis les premières expériences sur la cybernétique dans les années cinquante, jusqu’aux actuelles expériences de démocratie sur Internet, en passant par le développement des community networks, expériences liées aux réseaux de télévision câblée aux États-Unis.