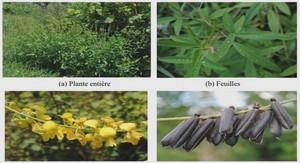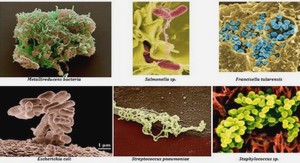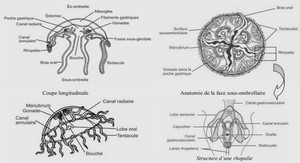DE L’ERG À LA FORÊT.DYNAMIQUE DES UNITÉS
PAYSAGÈRES D’UN BOISEMENT
Le boisement, aspect majeur des transformations paysagères
La numérisation des fonds topographiques combinée à l’analyse des photographies aériennes anciennes permet d’obtenir deux types de résultats pour chacune des dates et chacun des secteurs : d’une part des cartographies thématiques reflétant les types d’occupations des sols et d’autre part des tableaux statistiques présentant les estimations des superficies des diverses catégories d’occupation des sols. (Tableau 15.) Sur l’ensemble des trois secteurs considérés, en moins d’un siècle, près de 5800 ha sont passés du statut de dunes vives (terrains ensablés), de terres cultivées, de broussailles (végétation spontanée), et de garaas (zones humides) à celui de forêts. La comparaison entre images et l’analyse des tableaux statistiques permet à la fois de quantifier les changements et d’identifier les évolutions spatiales ayant caractérisé les paysages végétaux de la région au cours de ce dernier siècle. (Tableau 16.) Les transformations paysagères sont de 4 types : des phénomènes de mutation correspondant soit à une contraction (cas de la végétation spontanée) allant jusqu’à la disparition d’un certains nombres d’éléments (cas des zones humides et des terrains ensablés), ou bien soit à une extension (cas des espaces cultivés) avec apparition de nouveaux éléments (cas des espaces forestiers). La série de Sidi Daoud s’individualise à plusieurs titre. En premier lieu elle se distingue par la persistance de terrains ensablés. Sur le littoral occidental, aux environs de l’embouchure de l’Oued el Mgaiez, les surfaces encore ensablées en 1989 (81 ha) font l’objet d’une fixation à l’heure actuelle. Dans les deux autres secteurs, les terrains ensablés ont totalement disparu. (Fig. 56.) Le second fait marquant que l’on observe est l’importante contraction de la végétation spontanée dont les superficies, avoisinant les 2500 ha, étaient encore considérables jusqu’en 1951. Bien que le reboisement ait aussi fortement contribué à la transformation de ce type d’occupation du sol, en premier lieu, elle s’explique par l’importance des défrichements. C’est en effet ce secteur qui a connu la plus forte extension des terres cultivées. En 1989, l’importance des puits de surface aux environs des garaas témoigne de l’extension de ces espaces cultivés gagnés sur les terres marécageuses : Garaet el Ateuch où les cultures s’insèrent dans le nouvel espace forestier, Aïn halloufa et Garaet ben Khirat, aux contact direct de la forêt.Partout ailleurs, le défrichement sur les formations de type matorral est à relier à la multiplication des installations humaines et à la persistance d’activités agricoles repoussées à l’extérieur du nouveau domaine forestier. La mise en culture s’étant préférentiellement exercée aux environs des douars comme Zaouiet Mgaiez, Bou Krim. Le secteur occidental est encore celui où l’apparition de la forêt est la plus tardive. En 1951, seuls les ouvrages de fixation couvraient 106 ha alors que dans les deux autres secteurs, d’importantes superficies étaient déja reboisées : 549 ha à Dar Chichou et 98 ha à Oued El Ksob auxquels s’ajoutaient les ouvrages de fixation (respectivement 465 ha et 244 ha). Les secteurs les plus anciennement fixés et reboisés apparaissent être les deux postes forestiers. Le secteur de Dar Chichou était très largement occupé par les espaces dunaires en 1896. Comme en témoigne les premières correspondances, les habitants de Menzel Belgacem furent les premiers concernés par la menace d’ensablement. En 1951, suite à la mise en place de la législation sur les dunes, plus de la moitié des terrains ensablés était devenue des terres à vocation forestières. Les autres transformations dans le secteur de Dar Chichou, témoignent de l’importance des travaux de drainage et d’assainissement entrepris parallèlement au reboisement et à la fixation des dunes. En 1989, un vaste réseau de drainage, mis en place après l’indépendance a participé à assécher les zones humides telles Ras el Aïn, prolongement de la Garaet El Haouaria. Ce réseau de collecteurs souligne celui des routes principales et secondaires récemment aménagées illustrant l’importance de la concentration humaine consécutive à l’apparition de la forêt. La multiplication des puits de surface est manifeste à la limite nord du milieu forestier : Garaet Djebbana, Hir Abane et Ez Zountar, Dar Chichou et Ed Douamis. (Fig. 57.)A la limite sud, Aîn amrane, Garaet bab er Rmel, les puits semblent moins nombreux, leur apparition s’est accompagné d’une disparition de la végétation spontanée. Dans la zone localisée à l’ouest de Bir Mohamed ben Aatia, les propriétaires semblent être parvenus à maintenir leurs parcelles à l’intérieur même du milieu forestier nouvellement créé. Si le secteur de Oued El Ksob, s’illustre lui aussi par l’importance des surfaces ensablées, c’est avant-tout la forte contraction de la végétation spontanée (-98%) qui caractérise l’évolution de ce secteur littoral oriental. Là encore, en 1951, ces formations pré-forestières étaient encore bien observées, seuls quelques défrichements avaient concerné la partie nord du périmètre de fixation, principalement localisés dans les environs de Hamadet Fakroun. (Fig. 58.) En 1989, les défrichements au nord de la forêt semblent s’être accélérés, plus particulièrement le long du littoral oriental : Aïn Demnet Recht, Kerkouane. Plus au sud, ils ne semblent pas s’être accompagnés de l’installation de moyens de pompage, ils sont principalement localisés dans les environs des douars, Azmour, ainsi qu’aux abords des oueds et des sources, Aïn es Siguel. Une très faible surface (32 ha) a néanmoins été conservée en de rares endroits notamment aux abords de l’Oued el Aksar. Cette évolution illustre une tendance générale à la disparition des formations pré-forestières de type matorral, aussi observée sur les deux autres secteurs. Quand elles n’ont pas fait l’objet de reboisement, le défrichement s’est chargé de les exclure des zones à sols profonds. Outre leur mise en culture, la recherche de bois de chauffage ainsi que l’extension volontaire des zones de parcours et de pâturage ont également contribué à leur réduction ou à leur dégradation. En dernier lieu, ces défrichements ont concerné les ripisylves, formations végétales denses longtemps épargnées en raison de leur relative inaccessibilité et dont la dégradation pose le problème de l’accentuation des processus érosifs actuellement observée au niveau des berges
Des dynamiques actuelles complexes à l’échelle stationnelle
Des modèles dynamiques à adapter
Un peu partout sur le pourtour méditerranéen, de nombreux travaux ont été consacrés à l’étude des dynamiques forestières. Diverses études réalisées en 191 France, en Espagne, au Maroc, en Tunisie et plus récemment en Israël nous permettent d’aborder ces questions avec plus ou moins d’incertitudes. Un premier modèle fréquemment rencontré dans la littérature quand on s’intéresse à la dynamique des milieux forestiers méditerranéens est un modèle linéaire se limitant à la description des états successifs d’évolution d’une pinède. (Fig. 60.) Source : Rameau, 1991 Fig. 60. – Schéma linéaire de succession forestière en France méditerranéenne. L’exemple d’un second modèle décrivant les différents stades de la dégradation d’une Chênaie, considérée comme « climacique », sous l’effet d’incendies répétés montre les limites de ces approches se limitant à une vision linéaire de la dynamique et à une description sommaire des états successifs de la structure dont les types sont le plus souvent fort mal définis du fait de l’utilisation abusive de termes peu précis recouvrant des notions très vagues. (Fig. 61.) Source : Eurofor, 1994 Fig. 61. – Schéma linéaire de succession des différents stades de dégradation suite à la répétition des incendies. Un autre schéma emprunté à la littérature italienne illustre ce même processus de matorralisation des structures forestières en décrivant cette réduction de la complexité structurale de la forêt sclérophylle méditerranéenne. Ce modèle linéaire décrivant les différents stades successifs de la dégradation sous l’effet cumulé du pâturage et des incendies d’une chênaie considérée comme « climacique » concerne plus particulièrement les pays de la rive sud de la Méditerranée. (Fig. 62.)
Abréviations |