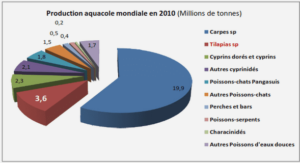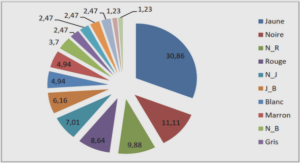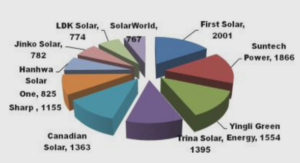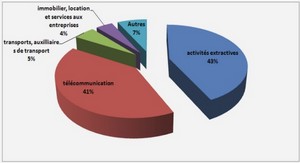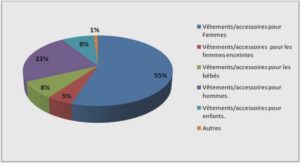Un manque de définition partagée
Rachel Botsman, auteure de What’s mine is yours et figure emblématique du mouvement du partage, reconnait que « l’économie du partage manque d’une définition partagée ». Ce qui participe à la perception de l’économie collaborative comme « … un grand fourre-tout qui voit se côtoyer des jeunes pousses du web aux dents longues, des entreprises qui valent des millions en bourse et des néobabas aux ambitions autant politiques que sociales ». (Turcan et Sudry-le-Dû, 2015).22 En introduction de la présentation de la cartographie23 des initiatives de l’économie du partage, Daugideos et Pasquier (2016), explique de manière originale les deux grandes tendances de pensées dominantes : « Au commencement de l’économie du partage étaient le consensus et l’enthousiasme. L’engouement d’alors était porté par quelques gourous aux formules grandiloquentes : l’économie collaborative était la promesse d’un monde où « ce qui est à moi est à toi » et où « la fin des hiérarchies » devenait un horizon certain. On allait même jusqu’à prophétiser « l’éclipse du capitalisme ». Au commencement donc, l’économie du partage était unanimement célébrée comme bonne et vertueuse. Puis vint le temps des premières polémiques et des premières désillusions. Le côté obscur du « collaboratif » se faisait jour au travers de quelques start-up (Airbnb, Uber…) au succès aussi fulgurant qu’insolent. Une première ligne de fracture dans le paysage de l’économie du partage apparaissait. Comme pour les chasseurs, il y avait désormais la ‘bonne’ et la ‘mauvaise’ économie collaborative » A travers les expressions imagées de ces différents auteurs, on se rend rapidement compte que ce champ est traversé par des promesses multiples et des interprétations contradictoires. « Ses partisans vantant notamment son potentiel d’innovation disruptive, voire ses avantages sociaux ou environnementaux, alors que ses détracteurs l’accusent de saper les standards de protection sociale ou de mettre à mal la capacité de l’État à réglementer l’économie » (Lambretch, 2016).
Mouvement réformiste et militant, une opportunité pour l’environnement ?
En effet, certains décrivent cette économie comme un mouvement réformiste et militant, favorisant l’innovation en termes de gouvernance politique et organisationnelle et la création de nouvelles solidarités (Bauwens, 2005). Ils y voient alors une opportunité d’émancipation individuelle et de progrès environnemental. Effectivement, pour Michel Bauwens, fondateur de la fondation P2P (peer-to-peer), ce modèle où les communautés ouvertes s’auto-organisent pour créer de vrais biens communs, est une manière de « dépasser » le capitalisme en le mettant à la marge. Il affirme alors que le P2P est le socialisme du XXIe siècle et que « La révolution induite par le P2P aura des effets similaires à ceux provoqués par l’apparition de l’imprimerie au xve siècle ».24 Pour lui, le P2P, c’est donc contribuer au bien commun. Son fonctionnement s’appuie sur une architecture en réseaux et repose sur la libre participation de personnes dans la production de ressources communes, selon la logique de « l’open source ». Il s’agit de passer d’une logique de centralisation à une logique de coordination mutuelle. Les réseaux P2P conduisent à une horizontalité de la société et cette philosophie tend à rééquilibrer nos échelles de valeurs. Bauwens différencie le P2P « commun » et P2P « marchand ». Il souhaite faire converger l’économie du commun avec l’économie coopérative. Ainsi, les contributeurs de l’économie du commun pourront créer leur propre structure coopérative, et vivre directement de leur travail. D’autres voient l’économie du partage, comme une opportunité pour la transition écologique, porteuse de promesse de durabilité (Demailly et Novel, 2014). « Revente, don, troc, location de court terme, emprunt : tous ces modèles – monétarisés ou non, entre particuliers ou par l’intermédiaire d’entreprises ou d’associations – peuvent permettre d’augmenter la durée d’usage de biens consommateurs de ressources ». Ils construisent une véritable économie du partage qui se renouvelle sous l’essor des technologies numériques.
Une opportunité marchande ?
Certains, y voient une précarisation et une « ubérisation »25 de la société (néologisme devenu tellement populaire qu’il bénéficie d’une entrée dans l’édition 2017 du Petit Robert), entrainant la déstabilisation d’acteurs économiques, l’évasion fiscale et des cotisations sociales. Des grandes plateformes, aux gouvernances fermées, dominent alors l’économie et captent de manière excessive la valeur au profil d’un seul, notamment à travers un usage intrusif et mercantile des données. « Voyagez moins cher en toute confiance » (Blablacar), « Votre course à la demande » (Uber). Ces slogans « faire plus avec moins » caractérisent pour certains le fait de consommer comme avant. Dans la Harvard Business Review, Giana M. Eckhardt et Fleura Bardhi, auteures « The sharing economy isn’t about sharing at all »26, soulignaient en janvier 2015 que « lorsque le partage est intermédié par le marché, il ne s’agit pas de partage, mais d’un échange économique ». Elles tendaient donc à ramener l’économie collaborative dans le champ de l’économie tout court. Elles évoquaient plutôt l’« économie de l’accès » (access economy), terme popularisé par Jérémy Rifkin dans son ouvrage, The age of access27. Rifkin est considéré comme l’un des théoriciens de la troisième révolution industrielle. Pour lui, les modalités de cette économie diffèrent totalement de celles qui régissaient auparavant l’ère du marché. « Dans ce monde nouveau, les marchés cèdent la place aux réseaux, vendeurs et acheteurs sont remplacés par des prestataires et des usagers, et pratiquement tout se trouve soumis à la logique de l’accès ». Le passage de la propriété à l’usage à court terme introduit alors un changement fondamental dans la perception de l’exercice du pouvoir économique. De même, il pense « qu’un monde structuré autour de relations fondées sur la logique de l’accès risque de produire un nouveau type d’être humain. ». En faisant référence aux effets de la numérisation28 et de la marchandisation de l’expérience culturelle, Rifkin évoque que nous entrons dans « l’économie de l’expérience », à savoir un monde où la vie de chaque individu a une valeur marchande. Cela fait référence à la stratégie marketing des entreprises qui adaptent leurs offres aux comportements, à l’âge des consommateurs : la notion « lifetime value », une mesure théorique de la valeur marchande potentielle de chaque moment de la vie d’un individu. Notre existence est alors marchandisée (Rifkin, 2000).
Collaboration n’est pas synonyme de coopération
Coopération et collaboration ne veulent pas dire les mêmes choses. Ainsi, une plateforme dite collaborative ne joue pas forcément le jeu de la coopération. Pour Laurent Eloi, auteur de « L’impasse collaborative : pour une véritable économie de la coopération » (Éditions les liens qui libèrent, 2018), les deux sont mêmes antagonistes. Selon lui, cette « hyperactivité collaborative » cache une véritable crise de la coopération. Il explique que la coopération, c’est « travailler » ensemble, alors que la collaboration avance l’idée « d’oeuvrer » ensemble. Les deux termes peuvent paraître isotopiques à première vue mais relèvent d’une sémantique différente. Il distingue les deux concepts sur plusieurs points. La collaboration est une association caractérisée par le travail uniquement, dans un but d’utilité et d’efficacité. Celle-ci à un objet déterminé ainsi qu’une durée déterminée. En effet, une fois le but de la collaboration atteint, celle-ci s’arrête et n’a plus de raison d’exister. Par exemple, sur une plateforme collaborative, les offreurs et les consommateurs collaborent dans le but de se déplacer, d’acheter un objet d’occasion ou encore de trouver un logement pour les vacances.
Ces objectifs atteints marquent la fin de la collaboration. Par opposition, la coopération mobilise un ensemble de capacités humaines, avec la notion de partage de connaissances et d’échange de savoirs. Ce « processus libre de découverte mutuelle » n’a pas d’horizon fini, ni forcément d’objet clairement établi. En fait, opter pour la coopération, c’est ne pas savoir jusqu’où celle-ci pourra conduire. Par exemple à travers d’Enercoop, lorsqu’un consommateur décide de se fournir en énergie auprès de cette coopérative verte, il joue le jeu de la coopération et en adhérant à cette structure, il encourage le partage entre les petits producteurs. Il peut alors participer à la gouvernance de la structure et ainsi, aller au-delà de la stricte fourniture de produit. Selon le labo de l’ESS37, la coopération peut se comprendre selon deux modalités, d’une manière générale et en particulier dans le secteur culturel : la mutualisation et la co-construction. La mutualisation est la mise en commun d’outils (locaux, moyens matériels, etc.) ou de méthodes (compétences professionnelles, etc.) entre plusieurs structures. La mutualisation est alors considérée comme la première pierre vers la construction en commun.
Changement d’échelle grâce à l’essor du numérique
L’internet d’aujourd’hui n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’il était à son origine, il va bien au-delà d’un ensemble de site web. Le haut débit, accessible à tous, a ouvert la voie à une participation massive de la plupart des citoyens à ce nouvel Internet. Ils se sont appropriés les diverses formes émergentes (partage, réseaux sociaux, blog, vidéo) dont l’apparition du smartphone n’as fait qu’accentuer l’omniprésence. Le progrès en matière de traitement algorithmique des données a totalement modifié le paysage numérique. L’essor des plateformes participe au développement du numérique et vice-versa. A travers cette symbiose, c’est toute l’économie, les services et l’innovation qui évolue. De nouvelles règles de consommation et de production se sont, petit à petit, imposées dans tous les secteurs, réinventant le fonctionnement du collectif et redéfinissant ses frontières, même le champ associatif. « Le numérique permet un changement d’échelle de l’action associative et ouvre les champs du possible de la créativité sociale». (Peugeot, 2015).
Le vocable « plateforme » peut être employé pour évoquer des sites de rencontres, des places de marchés, des applications mobiles, des sites « collaboratifs » ou encore l’internet des objets (Renaissance numérique38, 2015). Au coeur de la notion réside le principe « d’intermédiation », entre d’une part un producteur ou un vendeur et d’autre part, un utilisateur (usager ou consommateur). Cette caractéristique est commune à toutes les plateformes numériques (collaboratives ou capitalistes). Pour bien saisir la portée de la notion, il est indispensable de comprendre que celle-ci créée de la valeur pour tout un écosystème d’acteurs. En facilitant leur accès au marché, elle leur ouvre une porte à laquelle ils n’auraient jamais pu avoir accès autrement (coût financier insupportable). Les marketplaces (places de marché) par exemple, sont des services d’intermédiation commerciale, comme un site internet sur lequel des vendeurs indépendants (professionnels ou particuliers) peuvent vendre leurs produits ou services en ligne, moyennant le plus souvent une commission prélevée par le site sur chaque vente. Pour en citer quelques-unes connues : Amazon et Ebay font bénéficier de la fonctionnalité de leur plateforme aux vendeurs. La plateforme donc permet de faire sauter les frontières et offrent aux personnes la possibilité de communiquer, de consommer, échanger à travers le monde.
INTRODUCTION |