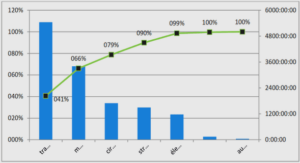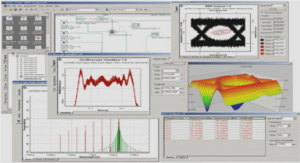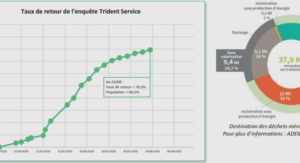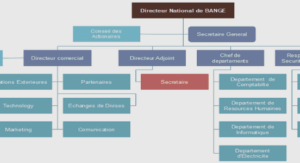La surveillance :
Elle décrit les mesures requises pour assurer le respect des réglementations mentionnées. La surveillance consiste en la prise de mesures pratiques afin de s’assurer de la réalisation des conditions requises énumérées dans le contrôle et le suivi à propos de l’exercice de la pêche et des activités annexes. Il s’agit de patrouilles maritimes lorsque cela est possible, suivant un schéma de patrouilles aléatoires. Les inspections de routine des pirogues de pêche peuvent être conduites à l’intérieur de la zone côtière concernée, avec vérifications des documents, des carnets de pêche, licences etc. Les inspections devront porter sur les engins de pêche, les captures, afin de s’assurer que les exploitants se conforment aux lois, aux règlements et aux contraintes et restrictions liées aux initiatives de gestion locale.
La mise en œuvre d’une bonne stratégie de SCS devrait prendre en compte les facteurs suivants :
• La zone couverte par la zone côtière ;
• L’importance des flottes autorisées à opérer dans la zone ;
• La valeur générée par les droits des licences et les activités connexes ;
• Les espèces capturées, leur biologie, les potentialités et de leur niveau exploitation ;
• Les zones de débarquement, le contrôle de ces zones ;
• La géographie et l’hydrologie de la zone côtière ;
• Les accords de pêche en vigueur.
La cogestion :
Selon les gestionnaires nord américains des pêches, la cogestion se définit comme“ des systèmes qui permettent un partage des responsabilités, des risques et des pouvoirs décisionnels entre le gouvernement et les intervenants qui comprennent de manière non restrictive les utilisateurs des ressources, les intérêts environnementaux, les experts et les créateurs de richesse”. Il s’agit d’un « Processus dynamique qui réunit gouvernements et sociétés, sciences et décideurs, intérêts publics et privés en vue de la protection et du développement des systèmes et ressources côtières. Ce processus vise à optimiser les choix à long terme privilégiant les ressources et leur usage raisonné et raisonnable » selon le guide de cogestion produit par la table ronde nationale sur l’environnement et l’économie Canada (1998).
Pour les spécialistes des pêches, la cogestion peut être définie comme un contrat dans lequel la responsabilité de la gestion des ressources et celles des zones côtières est partagée entre le gouvernement, les communautés de pêcheurs et les intervenants qui envisagent de gérer de manière intégrée en vue de préserver l’intégrité écologique des dites zones au regard du gradient des régimes de cogestion de Berkes (1994) (cf. Annexe 2).
Les fondements juridiques de la cogestion peuvent émaner de plusieurs sources, il existe divers mécanismes légitimes qui permettent de mettre en œuvre un système de cogestion. Il est possible de recourir à la loi en y intégrant des dispositions relatives à la cogestion, des mécanismes administratifs tels les protocoles d’entente, peuvent aussi être mis à profit pour dresser un mandat de cogestion.
L’effort de pêche :
Il représente la quantité de matériel de pêche d’un type donné utilisé sur les lieux de pêche pendant une unité de temps donnée, par exemple heures de pêche à la traîne par jour, nombre d’hameçons posés par jour ou nombre de fois qu’une senne littorale a été traînée par jour. On définie l’effort nominal comme un paramètre de gestion, alors l’effort effectif est un paramètre d’évaluation des stocks.
La pêcherie :
La pêcherie peut s’entendre comme la somme de toutes les activités halieutiques portant sur une ressource donnée, par exemple une pêcherie de merlus ou de crevettes. Elle peut également concerner les activités d’un type ou mode d’exploitation unique d’une ressource particulière, par exemple une pêcherie à la senne littorale ou à la traîne. Ce terme est utilisé dans les deux sens dans le présent document et, s’il y a lieu, l’acception particulière en sera précisée.
Les ressources biologiques :
Elles comprennent les ressources génétiques et les organismes (ou les éléments d’organismes) des populations ou toute autre composante biotique d’écosystèmes présentant une utilité effective ou potentielle pour l’humanité.
La surexploitation des ressources :
La surexploitation correspond à la situation dans laquelle, les ressources sont exploitées à des niveaux dépassant leur capacité de renouvellement.
Compréhension et objectif du sujet
Au Sénégal, la gouvernance des pêches a longtemps été basée sur un processus centralisé des mesures de gestion, c’est l’Etat qui détermine la politique et la met en œuvre. Il s’en est suivi que ces mesures ne soient pas en phase avec les réalités de la filière halieutique, par conséquent restent inapplicable par l’Etat qui, du reste n’a pas les moyens matériels et humains nécessaires. Cette situation a conduit à une surexploitation de la plupart des ressources exploitées.
Avec l’avènement du programme GIRMaC en 2005, l’Etat a décidé d’initier une nouvelle approche axée sur une plus grande responsabilisation des acteurs à la base, par l’émergence d’initiatives locales de cogestion des ressources halieutiques au niveau des sites pilotes.
Au regard des définitions des mots clés, il s’agit dans le cadre de cette étude de voir la mise en œuvre des stratégies de suivi contrôle et surveillance de ces initiatives locales de cogestion. Etant entendu que les pêcheurs eux mêmes sont impliqués et conduisent les opérations de surveillance. Nous analyserons l’organisation du scs au niveau des sites pilotes notamment les aspects liés au cadre institutionnel et juridique, les moyens mis en œuvre, enfin la coordination des stratégies locales à la vision nationale de surveillance des ressources halieutiques.
L’objectif global de la présente étude est d’analyser les aspects relatifs au suivi contrôle et surveillance des initiatives locales de cogestion au niveau des sites pilotes1 du programme GIRMaC, avec comme objectifs spécifiques :
• n°1 consistant à faire l’historique des initiatives locales qui s’inscrivent dans les processus de gestion traditionnelle des pêches.
• n°2 portant sur la caractérisation de la approche nouvelles proposée avec l’avènement du programme GIRMaC, dans la mise en place des initiatives locales de cogestion particulièrement sur les aspects de suivi, contrôle et surveillance des ressources halieutiques.
MATERIELS ET METHODES CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE l’ETUDE
L’étude a lieu dans la Zone Economique Exclusive (ZEE) du Sénégal qui est délimitée par une côte de 700 kilomètres environ et couvre une superficie de près de 206 000 kilomètres carrés. La configuration actuelle des côtes date du Nouackchottien, il y a environ 5000 ans. Elle concerne les zones côtières du plateau continental2
Nous examinerons dans cette partie le contexte des initiatives en précisant la situation géographique desdites initiatives et l’engagement des acteurs impliqués à la base.
Contexte et localisation de l’initiative de Ouakam
Le site de Ouakam se trouve dans la presqu’île du Cap-Vert qui est caractérisée par un littoral de type rocheux, avec des falaises constituées de matériaux volcaniques. Les côtes sont généralement bordées par un éboulis chaotique sous-marin ou une plate-forme d’abrasion marine (la chaussée des Almadies). Les rentrants de la côte rocheuse sont occupés par de petites plages formées de sables grossiers biogènes (Masse, 1968). Les îles de la Madeleine et Gorée présentent le même type de côtes.
Cette zone rocheuse est favorable au développement de diverses espèces aquatiques notamment les démersales côtières, elles sont présentent entre 0 et 200 mètres de profondeur comprennent :
des crustacés : crevette blanche, langouste, crabe
des céphalopodes : poulpe, seiche, calmar.
des poissons : rouget, dorade, mérou, sole, capitaine.
Elles sont exploitées par la pêche artisanale avec des engins comme : lignes à main, palangres, casiers, filets dormants. De l’avis des pêcheurs, la zone en question est un point de passage d’espèces démersales comme le thiof et le mérou jaune qui durant leur migration.