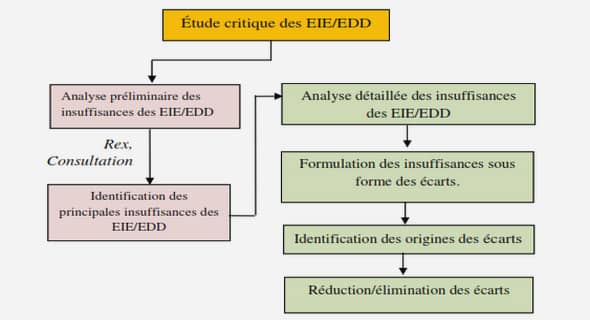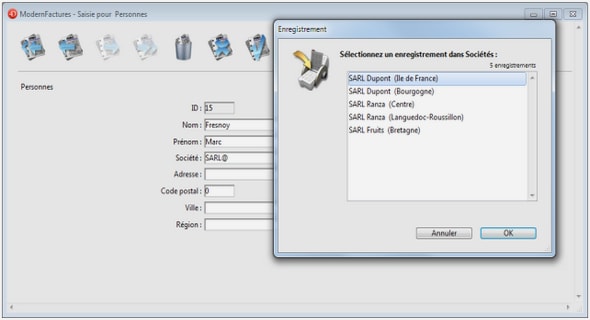Dialogisme et polyphonie
Les jeux de rôle, de par leur caractère collectif et oral, invitent à utiliser les définitions du dialo-gisme et de la polyphonie telles que Mikhail Bakhtine et Eddy Roulet les ont respectivement conçues. Dans son ouvrage Le marxisme et la philosophie du langage publié en 1929, Bakhtine ré-fute l’idée selon laquelle l’énonciation est un acte purement individuel et soutient le principe sui-vant lequel l’expression organise l’activité mentale (l’inverse étant admis jusqu’alors). Pour lui, l’expression est à la fois le résultat et le marqueur de la situation sociale des interlocuteurs.
« Toute production, fût-elle monologale, est dialogique en son principe dans la mesure où elle est déterminée par un ensemble de productions antérieures, se présente nécessairement comme une parole adressée, répond à des attentes, implique des efforts d’adaptation et d’anticipation et peut s’intégrer dans le circuit du dire et du commentaire » [Vion, 2000 : 31].
Le concept de polyphonie d’Eddy Roulet, utilisé pour présenter le dialogisme de Bakhtine renvoie à
« la diversité des voix (personnages, auteurs), voire la diversité des langues, variétés de langues et de styles, qui se manifestent dans les énoncés successifs d’un discours […] » [Roulet in Prie-go-Valverde, 1999 : 239].
C’est, dans l’analyse du jeu de rôle, un concept particulièrement intéressant car « la polyphonie peut désigner aussi chez Bakhtine un cas particulier de dualité de voix dans l’énoncé : la reprise et l’inté-gration du discours de l’interlocuteur dans le discours du locuteur » [Roulet in Priego-Valverde, 1999 : 239] qui peut être approfondie par le terme de diaphonie. En effet, en jeu, la polyphonie et la diaphonie sont constamment présentes, elles sont même le pivot de la création du récit, chaque joueur intégrant dans son discours les descriptions du MJ et ce dernier prenant en compte les re-marques et descriptions des joueurs dans le déroulé de l’action.
Statuts et frames
Dans une approche plus proche de celle de Goffman, la définition de deux notions fonda-mentales est nécessaire. Celle de statut d’abord, essentielle pour appréhender les écrits de Goffman, qui « renvoie à un ensemble de positions sociales assumées par un sujet (sexe, âge, métier, position familiale, religieuse, sociale, politique…) constituant autant d’attributs sociaux » [Vion, 2000 : 78].
L’appréhension du statut, et du rôle – qui correspond à l’aspect dynamique du statut, est capitale pour comprendre la notion de frames (cadres) mise en place par Goffman dans son ouvrage Frame analysis (1974) et approfondie par Fine dans le cadre de son ethnographie des jeux de rôle.
« Goffman describes social worlds as constituting frames of experience. He defines a frame as a situational definition constructed in accord with organizing principles that govern both the events themselves and participants’ experiences of these events » [Goffman in Fine, 1983 : 182] et Fine justifie ainsi l’utilisation de cette notion : « Like many social worlds (acting, storytelling), fantasy games produce a ‘make believe’ world set apart from the everyday world. By playing fantasy games, participants implicitly agree to ‘bracket’ the world outside the game. Yet ultimately all events are grounded in the physical world » [Fine, 1983 : 183].
Fine propose alors trois frames principaux qui correspondent à trois échelles distinctes. Le premier est composé de la compréhension que tout un chacun a du monde prosaïque. « It is a framework that does not depend on other frameworks but on the ultimate reality of events » [Fine, 1983 : 186]. Le second, appelé game frame, correspond à la situation du jeu. Les participants y sont des joueurs et leurs actions sont régies par des règles et des contraintes. Ils manipulent leurs personnages et par-tagent un savoir sur la façon dont le jeu est structuré. Ici, « players do not operate in light of their primary framework – in terms of what is physically possible – but in light of the conventions of the game » [Fine, 1983 : 186]. Le troisième et dernier frame est celui de la fantasy dans lequel les joueurs ne manipulent pas seulement des personnages mais sont personnages eux-même ; chacun ayant toutefois son identité propre.
Ainsi, « each of these three levels has its own structure of meaning (and its own shared understan-ding) » [Fine, 1983 : 186] et les rôlistes naviguent entre les différents frames selon les situations en jeu comme hors-jeu. « Every play world has a set of transformation rules that indicates what is to be treated as real and how it is to be treated as real within the make-believe framework » [Fine, 1983 : 183].
L’apport de l’ethnométhodologie
Harold Garfinkel, en s’intéressant aux façons dont les sujets construisent le social, coupant ainsi les ponts avec une sociologie durkheimienne dans laquelle les faits sociaux s’imposent aux in-dividus, propose un triptyque contenant les notions d’indexabilité, de réflexivité et d’accountability. L’indexabilité est une notion selon laquelle le sens des mots ne peut être entendu qu’au travers du contexte.
« [L’indexabilité] désigne donc l’incomplétude naturelle des mots, qui ne prennent leur sens ‘complet’ que dans leur contexte de production, que s’ils sont ‘indexés’ à une situation d’échange linguistique » [Coulon in Priego-Valverde, 1999 : 224].
Cependant, l’incomplétude des mots demeure : « Et encore : l’indexation n’épuise pas l’intégralité de leur sens potentiel. La signification d’un mot ou d’une expression provient de facteurs contextuels tels que la biographie du locuteur, son intention immédiate, la relation unique qu’il entretient avec son auditeur, leurs conversations passées » [Coulon in Priego-Valverde, 1999 : 224].
La réflexivité, notion prenant un sens différent dans les écrits proprement anthropologiques, se rap-proche ici de la notion de « langage-action » d’Austin [Austin, 1970].
« Cette notion permet de rappeler que le langage n’est pas qu’une simple représentation du réel, mais qu’il permet également de le modifier » [Priego-Valverde, 1999 : 224].
Selon cette acception, « décrire une situation, c’est la constituer » [Coulon in Priego-Valverde, 1999 : 224].
L’accountability enfin correspond aux pratiques par lesquelles les sujets participent à la construc-tion de la réalité sociale dans laquelle ils se trouvent.
Ces trois notions résonnent particulièrement bien avec une analyse empirique des jeux de rôle, ceux-ci jouant du langage commun dans un contexte de jeu et de fiction, performant ainsi l’exis-tence d’univers fictifs que les joueurs investissent et dans lesquels ils agissent.
L’intertextualité et l’histoire conversationnelle
Ces deux dernières notions font partie des incontournables de l’approche linguistique des in-teractions. Elles sont toutes les deux utiles dans la mesure où les jeux de rôle se construisent en grande partie grâce et par elles.
L’intertextualité correspond à la présence d’un texte dans un autre texte et regroupe ainsi les constantes citations à des titres ou des contenants tels que « en fait, c’est un mélange entre Stargate et Cowboy Bebop ! » ou encore les citations de références partagées comme celles issues des films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson (2001, 2002, 2003), de Star Wars (1977 – présent) ou de la série Kaamelott (2005 – 2009).
L’histoire conversationnelle quant à elle, place les interactions entre des interlocuteurs dans une perspective historique. Apparaît dès lors le caractère malléable des interactions, comportements et opinions – qui changent selon l’histoire partagée entre les acteurs – ainsi que la notion essentielle d’implicite permettant d’appréhender les interactions entre des personnes proches.
Les stratégies du discours
Les différentes stratégies mises en place par les rôlistes pour investir l’univers du jeu sont lé-gions, et chaque travail portant sur les jeux de rôle en fait état de nouvelles. Ici, je ne m’intéresserai qu’aux principales, présentes dans quasiment chaque ouvrage. Parmi ces stratégies, on trouve des pratiques interactives, que les notions présentées plus haut nous aiderons à décrypter.
Jeux de rôle, jeux de style
Les jeux de rôle, en proposant aux participants de prêter leurs voix à des personnages, néces-sitent de faire un travail sur le style de l’énonciation. Cela passe particulièrement par deux caracté-ristiques : le registre et le style.
Lorsque qu’un joueur investit un personnage, celui-ci est généralement doté d’un passé, est issu d’une classe sociale, évolue dans un espace-temps défini. Un professeur anglais de l’époque victo-rienne n’est pas sensé s’exprimer de la même façon qu’un prince d’un royaume médiéval, qu’un vampire ou qu’un alien. En voguant de jeu en jeu, on peut ainsi incarner différents personnages qui ont, théoriquement, des façons distinctes de communiquer. Les joueurs, par roleplay, sont alors sen-sés faire de leur mieux pour respecter ces codes [Caïra, 2007].
Cependant, empiriquement, la cohérence liée au registre de langue est une convention très peu res-pectée autour de la table. On peut entendre des universitaires jurer comme des charretiers dans L’Appel de Cthulhu (1981) ou de simples mercenaires débattre avec des termes précis et spécifiques des aspects sociaux d’un pays dans des jeux comme D&D (1974) : « Although several of these games are grounded in medieval romance, in which ornate, flowery langage was expected, most of the talk of characters is mundane » [Fine, 1983 : 214]. Au cours des différentes parties auxquelles j’ai participé, je n’ai jamais vu un joueur tenir le registre de son personnage jusqu’au bout de la par-tie. Après un moment de jeu les accents s’emmêlent, les registres de langues se mélangent, condui-sant à des situations absurdes62. Peu à peu, le registre de langue du personnage est abandonné.
Le style du discours d’un locuteur est par ailleurs révélateur à la fois du lien qui existe entre le joueur et son personnage et de la porosité de la frontière entre le réel et le fictif. On peut par exemple reconnaître un néophyte dès les premières minutes de jeux, car l’utilisation du style direct pour faire agir le personnage met généralement du temps à être assimilée. Le joueur parle alors de son personnage à la troisième personne : « Comme souvent dans les parties d’initiation, nos trois débutants joueront très peu leur personnage, qu’il s’agisse de le faire parler au style direct ou de lui donner un comportement adapté à son passé » [Caïra, 2007 : 104]. La plupart du temps, lorsqu’un débutant est présent dans le groupe de participants, le MJ donne des conseils pour arriver à un role-play construit le plus rapidement possible. Est notamment conseillé de privilégier le style direct lorsque c’est possible, même si l’utilisation du style indirect n’est pas condamnée. Dans des situa-tions difficiles où le joueur n’a lui-même pas les compétences (en termes de connaissances ou de re-gistre) pour poursuivre la scène, lorsque le roleplay demande une performance trop compliquée ou dans des scènes d’actions (où le personnage ne parle pas mais agit), l’utilisation du style indirect est nécessaire [Hendricks, 2006 ; Caïra, 2007].
Une autre stratégie immersive dans le récit est l’utilisation du pronom « je ». « When a player speaks during a game play, these words reflect at least two voices, those of the player and the cha-racter » [Hendricks, 2006 : 44]. Cette utilisation constante du « je », qui renvoie tantôt au person-nage ou au joueur, participe à flouter la frontière entre le réel et le fictif, et rend particulièrement po-reux les différents frames. Un participant peut en effet dire : « Je lui lance une grenade ! […] Tu peux me donner les chips ? ». La première personne n’est plus relative seulement à ego et permet au joueur de s’approcher du fantasy frame tel qu’il est défini par Fine [ibid. : 47].