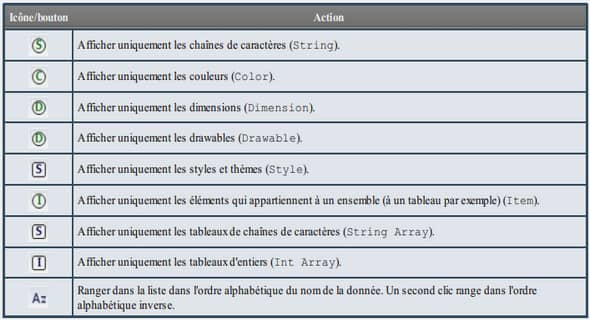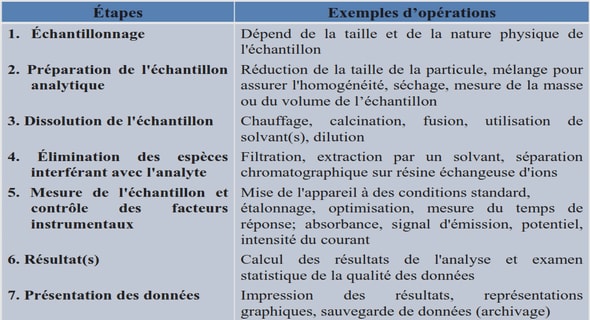Accompagnement et éthique de la relation
Conception éthique de l’accompagnement
Un sens de l’altérité se dessine dans l’accompagnement, de respect de l’autre dans ce qu’il est et veut devenir, car il ne s’agit ni de guidage ni de contrôle. La notion de temporalité est présente aussi : l’accompagnement respecte le rythme de l’autre et l’aide à se projeter vers le futur. Une éthique de la démarche se réfère ainsi à la valeur de l’accompagné, la prend en compte pour l’aider « à cheminer, à se construire, à atteindre ses buts » (Beauvais, 2004, p.101). L’accompagnant ne cherche pas à décider à la place de l’autre, mais à l’appréhender, dans le contexte institutionnel propre à son activité, en tant que « personne singulière, personne qui se construit, qui se « pro-jette » » (Ibid., p.103). La prise de conscience de la complexité et de la singularité des situations est elle-même constitutive d’une démarche éthique d’accompagnement. Si le but consiste à aider l’autre à grandir, cela doit participer d’un développement de l’intelligence qui ne consiste pas en une série d’additions ou de soustractions d’expériences nouvelles, mais en un changement de caractère de cette expérience (Vygotski, 1997). L’approche constructiviste de l’accompagnement relève d’une pensée complexe pour l’éducation du futur (Morin, 1999) : il s’agit de situer les informations dans leur contexte, d’en saisir la complexité des éléments et l’aspect multidimensionnel. « Apprendre, c’est faire des liens » (Gaté, 2009b, p. 80), mettre en réseau des informations issues d’un questionnement sur la situation. Ce paradigme de Accompagnement et éthique de la relation 92 l’apprentissage relève d’un interactionnisme socioconstructiviste qui suppose que sur son chemin de l’apprentissage, la personne accompagnée soit auteure de sa démarche mais néanmoins accompagnée dans la construction et la reconstruction de ses savoirs. D’après Boutinet, Bourdoncle et Gonnin-Bolo (2009, p.110), le besoin d’accompagnement proviendrait de la transformation de notre société qui ne fonctionne plus selon un principe de transmission par les pères du fait de la complexification et de la diversification des modes d’information et de communication remettant en question la stabilité des savoirs. La fonction enseignante, qui reposait sur « l’axe vertical de l’autorité » (Ibid., p.111) a laissé place à une fonction formatrice, centrée sur l’individu et non sur le savoir, puis à une fonction accompagnatrice, située sur un axe plus horizontal, celui du conseil de l’aîné au plus jeune. Cette évolution semble liée à un « déficit d’existentiel » (Ibid., p.113) qui rendrait l’accompagnement nécessaire par la qualité de la relation apportée. En effet, « l’humain a besoin de l’humain pour grandir, apprendre, guérir » (Cifali, 2004, p.13). C’est pourquoi l’accompagnement, que Cifali désigne par « démarche clinique », peut être compris comme une « rencontre » et ce qu’elle signifie de présence à l’autre, « de maladresses nécessaires et d’invention commune » (Ibid.) dans l’espace d’intersubjectivité créé chemin faisant avec l’accompagné. Agir sur le terrain de l’éthique, c’est se trouver « face à des indécidables ; là où le bien et le mal ne sont pas tranchés ; là où personne ne peut savoir avec certitude » (Cifali, 1999b, p.15). L’accompagnement ne peut pas avoir lieu si le praticien ne questionne pas ses valeurs dans l’action, car il confronte à « l’insaisissable » du rapport humain (Paul, 2009a, p.24). Nous développons maintenant deux dimensions indissociables d’une réflexion éthique : la responsabilité, dont nous verrons qu’elle est considérée comme principe premier de l’éthique, et la question des normes, qui intervient dans toute réflexion sur l’éthique d’une relation éducative. Nous devrons donc expliciter davantage ce qu’éthique veut dire.
Ethique de l’accompagnement et responsabilité de l’autre
La responsabilité vise l’autonomisation du sujet : celui-ci doit devenir capable d’assumer ses pensées et ses actes en s’inscrivant comme un parmi d’autres. Ses limites sont celles des autres, et devenir autonome revient à reconnaître et accepter « qu’on a besoin des autres pour être soi-même » (Vial, 2010, p.18). Pour parvenir à responsabiliser l’accompagné, le praticien 93 se pose la question des limites de sa propre action : qu’est-ce qui est bien dans ce qu’il fait ? Quelles sont les limites de son action pour qu’elle soit considérée comme bonne action pour l’accompagnant en milieu scolaire ? A ce stade de la réflexion, éthique et morale semblent se confondre. Nous distinguerons ces notions avant d’évoquer le concept d’altérité.
Les principes éthiques
Beauvais (2004, pp.106-110) définit trois principes éthiques pour l’activité d’accompagnement : – le principe de responsabilité, au sens de responsabilité morale, qui concerne « tout être humain conscient de son humanité et désireux d’en être digne » (Ibid., p.107). La responsabilité désigne, dans le droit civil, l’obligation de l’individu à réparer ses dommages. Mais il ne s’agit pas ici de cette responsabilité légale dont l’objectif est paradoxalement de faire disparaître sa responsabilité en assumant sa faute. Il est question dans l’accompagnement du sentiment de responsabilité à l’égard de l’autre pour l’accompagner vers l’autonomie, pour le rendre responsable de l’accomplissement de son projet. C’est en quelque sorte une « métaresponsabilité » (Ibid., p.108) par laquelle l’accompagnateur « se considère comme personnellement responsable de la responsabilité de l’autre ». Elle induit un devoir d’ingérence qui l’autorise à intervenir quand l’accompagné fait des choix suicidaires. – Le principe de retenue consiste à se placer à une distance « a-justée » (Ibid., p.109) c’est-à-dire pensée, questionnée et sans cesse réajustée en fonction du contexte et du chemin construit et du projet qui se dessine, pour ne pas décider à la place de l’autre. – Le principe du doute est fondamental et doit être partagé entre accompagnant et accompagné. En invitant à se remettre constamment en question, il permet de limiter une assurance trop grande pour ne pas empêcher la nouveauté de surgir. Il est en lien avec le principe d’incertitude déjà mis en avant dans le cadre d’une pensée complexe75 . La responsabilité du devenir de l’autre va donc guider l’action de l’accompagnateur, ce qui nous amène à envisager son autorité vis-à-vis de l’accompagné, en considérant l’étymologie du terme, augeo, j’augmente en latin. 75 cf. Supra Chapitre 4 p.79 94 Nous savons que la relation d’autorité éducative se construit : – par la potestas, liée au pouvoir légal du statut, de la fonction, qui revient à « être l’autorité » (Robbes, 2016, [En ligne]). Celle-ci est non négociable, mais non suffisante et peut être créatrice d’une violence institutionnelle du fait de l’asymétrie des places. – Par l’auctoritas, dont l’étymologie première, du latin augeo, signifie « j’augmente ». Elle donne à l’auctor, l’auteur, la possibilité de faire grandir l’autre, de le mener à l’autonomie, de l’amener à poser lui-même des actes qui le rendront par la suite auteur. C’est « l’art d’obtenir l’adhésion sans le recours à la menace ou à la contrainte » (Prairat, 2012b, p.14) : elle s’oppose à la contrainte par la force comme à la persuasion par arguments. Si elle requiert l’obéissance, c’est « une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté » (Arendt, 1954/1972, p.140). Par une capacité fonctionnelle à exercer une influence sur l’autre, et ce sans contrainte, l’éducateur construit des savoir faire et savoir être qui se mettent en œuvre dans l’action, dans une relation toujours contextualisée.
Différencier éthique et morale
Dans son essai consacré à la fonction de chef d’établissement, Obin (1996) aborde la problématique d’un métier situé « au carrefour de la Loi, de la Morale et de l’Ethique » (Vergnaud, 1996, p.6) et montre que ces trois approches sont en constante interrelation par les valeurs qui les fondent. Le mythe d’Antigone et de l’opposition entre loi du prince et loi divine apparaît également dans cette réflexion professionnelle pour illustrer le conflit entre devoir social et devoir moral. Inévitablement, la question de la distinction entre les dimensions éthique, morale et légale des situations de travail se pose dans les métiers de relations et de décisions humaines. Ethique et morale méritent d’être définies, leur distinction n’étant pas évidente dans l’usage ordinaire des termes. Dans la Grèce antique, l’éthique était, avec la physique et la logique, l’une des trois sciences de la philosophie. Ethique vient du grec ethos qui signifie mœurs et renvoie aux « règles de conduite qu’il est bon de tenir et à leurs justifications » (Prairat, 2008, p.297). En ce sens, éthique et morale sont donc considérées comme des synonymes pour désigner une pratique ayant pour fin une vie bonne et heureuse dans une perspective aristotélicienne. Dans son Ethique à Nicomaque, Aristote donne un but à la philosophie morale, qui contribue à la 95 définition des fins de l’action humaine selon une rationalité pratique, et non théorique : « Ce n’est pas pour savoir ce qu’est la vertu que nous nous livrons à ces recherches ; c’est pour apprendre à devenir vertueux et bons. » (Livre II, Chapitre 2, p.80)76 . L’éthique aristotélicienne considère donc tout ce qui se rapporte aux actions et se situe dans une perspective téléologique, marquée par une fin, un but ; elle pose la question de la quête raisonnée du bonheur : comment bien vivre ? Autrement dit c’est une science pratique ayant pour objet l’action de l’homme en tant qu’être de raison et visant la vertu dans la conduite de sa vie. Au tournant du 18ème siècle, les philosophes anglais Bentham et Mill mettent résolument la théorie pratique de l’éthique au service du bonheur du plus grand nombre d’individus, selon une doctrine utilitariste qui rejette l’idée d’un modèle unique de l’Homme et défend les libertés individuelles (Marzano, 2008, pp.11-14). Leur approche d’une éthique visant le bonheur de l’homme a inspiré la philosophie morale anglo-saxonne, en s’opposant à la morale kantienne d’orientation déontologique, celle du devoir. La philosophie morale en France est largement inspirée des principes universels kantiens qui désignent de manière impartiale ce qu’il convient de faire quelles que soient les circonstances de l’action (Ambroise, 2011, p.301). En développant une éthique basée sur la distinction entre le bien et le mal, en définissant les comportements moralement et socialement exigibles, Kant se demande : quel est mon devoir ? L’éthique se définit alors comme une science des lois de la liberté, supposée comme « propriété de la volonté de tous les êtres raisonnables » (Kant, 1993, p.129). Dans Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), il rassemble les préceptes qui dictent une conscience morale par le fait de la raison et de la volonté de l’individu. C’est l’idée même d’autonomie, comprise comme « la propriété qu’a la volonté d’être à elle-même sa loi » (Ibid.), qui est au cœur de la morale kantienne. En introduisant avec La Phénoménologie de l’Esprit (1806-1807) l’idée d’une construction sensible et progressive de la conscience, Hegel (1991) dénonce une tension entre éthique et morale : si la première relève d’une conformité aux coutumes rationnelles d’une communauté, la seconde consiste en une raison pratique forgée par l’individu lui-même. La valeur de l’obligation fondée par la morale est fondamentale mais non suffisante, nous rappelle Cifali (2002, p.162). Une approche clinique de l’acte éducatif peut nous permettre de prendre en compte chaque situation dans sa singularité, en prenant en considérant ce qui se joue dans le rapport à l’autre.