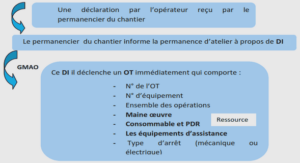COMPARAISON ET METAPHORE : ETUDE SYNTAXICO-SEMANTIQUE ET STYLISTIQUE
Les structures corrélatives
Dans la grammaire traditionnelle, la coordination et la subordination étaient les deux types de rapports permettant de lier les propositions dans le cadre de la phrase complexe. Ces deux types de structures font intervenir des éléments interpropositionnels (conjonction de coordination ou de subordination) servant de noeud aux différentes propositions. Ces deux structures ont pour rôle de marquer des types de liaisons particulières entre les propositions. Dans le cadre de la coordination, la conjonction de coordination, élément interpropositionnel, relie selon la norme des propositions de même nature et de même fonction. Fatou a mis les assiettes et Aminata a apporté le plat. mais il manquait le pain. Dictionnaire universel, 3ème Edition Ces trois propositions coordonnées sont de même nature et par conséquent, hiérarchiquement, elles sont égales. Dans le cadre de la subordination, comme nous l’avons indiqué un peu plus haut, la conjonction de subordination ou la locution conjonctive de subordination, élément interpropositionnel aussi, relie des propositions dont l’une est dite principale pour deux raisons: d’abord parce qu’elle se suffit à elle – même, ensuite parce qu’elle tient sous sa dépendance une autre proposition appelée proposition subordonnée. La seconde proposition est dite subordonnée du fait qu’elle ne se suffit pas à elle même, elle est syntaxiquement entièrement dépendante de la principale. Mais les grammairiens traditionnels, en restreignant les rapports syntaxiques pouvant associer les propositions dans le cadre de la phrase complexe à ces deux types de constructions ont véritablement omis les structures faisant intervenir en guise de noeud entre les propositions des éléments intrapropositionnels, de même que les structures impliquant une variation proportionnelle où les deux éléments constitutifs de la Comparaison et Métaphore : Etude syntaxico-sémantique et stylistique 61 locution sont respectivement situés à la tête de chaque proposition. Dans le premier cas, ces éléments sont qualifiés d’intrapropositionnel parce qu’il s’agit de locutions conjonctives dont le premier élément, support de la nuance de la subordonnée, se trouve au sein de la première proposition. La présence du premier élément de la locution conjonctive dans cette première proposition, rend cette dernière syntaxiquement et sémantiquement incomplète sans la seconde proposition. Cette deuxième proposition, elle, est naturellement et entièrement dépendante de la première. Dans le cas de la variation proportionnelle aussi, avec la présence des deux éléments de la locution au début de chaque proposition, nous avons aussi une interdépendance étroite entre ces dites proposition. Les anciens grammairiens avaient tendance à ranger ces faits sur les structures relevant de la subordination. Mais, il faut remarquer que cette taxinomie n’est pas tout à fait conforme à la définition de la subordination, dans la mesure où, dans ces structures, nous n’avons pas une dépendance unilatérale avec une proposition régente et une proposition régie, mais plutôt une dépendance réciproque entre les propositions. C’est la raison pour laquelle les linguistes ont pensé, à coté de la coordination et de la subordination, à un troisième type de structuration appelé corrélation. La corrélation désigne des choses qui vont ensemble. Dans les structures corrélatives, contrairement à la subordination, nous avons une relation d’interdépendance étroite entre les propositions, la dépendance entre les propositions est équilatérale, aucune des deux propositions ne pouvant se suffire à elle seule. Dans le cas typique de la comparaison, on distingue des comparatives exprimées en structures corrélatives sous deux formes: il y a d’un coté les comparatives introduites par des locutions conjonctives composées d’un adjectif ou d’un adverbe corrélé à la conjonction de subordination que et d’un autre coté il y a les comparaisons exprimant la variation proportionnelle caractérisées par la duplication d’un adverbe ou d’un adjectif à la tête des propositions.
Les structures corrélatives impliquées par les locutions conjonctives
Plus…que, moins…que, tel…que, autant…que, aussi…que Les locutions conjonctives introduisant les comparatives peuvent se présenter sous deux aspects : soit les deux éléments de la locution, successifs, sont localisés entre les deux propositions (position interpropositionnelle), dans ce cas d’espèce, le plus souvent, on a affaire à la subordination, soit les deux éléments de la locution sont disjoints, le premier élément se trouvant à l’intérieur de la première proposition (position intrapropositionnelle) et le second élément de la location se trouvant à la charnière de la phrase, entre les deux propositions. Dans ce cas de figure, on a affaire à des structures corrélatives : Nos sorciers nous avaient prévenus, surprendre un toubab sans casque était d’aussi mauvais augure que rencontrer un buffle unicorne Monné, pp. 80 – 81 Samba Diallo, en y arrivant, eut la surprise de voir que les femmes étaient en aussi grand nombre que les hommes. L’Aventure Ambiguë, p.55 A travers ces deux exemples, nous voyons que la présence du premier élément de la locution conjonctive, aussi, à l’intérieur des premières propositions rend ces dernières incomplètes sémantiquement et syntaxiquement. De ce fait, elles appellent nécessairement les secondes propositions qui sont, elles aussi, entièrement dépendantes. De ce fait, nous avons une dépendance réciproque, mutuelle entre les propositions de la phrase car si la seconde proposition doit sa raison d’être entièrement à la première, cette dernière aussi à nécessairement besoin d’elle pour être complète sémantiquement et syntaxiquement. Ceci est du à la solidarité étroite entre les deux termes de la locution ; c’est cette solidarité qui transparaît au niveau des deux .
Les structures corrélatives impliquant une variation proportionnelle
La variation proportionnelle est une nuance comparative très particulière. Elle permet de mettre en rapport des actions dont les progressions sont liées. En effet, la comparaison à variation proportionnelle met en évidence ce que Brunot appelle « la simultanéité du développement ou de la progression de deux actions »13 . Ce genre de comparaison repose sur un système corrélatif dans la mesure où on note une sorte de concomitance dans la progression des deux actions. Le développement ou la progression de l’une entraînant forcément celui de l’autre. Cette relation concomitante est impliquée par des locutions conjonctives très originales qui sont fondées sur la duplication des morphèmes de degré plus, moins, autant ou encore de l’adjectif de conformité tel. Ainsi, on peut avoir les structures : plus……plus, moins….moins, autant…autant, tel….tel etc., chacun des deux éléments étant localisé de façon symétrique à la tête des deux propositions, ce qui crée entre ces propositions une étroite solidarité. Plus je réfléchissais, plus je savais gré à Modou d’avoir coupé tout contact Une si longue Lettre, p100 Si nous prenons cet exemple extrait d’Une si longue lettre, nous notons une entière interdépendance entre les deux propositions. Ainsi, la première proposition, du fait de la présence de l’adverbe plus à sa tête, ne saurait se suffire à elle seule, syntaxiquement et sémantiquement. Elle a besoin de la seconde proposition pour être complète. Vice-versa, la seconde proposition, parce qu’elle est introduite par plus, doit sa raison d’exister à la première proposition, sans elle, elle aussi n’aurait pas de sens. Ainsi, la concomitance entre les deux propositions est absolue car les sorts des deux actions sont liés : le développement de l’une entraînant forcément celui de l’autre.C’est la raison pour laquelle M.J. Savelli14, de façon très imagée, parle à juste titre de « constructions siamoises » pour mettre en avant cette interdépendance absolue qui lie les propositions dans ce mode de structuration. Autant il contestait les décisions de l’arbitre, autant il perdait de temps Cet exemple illustre parfaitement cet état de fait. L’évolution de la première action entraîne forcément celle de la seconde action et vice- versa avec la présence de la locution autant ……..autant, les deux propositions se complètent mutuellement, elles sont ainsi très solidaires. D’autre part, la variation proportionnelle qui sous-tend ces constructions suit des nuances bien particulières en fonction des termes introducteurs, constitutifs de la locution : La variation peut être croissante. Dans ce cas, nous avons la locution plus….plus : Plus il le tenait en estime, plus folles étaient ses colères. L’Aventure Ambiguë, p17 Plus on est responsable, plus on le sent Une si longue lettre, p120 La variation peut être décroissante quand nous avons la locution moins….moins : Moins il travaillait, moins il avait de chance de réussir La variation peut reposer sur un rapport d’équivalence avec la locution autant…autant: Autant il pensait à la trahison, autant sa haine augmentait. On peut avoir également une variation reposant sur un rapport de correspondance, de conformité avec la locution tel…tel : Tel père, tel fils. tel le nid, tel l’oiseau – telle patrie, tel homme Michelet15 il faut remarquer que quand la variation repose sur un rapport de correspondance, elle permet surtout de corréler des éléments qui sont naturellement liés: Père/ Fils, nid / oiseau, patrie/ homme… Enfin, la variation peut être inverse, la progression de la première action impliquant l’effet inverse pour la seconde action et vice – versa. Dans ce cas de figure, la locution est composée d’adverbes qui mettent en avant des polarités opposées: plus …moins ou encore moins ..Plus: Plus longtemps il s’était retenu et moins il avait de scrupules à boire maintenant. Ville cruelle, p75 Ce genre de variation permet surtout de suggérer un paradoxe de situation: telle action devant logiquement impliquer telle conséquence, entraîne paradoxalement l’effet inverse. REMARQUE : Avec la variation proportionnelle on peut corréler plus de deux propositions; il suffit de dupliquer l’adverbe constitutif de la locution autant de fois qu’on aura de propositions dans la phrase : Plus le sang coulait, plus Johnson riait aux éclats, plus il délirait. Allah, p138 15 Michelet, Histoire de France, Préface, cité par G. et R. Bidois, op.cit p.1161 Comparaison et Métaphore : Etude syntaxico-sémantique et stylistique 66 3. Le système verbal dans les comparatives Le verbe constitue un élément fondamental de la phrase. C’est le noyau autour duquel s’organisent et se structurent tous les autres éléments de la phrase. Puisque la comparaison s’exprime en phrase complexe, il est d’un grand intérêt d’aborder la problématique des modes et des temps verbaux dans les comparatives. Les modes, nous le savons, sont fonction des variations de la pensée et de l’attitude, de la prise de position ou non, du locuteur à l’égard de ce qu’il énonce. Dans les comparaisons relevées dans les différentes oeuvres constitutives de notre corpus, nous retrouvons tous les quatre modes: indicatif, conditionnel, subjonctif, infinitif et participe. L’utilisation de ces différents modes varie selon que la comparaison porte sur un fait réel ou sur un fait virtuel, simplement conçu comme possible, ou encore sur un fait éventuel, une simple supposition. 3. 1.- Le mode indicatif dans les comparatives C’est le mode de la réalité objective et absolue par excellence. L’indicatif présente l’action ou le procès de façon neutre, sans aucune réserve. Pour G et R. Bidois, « il s’agit d’un concept de l’esprit ou le coeur n’intervient pas »16. En d’autres termes, parmi les modes disposant d’un conjugaison c’est le mode le moins chargé au plan subjectif, émotionnel, sentimental, ou affectif. Dans les comparatives que nous avons relevées, nous retrouvons l’indicatif à chaque fois que la comparaison porte sur un fait, un constat réel que l’auteur énonce tel qu’il est, en un moment donné de l’espace temps, sans aucune réserve ou réticence. Dans notre corpus, on retrouve pratiquement tous les temps notoires de l’indicatif. Le Présent de l’Indicatif: En règle générale, le présent est le temps qui coïncide avec le moment de l’énonciation. Il est logiquement employé dans l’expression de la comparaison à chaque fois que le fait de comparaison (ressemblance, dissemblance, égalité, inégalité, proportionnalité….) est constaté ou se produit au moment même de l’énonciation. Cependant, il faut remarquer que dans les exemples que nous avons relevés, nous avons plutôt un présent gnomique qui permet de poser, en guise de comparant, des référents, des attitudes générales, à valeur atemporelle : Tout en parlant, il avait agrippé Tiékomo par l’épaule comme l’on fait pour un enfant que réprimande. Bouts de bois, p138 Je rejoignais ma solitude qu’un éclairci avait illuminé un instant. Je l’endossais à nouveau comme on endosse un vêtement familier. Une si Longue Lettre, p136 Dans ces deux exemples, nous avons affaire à un présent gnomique, des comparants exprimant des actions atemporelles, des vérités générales comme l’illustre l’utilisation de l’indéfini on à valeur extensive ici. L’imparfait : Ce temps est également très usité dans les comparatives relevées. Il permet d’exprimer des faits ou actions se situant dans le passé, mais un passé imprécis, c’est-à-dire une période très étendue dans l’espace temps dont les limites, à savoir le commencement et la fin ne sont pas précisées : Comme tu fus plus grand que ceux qui sapaient ton bonheur ? Une si longue lettre, p62 Il enchaîna, vite, comme si les mots étaient de braise dans sa bouche. Une si longue lettre, p72 Comparaison et Métaphore : Etude syntaxico-sémantique et stylistique 68 Nous ne pouvons plus nous entendre toi et moi : c’est comme si nous parlions des langages différents Ville cruelle, p7125 Le plus-que-parfait : Variante composée de l’imparfait, le plus-que-parfait est aussi très usité pour exprimer un fait passé dans les comparatives. Par opposition aux autres temps du passé que possède l’indicatif, le plus-queparfait a la faculté d’exprimer un passé dans le passé, avec des actions dont le déroulement est assez lent, ce qui laisse une grande marge de manœuvre à la description. C’est donc un temps très approprié pour la comparaison quand on sait que le passé constitue une source très abondante d’images et de références pour évaluer les faits et actions d’aujourd’hui et même certains faits du passé puisque, comme nous l’avons souligné tantôt, le plus-que-parfait a la capacité d’exprimer un passé dans le passé : Voila les délégués ! Cria soudain Bachirou, comme si lui aussi avait espéré l’arrivée d’un sauveur. Bouts de bois, p47 Sounkaré, le gardien boiteux, recula dans la cour et disparut, Bakary ne toussait même plus, comme si la maladie l’avait soudain quitté. Bouts de bois, p48 Les autres femmes, ébahies, regardaient l’aveugle comme si elle avait été la seule blessée de la bataille. Bouts de bois, p 56 Comparaison et Métaphore : Etude syntaxico-sémantique et stylistique 69 Le futur simple et le futur antérieur : Le futur simple désigne des actions qui se situent dans le futur, des actions qui ne sont pas encore réalisées. Quant à sa variante composée à savoir le futur antérieur, ce temps exprime l’antériorité d’une action du futur par rapport à une autre se situant aussi dans le futur, le futur dans le futur, en d’autres termes. Il est très rare de retrouver le futur dans les comparatives. Ce fait pourrait s’expliquer d’une certaine manière par une incompatibilité relative de ce temps avec la comparaison. En effet, si la comparaison consiste à une caractérisation d’un élément (personne, chose, procès) par le biais d’un autre élément pris comme référence, il faudrait au moins que cette référence ait une existence au passé ou au présent. Ainsi, sauf cas exceptionnel, cette référence ne devrait être une chose qui n’existe pas encore, à moins que le fait de comparaison ne repose sur une éventualité ou une supposition, et là, il faut le noter, le futur est largement concurrencé par le conditionnel. C’est sans doute la raison pour laquelle nous n’avons retrouvé quasiment que quelque deux exemples où le futur simple et le futur antérieur sont employés : Chaque veuve doit doubler sa part, comme sera doublée l’offrande des petits fils de Modou Une si longue lettre, p16 On leur monte la tête et cette grève va leur coûter plus cher qu’elle ne leur apportera.
INTRODUCTION |