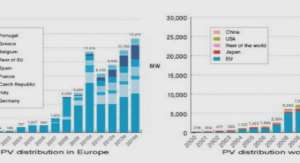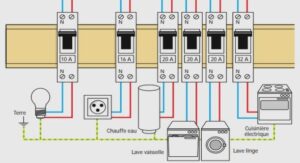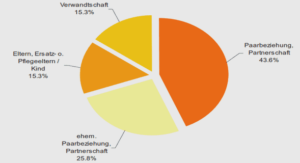Analyse d’un système régulé découlant d’une auto-organisation
Comme nous l’avons indiqué précédemment, il y a peu de données empiriques sur la mobilité quotidienne et les pratiques spatiales dans les villes africaines.
Le cas d’Addis Abeba est assez particulier à analyser car cette ville n’a pas eu de passé colonial comme la plupart des grandes villes subsahariennes. L’occupation italienne n’a duré que six ans et, bien qu’ayant marqué la ville, cela reste incomparable aux années de colonisation qu’ont connu les autres pays africains. De plus, le système de transport en commun d’Addis Abeba, même s’il a été marqué par la coopération internationale, a été mis en place par les autorités locales. Le système de minibus, pour finir, au départ auto-organisé, a été peu à peu régulé par les autorités et fait à présent partie du réseau de transport, tout en conservant un aspect individuel. Là où la plupart des pays d’Afrique subsaharienne présentent soit un système public de transport en commun, soit un système auto-organisé, Addis Abeba voit cohabiter les deux avec un système auto-organisé qui a évolué pour devenir organisé.
En effet, les autorités d’Addis Abeba ne vont pas faire le choix de la « tabula rasa » mais adapter et articuler les systèmes existants. Plutôt que de tenter de faire disparaitre le système parallèle auto-organisé, les autorités vont progressivement mettre en place des mesures pour le légaliser et le réguler. Elles vont ainsi imposer aux propriétaires de minibus de se constituer en association de 500 membres maximum, afin d’éviter une éventuelle situation de monopole. Une des dernières mesures les plus considérables a été d’obliger le port de « tapelas », panneaux indiquant le point de départ, le point d’arrivée et les arrêts remarquables du trajet du minibus, leur imposant de circuler sur un seul trajet sans pouvoir en changer en cours de journée. Cette règlementation a été mal accueillie par conducteurs et a entrainé des mouvements de grève lors de sa mise en place en Cohabitation transports en commun publics/auto-organisation des transports : Le cas d’Addis Abeba
2011. Il semblerait que la municipalité ait mis de l’eau dans son vin depuis car le week-end les minibus sont autorisés à changer d’itinéraire par rapport à celui indiqué sur leur tapela.
Les autorités ne vont pas seulement réglementer les minibus mais vont également soutenir ce système de transport collectif. Ce soutien se démontre en 2010 lorsque l’Etat éthiopien achète 500 bus Higer (un peu plus grands que les minibus) pour les revendre à des particuliers avec un système de prêt facilité. De plus, lors de mes voyages en minibus, j’ai été surprise de monter à bord de bus n’ayant pas les couleurs « officielles » bleues et blanches. Lorsque j’ai posé la question à ce propos aux chauffeurs et aux autorités, on m’a répondu qu’il s’agissait de minibus appartenant à la municipalité et qui étaient ajoutés sur les lignes où il n’y a avait pas assez de véhicules. Les chauffeurs étaient alors rémunérés par la municipalité.
On a donc un processus d’intégration du système auto-organisé au départ, avec des mesures de réglementation mais également une intervention de soutien et « d’alimentation » de ce système avec l’injection et le prêt de véhicules supplémentaires. Ces deux aspects du système de transport en commun à Addis Abeba amènent une certaine complexité pour qui ne connait pas précisément les détails des rouages administratifs éthiopiens. Cependant, ils montrent la prise en compte (par les autorités) du système auto-organisé comme un élément assimilable et complémentaire au transport public et non comme un système ennemi à éradiquer.
Le modèle : un outil indispensable pour mieux comprendre le fonctionnement d’un réseau
Un modèle est une « représentation formelle et épurée du réel ou d’un système de relation » (Brunet, 1992).
Au delà du choix du modèle, je prends le parti d’une approche par la complexité. C’est-à-dire une vision du « tout » comme indivisible. Le paradigme de la complexité s’oppose au paradigme analytique qui conçoit la réalité comme compartimentée (selon des concepts et des variables), résumée par des principes simples et régie par des relations de causalités simples (Charron, 2006). Le paradigme de la complexité, quant à lui, repose sur la distinction et l’assemblage : « distinguer sans disjoindre, associer sans identifier ou réduire » (Morin, 1990). Du fait de la volonté de ne pas réduire, la complexité met en lumière deux notions centrales en géographie : l’organisation et l’échelle.
L’organisation distingue les éléments d’un tout mais, principalement, met en avant que ces éléments sont mis en place et sont en relation les uns par rapport aux autres. Elle insiste sur les associations des éléments plutôt que sur les éléments eux-mêmes (Charron, 2006). Ces derniers sont vus comme le résultat de l’accumulation des relations qu’ils ont avec les autres plutôt que comme le résultat de logiques autonomes.
« Un phénomène complexe organise plusieurs relations entre divers éléments. Le phénomène (et son organisation) ‘’vaut plus que la somme de ses parties’’ », (Charron, 2006). L’organisation donne à voir des éléments distincts et autonomes comme cohérents et complémentaires. En cela, elle permet d’observer le phénomène complexe de manière globalisante (les éléments forment un tout cohérent) et spécifique (de nouveaux aspects apparaissent dans l’organisation).
La vision du tout comme supérieur à la somme des parties qui le compose amène inévitablement la notion d’échelle : « la complexité implique à la fois l’émergence du niveau macro à partir du niveau micro et la rétroaction du macro sur le micro », (Charron, 2006). La notion d’échelle induit que des éléments organisés (les parties) constituent un phénomène à la fois hétérogène (particulier, local) et émergeant (commun, global). La complexité comprend l’émergence d’un phénomène macro à partir d’éléments micro mais également l’influence de ce phénomène macro émergent sur les éléments micro.
Cette dialectique micro-macro est explicitée par Morin (1990) par l’exemple de la relation individu-société : « La société est produite par les interactions entre individus, mais la société, une fois produite, rétroagit sur les individus et les produit. S’il n’y avait pas la société et sa culture, un langage, un savoir acquis, nous ne serions pas des individus humains. Autrement dit, les individus produisent la société qui produit les individus. Nous sommes à la fois produits et producteurs ». La société et l’individu sont indivisibles, ils dépendent mutuellement l’un de l’autre. Cette interrelation comporte deux échelles : « celle des individus dont les interactions composent la société, et celle de la société qui normalise les individus et leurs interactions », (Charron, 2006).
Le paradigme de la complexité permet de joindre la particularité des territoires à l’universalité de certains de leurs mécanismes. Les territoires sont régis par « leurs habitants qui s’y auto-organisent à coup de boucles rétroactives et de ruptures » lesquelles engendrent des trajectoires uniques à ces structures globalement similaires.
Dans le cas du transport en commun, la forme émergente du système est le réseau de transport en commun. Cette approche est particulièrement intéressante dans le cas d’Addis Abeba car une partie du système, le réseau de minibus, s’est mis en place de manière spontanée. A l’origine, ce système était purement auto-organisé et a été peu à peu régulé par les pouvoirs publics, il ne présente pas le même système de relations entre agents (acteurs du transport en commun) que le système mis en place dès l’origine par les pouvoirs publics (l’entreprise publique Anbessa).
Les informations récoltées sur le terrain vont permettre d’utiliser le modèle dans une carte modèle du réseau de transport en commun d’Addis Abeba et dans un modèle des relations entre acteurs de ce réseau transport en commun.
Une représentation formelle et épurée du réel…
Généralement, une carte représente fidèlement « les cordonnées géographiques des lieux, les formes des circonscriptions, des Etats et des linéaments (rivières, routes) même quand elles sont fortement généralisées » (Brunet, 1987). Dans ce cas, la carte est une « carte reflet ».
Le modèle cartographique a pour but de réduire les « bruits » ou à les sélectionner pour s’en servir comme objet de recherche. C’est le cas des plans de métros actuels, par exemple, qui figurent des directions générales, la succession des arrêts et des correspondances, sans représenter les virages et les tours qui ne servent pas à la compréhension des usagers. Ces cartes « lissées » estompent les détails locaux pour mieux faire apparaitre la configuration générale.
Ces cartes ne sont pas épurées par facilité car ce travail de modélisation requiert une maitrise technique autre que pour la carte reflet. Elles sont crées pour rendre plus lisibles certains éléments ou phénomènes et parfois révéler « l’ordre sous-jacent au désordre apparent » (Brunet, 1987).
Les éléments spatiaux de base sont appelés « chorêmes » (du grec chôré, région ou espace géographique) : leur organisation permet mettre en valeur des systèmes ou phénomènes géographiques, « c’est leur arrangement qui fait le dessin des distributions, ce sont les « mots » et les expressions du langage de la carte, c’est avec eux que les sociétés vivent et expriment leur
« spatialité » » (Brunet, 1987).