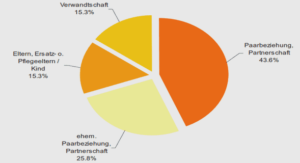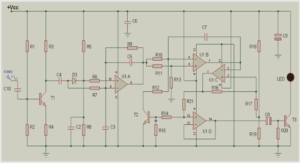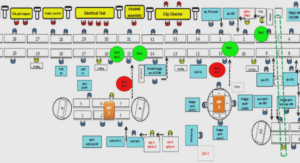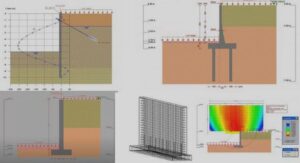Maria das Graças Silva Foster
Directrice générale de Petrobras, Brésil
Par la fenêtre du car scolaire qui l’emmenait au lycée, Maria das Graças Silva Foster contemplait avec curiosité la raffinerie et le centre de recherche de Petrobras, l’un des nombreux complexes d’un couloir industriel à Rio de Janeiro; c’est là que germa en elle l’idée d’une carrière dans le pétrole. Ensuite, elle continua de traverser ce couloir industriel pour aller à l’école d’ingénieur.
Elle entra à Petrobras comme stagiaire dans ce même centre de recherche, décrochant parallèlement des diplômes en génie chimique et génie nucléaire ainsi qu’un diplôme d’école de gestion dans les meilleures universités du Brésil. À Petrobras depuis 33 ans, elle est devenue la première femme à occuper le poste de directeur général en février 2012. Elle est l’une des neuf femmes seulement à présider aux destinées d’une des 500 premières entreprises d’Amérique latine.
Petrobras est un géant du pétrole et de l’énergie. Fondée il y a plus de 58 ans, c’est la plus grande entreprise du Brésil. Sa production, plus de 2 millions de barils de pétrole et de gaz par jour en 2012, devrait doubler d’ici à 2020 pour atteindre quelque 4,2 millions de barils par jour. Selon Maria das Graças Foster, l’essor de la production va aussi doper la croissance de l’économie brésilienne. Elle considère que sa mission à la tête de Petrobras est aussi de participer au développement du pays. Avant de devenir directrice générale, elle a été la première femme à siéger au conseil d’administration, en tant que Directrice de la division gaz et énergie en 2007, déjà une performance quand on sait que jusqu’aux années 70, le groupe recrutait peu d’ingénieurs parmi les femmes. Selon Maria das Graças Foster, c’est son rêve de lycéenne qui a conduit à sa réussite dans l’univers très masculin du pétrole et du gaz. La clé du succès, à ses yeux, est de «toujours bien se préparer, connaître ses dossiers, et avoir les connaissances et le courage nécessaires pour trancher et prendre des décisions».
Il est aussi essentiel pour les dirigeants de connaître le pouls de leur entreprise. «Les grands dirigeants doivent comprendre leurs salariés, être forts et attentifs», ajoute-t-elle. «La solidarité et une connaissance approfondie des activités de l’entreprise sont deux ingrédients très importants pour bien diriger.»
Lorsqu’on lui demande quel conseil elle donnerait à d’autres femmes qui visent le sommet, elle répond qu’«un dirigeant ne cède pas aux difficultés, mais s’en sert pour nourrir sa moti-vation et son énergie».
Niccole Braynen-Kimani
Barbara Stocking
Ancienne Directrice générale d’Oxfam Grande Bretagne
Dès son adolescence à Rugby (Angleterre), Barbara Stocking a commencé à poser les questions qui allaient la mener à une carrière dans le développement international. C’est là qu’elle a pris conscience des distinctions et des classes sociales. «La différence de moyens que je constatais entre l’école publique que je fréquentais et l’école privée m’a fait réfléchir aux inégalités. J’ai commencé à me demander pourquoi la société était ainsi», explique-t-elle. C’est donc des inégalités autour d’elle et dans des pays lointains — ainsi que de ses parents qui, malgré une vie de rude labeur, donnaient beaucoup à la collectivité — qu’elle a tiré son inspiration : son parcours professionnel répond à ces deux influences qui ont marqué ses années de formation.
Après avoir étudié les sciences naturelles à l’université de Cambridge dans les années 70, Barbara Stocking décroche un poste de chercheur aux États-Unis. C’est à travers un projet de l’Organisation mondiale de la santé en Afrique de l’Ouest qu’elle a découvert le secteur du développement international. À bien des égards, cette transition lui est apparue toute naturelle : ses connaissances scientifiques et médicales trouvaient leur application directe dans un pays en développement.
De retour au Royaume-Uni, elle finit par présider l’associa-tion internationale d’aide et de secours d’urgence Oxfam, poste qu’elle vient de quitter après douze ans. Barbara Stocking avait été préparée à assumer la direction d’Oxfam par différentes fonctions à responsabilités au sein du système de santé bri-tannique, le National Health Service. «À bien des égards, les années au NHS ont été très dures. J’avais l’impression qu’il me fallait prouver qu’une femme pouvait faire aussi bien qu’un homme, se souvient-elle, à Oxfam, j’étais beaucoup plus à l’aise : personne ne s’étonnait de voir une femme endosser le rôle de directeur général, même si j’ai été la première femme à le faire.»
Dambisa Moyo, économiste et auteur d’origine zambienne, est un peu une star du monde de l’économie et de l’entre-prise : une des «personnes les plus influentes» selon le magazine TIME, une «visionnaire remarquable» selon Oprah Winfrey et sacrée «agitatrice de la planète» selon le Daily Beast. Dambisa Moyo est peut-être connue surtout par sa critique sans concession de l’aide internationale. Dans L’aide fatale : les ravages d’une aide inutile et de meilleures solutions pour l’Afrique, grand succès de libraire paru en 2009, elle démontre que l’aide occidentale cause plus de tort qu’elle n’apporte de solutions, car elle ne fait qu’étouffer les efforts de dévelop-pement et nourrir la corruption. Depuis lors, elle a publié deux autres livres qui donnent à réfléchir : Winner Take All, qui décrit les évolutions géopolitiques et les tendances des marchés des matières premières, et How the West Was Lost, sement et de la santé publique en secours humanitaire, étant notamment en première ligne sur les questions d’égalité des sexes, d’environnement et de transparence.
Elle n’a pas oublié l’époque où le fait qu’elle même soit une femme posait problème. «Une année, je participais à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, et quelqu’un m’a présentée au PDG d’une grande entreprise. Il s’attendait tel-lement à voir un homme, que je crois bien qu’il ne m’a pas vue!»
En juillet, elle sera de retour à l’université de Cambridge où elle présidera le Murray Edwards College, l’un des deux établissements exclusivement féminins de Cambridge, qu’elle a elle-même fréquenté lorsqu’il s’appelait New Hall. «C’est un véritable privilège de prendre la présidence d’une institution si profondément attachée à voir les femmes s’épanouir et se développer pour réaliser pleinement leur potentiel et dépasser leurs propres attentes.»
Si les écrits de Dambisa Moyo font autant de bruit, c’est notamment parce que son parcours est aussi brillant que les thèses qu’elle déploie. Née en 1969 à Lusaka, pendant l’une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire de la Zambie, Dambisa Moyo est arrivée aux États-Unis pour faire ses études à Harvard et à l’American University. Elle passa ensuite deux ans à la Banque mondiale, puis obtint un doctorat d’économie à Oxford. Enfin, elle travailla pendant dix ans à Goldman Sachs.
Les parents de Dambisa Moyo ont toujours attaché une grande importance à l’éducation. «À la maison, on parlait beaucoup politique et économie», se rappelle-t-elle. Très jeune, elle a donc appris à tordre le cou aux idées reçues.
Quel est le moteur de ses multiples succès? «Mon insatiable curiosité à propos du monde», répond Dambisa Moyo. «À mes yeux, il est bien plus facile d’apprendre, de remettre en d’affaires de 396 millions de dollars.
Fille benjamine d’un magnat de l’énergie, Kim aurait très bien pu faire un beau mariage dans l’élite de la société coréenne sans avoir jamais besoin de travailler. Mais elle était animée d’une grande énergie et voulait être maître de son destin.
Après un diplôme en théologie de l’université Yongsei à Séoul, Kim décide de partir étudier à Amherst College dans le Massa-chussetts, malgré la vive opposition de son père, qui ne voulait pas qu’elle s’éloigne autant de sa famille. Kim continua ensuite son parcours universitaire à la London School of Economics et à l’université de Harvard, où elle rencontra son futur mari, un britanno-canadien.
Que Kim décide d’épouser l’homme de son choix, c’en était trop pour son père, et pendant quelques temps, ce fut la brouille entre eux. Par l’intermédiaire d’une connaissance, elle décrocha son premier emploi dans le grand magasin Bloomingdale’s à Manhattan, où elle travailla sous la supervision directe du Pré-sident, Marvin Traub. Elle apprit tout de l’industrie de la mode.
Environ cinq ans plus tard, Kim renoua avec son père et eut l’occasion de l’aider dans des négociations qu’il menait aux États-Unis. Elle put ainsi lui démontrer son talent pour les affaires, et obtint de lui 300.000 dollars pour créer le groupe Sungjoo.
L’investissement s’avéra fructueux. Depuis le début des années 90, la société fait connaître en Asie un grand nombre de marques occidentales de luxe et a obtenu des licences de distribution sur Gucci, Yves Saint Laurent et Marks & Spencer. Kim est maintenant reconnue comme une véritable virtuose des affaires, figurant d’ailleurs au palmarès «Women in the Mix 2013» du magazine Forbes Asia, qui comprend les 50 femmes les plus influentes du monde des affaires en Asie.
question, d’aspirer à mieux et de progresser dans un monde où l’information est à portée de main», ajoute-t-elle. «J’essaie de profiter des chances extraordinaires qu’offre notre époque.» Dambisa Moyo convient que de plus en plus de femmes parviennent, comme elle, à des postes de pouvoir dans les administrations publiques et les entreprises, mais il reste tant à faire. «La représentation des femmes à ces niveaux reste déplorable», estime-t-elle.
Il y a certes des progrès, mais on peut faire plus pour préparer les femmes des prochaines générations à assumer des rôles plus influents dans tous les domaines.
Quant à la personne qui a exercé le plus d’influence sur sa trajectoire, c’est Nelson Mandela. «Pour démontrer qu’il fallait instaurer le suffrage universel en Afrique du Sud, il a fait appel à la logique et aux faits, pas seulement à la morale et à l’émotion.»