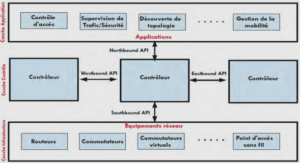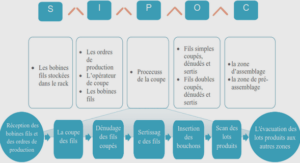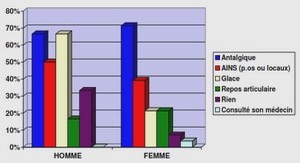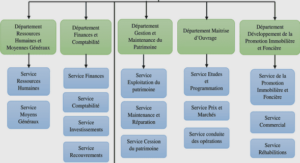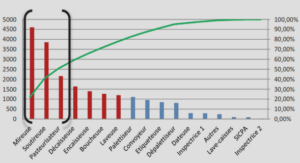Garder la tête haute Ou comment renier ses promesses sans en avoir l’air
En matière diplomatique, une parole vaut acte. Plus précisément, la démonstration de force verbale – avant même celle qui pourrait advenir via l’usage de la force – vaut déjà force en soi. Sans quoi les termes n’ont guère de sens, les propos se galvaudent et tant le dialogue que la négociation perdent leur valeur intrinsèque.
Plus puissant et/ou prestigieux est celui qui tient un propos, plus grave est en principe proportionnellement son poids, surtout lorsque le propos tenu est une menace. On peut changer d’avis sur un homologue – ainsi, pour le président turc Erdogan, le dictateur Assad était un « cher ami » et « un homme d’État valeureux » en 2010, mais un « irresponsable criminel » et un despote « à destituer » en 2011… – mais quand une menace précise est prononcée publiquement sur un fait précis, elle vaut inscription dans le marbre. D’autant plus si elle provient du président en exercice de la première puissance économique et militaire du monde. Le régime politique ainsi désigné a donc tout à craindre s’il poursuit dans la voie qui semble être la sienne.
Contrairement à l’idée répandue par les contempteurs traditionnels des États-Unis, ce pays ne s’est affaibli au cours de la décennie 2000 que relativement à d’autres puissances émergentes, dont la Chine et le Brésil. Il demeure, dans l’absolu et de très loin, la principale puissance mondiale. C’est d’autant plus vrai dans le vaste bassin méditerranéen et la région moyen-orientale, sillonnés de redoutables flottes de guerre à la puissance inégalée, où Washington dispose aussi de bases militaires et d’alliés en quantité et en qualité : Égypte, Arabie saoudite, Qatar, Koweït, Israël, ainsi que des membres de l’OTAN… Dans cette zone, point d’adversaires à la mesure des Américains. Fort de cette situation générale, Barack Obama, l’hôte de la Maison-Blanche – qui peut, rappelons-le, décréter des frappes sans en avoir à en référer aux chambres (à condition qu’elles soient limitées dans le temps, à trois mois) et bénéficie à l’époque d’une majorité politique (démocrate) au Sénat, qui lui assure un précieux soutien en cas de conflit plus prolongé (face à l’hostilité éventuelle des sénateurs républicains) – est donc en mesure d’exercer de fortes pressions sur le régime syrien de Bachar el-Assad (voir la leçon précédente). Celui-ci mène une répression excessivement violente à l’encontre du mouvement de contestation d’abord civil et pacifique du Printemps arabe de 2011, puis militarisé et sans cesse plus islamiste depuis 2012, et est soupçonné par Washington de vouloir user pour ce faire de gaz de combat neurotoxiques, dont dispose son armée, tout à fait officiellement d’ailleurs. Cela dit, ce ne serait pas la première fois qu’un dictateur perpétrerait des crimes odieux sans réaction américaine ; l’Irak de Saddam Hussein avait bien gazé ses villages kurdes en 1987-1988 (opération Anfal), les juntes sud-américaines des années 1970 n’étant pas en reste dans leurs politiques violemment répressives. Mais cette fois, il en est autrement : le président américain en personne avertit solennellement Assad, dès 2012, que la « ligne rouge » sera franchie en cas d’utilisation de cette arme terrifiante et interdite par les conventions internationales et ajoute que toute violation de cette « ligne rouge » entraînera des représailles.
Ce terme de « ligne rouge », dénué de toute ambiguïté, est non seulement employé très solennellement, mais répété à plusieurs reprises. Pourquoi le président Obama tient-il ce discours ferme et menaçant ? Sans doute se préoccupe-t-il du sort des populations arabo-musulmanes subissant les revers de leur Printemps, dans la lignée de son fameux discours du Caire de juin 2009 adressé aux musulmans du monde entier. Peut-être cherche-t-il également à prouver que son prix Nobel de la paix accordé trois ans auparavant est mérité.
Toujours est-il que lorsqu’une première fois, en avril 2013, Bachar el-Assad fait usage de gaz neurotoxiques, Washington ne réagit pas. Plus précisément, le Département d’État émet des doutes sur la provenance des obus d’artillerie garnis de gaz mortels, propulsés sur des civils à la Ghouta. Certes, les centaines de personnes victimes de gaz neurotoxiques sont bien réelles – des prélèvements ont été faits par des médecins et des ONG puis analysés par des laboratoires français mandatés par le Quai d’Orsay –, mais il existe une probabilité, si faible soit-elle, pour que ces bombardements soient le fait des forces hostiles à Assad ayant pour but de le discréditer. Quand une seconde fois, le 23 août, une attaque aux gaz de combat est menée dans le même quartier de façon plus massive et « signée », le doute n’est plus sérieusement permis, en dépit des dénégations du dictateur syrien. Le 30, John Kerry, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, tient alors une conférence de presse très vindicative à l’endroit d’Assad, parlant d’un « crime contre l’humanité qui ne devrait pas rester impuni », et affirmant que « si le monde exprime sa condamnation et que rien ne se passe, cela voudra dire quelque chose ».
C’était sans compter un rebondissement de dernière minute. À quelques jours ou peut-être quelques heures du déclenchement des frappes américaines (et françaises), la machine s’arrête net. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vient in extremis de proposer un plan de sortie de crise. Sous l’égide de son allié russe, la Syrie s’engage à court terme et sous supervision internationale à se séparer de son arsenal de gaz chimiques. En contrepartie de quoi aucune mesure de rétorsion militaire ne sera prise à son encontre. Naturellement, en excellent tacticien des rapports de force, Assad accepte aussitôt le plan puis John Kerry rencontre Sergueï Lavrov. À la clé, l’accord est conclu et la crise s’éloigne. Mais Obama, en se ruant littéralement sur la perche tendue par Lavrov, a capitulé en rase campagne en se déjugeant. Dès lors, que vaut encore sa parole, sa « ligne rouge », ses menaces et ses effets d’annonce ?
Dans l’immédiat, le grand perdant sur l’échiquier diplomatique semble être la France. François Hollande s’était en effet personnellement engagé à intervenir militairement et, du reste, non pas en suiveur mais bien comme fer de lance de la riposte anti-Assad. L’accord de sortie de crise se réglant, comme à la grande époque de la guerre froide, entre grands, ni la France ni le Royaume-Uni n’y sont conviés.
Cependant, les vraies victimes de la reculade américaine sont les plus fidèles alliés de Washington, à commencer par l’Arabie saoudite et les autres pétromonarchies bédouines du Golfe, Koweït et Émirats arabes unis en tête. Après tout, comment ces États fragiles – pour ne pas dire indigents – sur le plan militaire pourraient-ils faire encore confiance à leur grand protecteur traditionnel alors que celui-ci, sans crainte d’escalade majeure à son détriment, peut décider subitement de se déjuger face à un satrape incarnant leur ennemi juré ? Après l’accord russo-américain de septembre, les diplomaties de ces États reprocheront amèrement à Obama d’avoir fait machine arrière, au diapason d’une Ligue arabe qui avait elle-même appelé à frapper Assad.
Bien plus problématiques en termes de crédibilité sont les conséquences de cette décision auprès des alliés est-asiatiques des Américains, dont le Japon. Grande puissance économique – la troisième derrière la Chine, bien que plus avancée sur le plan technologique –, l’archipel nippon demeure un nain militaire en vertu des traités d’après-guerre. Ainsi, Tokyo s’est-il engagé dès 1950 à ne pas développer d’armements stratégiques (notamment l’arme atomique) et à ne pas déployer ses troupes hors de l’archipel. Pourtant, face à la montée en puissance – et en agressivité ? – du grand voisin ultra-marin chinois, le Japon doit impérativement pouvoir compter sur son protecteur américain. C’est d’autant plus vrai qu’outre Pékin, Moscou dispose bien entendu aussi de la bombe et qu’aucun compromis ne paraît pouvoir être envisagé avec Vladimir Poutine au sujet des îles Kouriles et du nord de Sakhaline. Ce qui est vrai pour l’allié nippon l’est aussi avec les alliés sud-coréen, philippin, taïwanais… Après la défection américaine en Syrie, tous se demandent si Obama aura cœur à tenir ses engagements en cas de montée aux extrêmes avec Pékin ou une autre puissance hostile comme la Corée du Nord. D’où la tournée diplomatique délicate d’Obama dès avril 2014 (celle d’octobre 2013 ayant été annulée), sans nul doute destinée à rassurer ses alliés de la région. Certes, le président américain, constitutionnellement garant des traités, se fait fort de rassurer ses hôtes successifs, étendant même sa protection au… Vietnam, pourtant toujours officiellement communiste, mais parvient-il alors à convaincre ? Rien n’est moins sûr au vu de l’accueil mitigé qu’il reçoit et des déclarations de nombre de dirigeants et de journalistes après son passage…
Finalement, en revenant ainsi sur sa parole, Obama n’a-t-il pas indirectement encouragé les autres régimes dictatoriaux à perpétrer des crimes massifs ? Quand Saddam Hussein massacrait au gaz de combat des milliers de civils kurdes en 1988, le président américain, en l’occurrence Ronald Reagan, n’avait rien promis et n’avait pas établi de « ligne rouge »… Toute la différence réside dans cet engagement.
Toutes choses étant égales par ailleurs et sans établir de comparaison inopérante, le syndrome de Munich joue à plein – surtout aux yeux des Européens – à chaque promesse de soutien ou menace de sanction non tenue. Au fond, ce qui aura constitué une véritable catastrophe dans le renoncement franco-britannique de Munich en septembre 1938, et peut-être davantage encore dans la retenue militaire de la « Drôle de guerre » 1939-1940, c’est bien le non-respect des promesses formellement établies et réitérées des années durant et sous tous les gouvernements successifs face à Hitler dès 1934. Qu’un pouvoir, quel qu’il soit, juge préférable de ne pas intervenir, de jouer l’apaisement, de renoncer à telle partie de territoire, tel traité d’alliance ou tel avantage économique, ne pèse pas intrinsèquement. En revanche, s’il avait affirmé qu’il ne céderait pas, sa crédibilité devient sujette à caution.
Le terme trop souvent utilisé et donc galvaudé de « concert des nations » est trompeur sur la nature des relations entre États ; le plus souvent, notamment lorsque sont en lice dans une crise des États dotés de régimes autoritaires, il conviendrait davantage de parler d’arène, tant les rapports de force priment sur la négociation ouverte et transparente. Or, sauf à considérer que la faiblesse assumée incitera les voisins et/ou adversaires à s’y résoudre également et à renoncer à toute vindicte – hypothèse que hélas rien dans l’histoire ne permet de confirmer –, on admettra un postulat géopolitique fondamental : la puissance est vertueuse. Mais elle l’est à deux conditions. La première est de s’appuyer a minima sur des valeurs morales et éthiques pour ses prises de décision diplomatiques et stratégiques. La seconde est de s’assumer : un État doté de tous les instruments de la puissance refusant d’y avoir recours en cas d’atteinte à ses intérêts et à la parole de son dirigeant s’expose à une chute de crédibilité dramatique, correspondant déjà en soi à un affaiblissement certain.
Redorer son blason Ou comment rebondir quand on n’en a plus les moyens
Traditionnellement, on considère en géopolitique que trois compétences, ou plus précisément trois attributs, sont nécessaires à l’établissement de la puissance. En premier lieu, un État doit pouvoir disposer d’une vraie diplomatie. Un réseau dense de diplomates, formés et nombreux, dotés de moyens pour se déplacer et accueillir dans de bonnes conditions. Sans capacité de négocier avec le plus d’États possible, on finit par s’isoler, perdre en crédibilité, se faire dépasser par d’autres et, in fine, perdre en puissance car la diplomatie demeure de tout temps un viatique non seulement discursif, mais économique voire militaire. Le second élément est incarné par un haut niveau de technicité et d’ingénierie. En matière civile comme militaire, agricole naguère, industrielle ensuite, high-tech récemment, l’État puissant sait innover : il doit pouvoir proposer (en interne comme à l’exportation) des produits à haute valeur ajoutée qui favoriseront sa balance commerciale et seront susceptibles d’accroître son indépendance stratégique face à d’autres puissances elles aussi technologiquement avancées. Le troisième élément constitutif de la puissance est la force brute. Une armée capable de défendre les intérêts vitaux de l’État et, mieux encore, de porter secours à des alliés et se projeter loin et redoutablement : voilà qui s’avère déterminant. Cela suppose des effectifs substantiels et des équipements performants. Pour résumer, il faut des diplomates, des ingénieurs et des soldats, et par conséquent, très prosaïquement, des ambassades, des fabriques innovantes et de solides matériels de guerre.
Or, rares sont les États, dans l’histoire autant que dans le monde contemporain, à réunir efficacement et de façon pérenne ces trois attributs de la puissance, soit par manque de volonté politique en haut lieu, soit par manque de savoir-faire et/ou d’expérience, soit encore (et le plus souvent) par manque de moyens financiers. Car cette triade a un coût, généralement prohibitif, en tout cas jamais marginal. Néanmoins, certains régimes étatiques, bien que désargentés, sont soucieux de conserver leur statut de grande puissance. Ils optent donc pour des politiques proactives, très interventionnistes, afin de demeurer crédibles – ou d’en donner l’illusion. Le but étant d’apparaître le plus influent possible sur les plus grands espaces possible. Parmi ces puissances, la France demeure à ce jour un cas emblématique.
Sans remonter aux temps médiévaux immémoriaux des Mérovingiens et autres Carolingiens, on admettra que l’État français – antérieur à la nation française et peut-être même son vrai créateur – s’est presque toujours considéré comme devant incarner une puissance. Qu’elle fût proclamée de droit divin ou au nom du peuple souverain, impériale, monarchique ou républicaine, cela ne change guère le fond de l’affaire. Cette représentation de puissance est partagée par quantité d’autres États mais pas tous, et pas de façon aussi pérenne. Depuis Louis XI au moins, une diplomatie forte accompagne toujours constitutivement la puissance militaire française.
Prenons le cas récent et très emblématique de Charles de Gaulle, qui revient aux affaires en 1958-1959, élu président d’une république très centralisée en matière de défense et d’affaires étrangères. Le chef de l’État y concentre en effet l’essentiel des prérogatives, contrairement aux deux républiques précédentes. Patriote invétéré jugeant fondamentalement positive la puissance, De Gaulle décide que la France doit se hisser au niveau des deux supergrands de l’époque : les États-Unis et l’Union soviétique. Or l’homme du 18 Juin est extrêmement lucide quant aux rapports de force et à l’état général du pays. Certes, les Trente Glorieuses battent leur plein et la France s’est redressée depuis 1945, possédant en outre – comme les deux superpuissances – la triade diplomatie/ingénierie/armée. Mais d’une part sa quantité de soldats et de matériels militaires ne peut se comparer avec celle de ses « concurrents », d’autre part les ressources énergétiques et démographiques de ces derniers ne sont pas rattrapables à horizon utile et raisonnable de deux ou trois générations. Autrement dit, Moscou et Washington ont et auront durablement des moyens financiers incomparablement plus élevés que Paris. Il va donc falloir s’adapter… Pour ce faire, De Gaulle décide – outre un renforcement des moyens militaires et des pôles de recherche – de faire jouer le levier diplomatique. Après tout, en « décolonisant » dans de bonnes conditions la Communauté française (anciennement l’Empire) dès les années 1959-1960, il pense à juste titre pouvoir compter sur le soutien, à l’Assemblée générale et occasionnellement au Conseil de sécurité des Nations unies, de nombreux États récemment indépendants, amis voire alliés de la France. Non pas que De Gaulle, intrinsèquement souverainiste, s’en remette au « machin » que représente pour lui l’ONU, mais la stratégie choisie pour servir l’objectif désigné étant la montée en puissance diplomatique, il doit s’en accommoder a minima. Autre avantage d’un réseau diplomatique étroit et riche entre Paris et ses nombreuses anciennes possessions d’Afrique subsaharienne et du Maghreb : la nécessité pour les régimes présidant à leurs destinées de s’équiper en infrastructures civiles et en armements, et de nourrir leurs populations partout en forte croissance démographique.