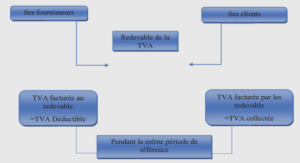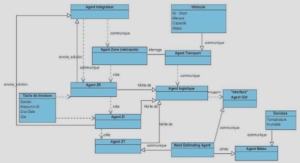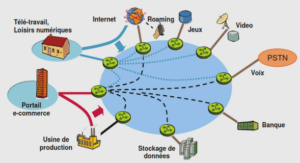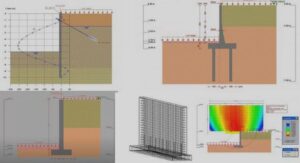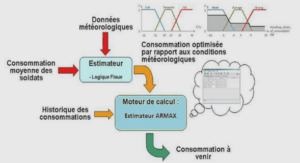Un plan de charge incertain (1975-1977)
Une nouvelle fois, en mars 1975 resurgit la crainte de fermeture des établissements de la Défense nationale639. En dépit des investissements du deuxième plan de modernisation, les ouvriers redoutent une privatisation des arsenaux. Cette inquiétude est renforcée par la chute des effectifs ouvriers à statut. Pour Lorient, en douze ans il est passé de 3 803 à 2 847 (- 33 %). En mai, pour marquer leur opposition à cette politique deux syndicats appellent à la grève. Ils veulent réaffirmer l’« attachement au statut juridique des établissements d’État et au statut des personnels640 ». Ce mouvement se poursuit le mois suivant. Le 6 juin, 2 500 ouvriers défilent dans les rues de la ville pour réclamer la création de postes d’ouvriers à statut641.
La période estivale permet à tous de souffler un peu, avant que ne soit annoncé le plan de charge pour 1975-1976 qui ravive les craintes. Bien que l’activité soit assurée pour deux ans, la CGT déplore que l’emploi soit exclusivement planifié avec les avisos et les patrouilleurs. Les fédérations syndicales regrettent également un plan de charge constamment modifié et l’importance donnée aux commandes pour des marines étrangères. De plus, la construction des corvettes n’est pas assurée et pourrait bien être reportée au prochain plan de 1977-1978, d’autre part, rien n’est réglé pour les mises en construction des chasseurs de mines à Keroman. Les militants CGT de l’arsenal
« réaffirment les possibilités et la nécessité pour les arsenaux de contribuer au plein emploi en accordant la priorité des études et des fabrications d’armements à ces établissements et en développant les fabrications civiles642 ». En effet, pour assurer un plan de charge qui ne soit pas strictement lié à l’export, Lorient pourrait servir à la construction de chalutiers et de petits cargos grâce aux possibilités prochainement offertes par la mise en service du hall de préfabrication. La question des ouvriers temporaires est un autre problème : on en compte 910 et seulement 13 vont être titularisés au premier novembre. Certains d’entre eux travaillent depuis plus de 7 ans à l’arsenal. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse si le travail était fait par les ouvriers d’État au lieu de faire appel à des entreprises privées643.
Aussi pour contraindre le ministre à négocier, les fédérations syndicales CGT et CFDT lancent une semaine d’action du 13 au 17 octobre 1975644.
Sans surprise, à la fin de l’année 1976, resurgissent les inquiétudes d’un plan de charge qui serait exclusivement orienté en direction de commandes extérieures aléatoires. Il conduirait à sous-exploiter les équipements industriels des Constructions neuves en dépit du hall de préfabrication nouvellement installé645. En fait, le vrai problème est la réduction de 6,7 % du budget de la Marine pour 1977. Cette baisse conduit à supprimer les programmes de bâtiments classiques et de porte-aéronefs ou à les reporter de plusieurs années646. Ainsi quasiment tous les programmes en cours sont ralentis et provoquent des retards de mises en service de six mois à un an suivant le type de bâtiment647.
Le début de l’année 1977 n’atténue pas les craintes. Le plan de charge reste au cœur des discussions qui conduisent en février quatre syndicats (CGT, CFDT, FO, et CFTC) à lancer un appel à la grève. 80 % des ouvriers suivent le mouvement. Bien que l’activité semble assurée pour 1977-1978, notamment grâce aux patrouilleurs destinés à l’exportation et aux chasseurs de mines tripartites types Éridan, l’année 1979 est plus incertaine avec même un risque de creux d’activité. Pour garantir une charge suffisante, il faudrait un million d’heures supplémentaires648.
Inquiet de cette situation, le maire de Lorient souhaite obtenir une audience avec le Secrétaire d’État à la Défense Beucler en visite dans la citée le 15 septembre 1977. Il veut discuter du plan de charge de l’arsenal et est soucieux de la fin du programme des avisos A 69. Là encore, en dépit des annonces, le maire s’interroge sur le programme des chasseurs de mines qui n’est toujours pas assuré pour Lorient649. Le secrétaire d’État à la Défense le rassure, garantissant une activité jusqu’en 1978, en plus du programme des avisos qui se poursuit, il annonce officiellement Lorient comme port constructeur des prochains chasseurs de mines tripartites Éridan650. De plus, un projet de navires non conventionnels type naviplane est à l’étude651. Mais en dépit de ces nouvelles, la CGT juge la charge d’activité incertaine, conditionnée par le choix du port d’armement chef de file, à Lorient ou à Brest, de la prochaine corvette anti-sous-marine652.
Une « diversification » de l’activité (1976-1979)
Depuis 1975, une grosse part de l’activité des Constructions neuves concerne le programme des avisos d’Estienne d’Orves A 69 et celui des chasseurs de mines. L’année 1976 commence par quatre mises à flot d’avisos A 69 : le Détroyat et le Jean-Moulin sortent définitivement de forme, le Quartier-Maître Anquetil et le Commandant de Pimodan sont mis à flot provisoirement653. L’activité lorientaise est complétée par les lancements en chantiers de corvettes, de bâtiments océanographiques et hydrographiques, de plusieurs tronçons d’essais pour sous-marins et de quelques éléments de car-ferries.
En outre, pour diversifier ses activités, l’arsenal mène des études de navires non conventionnels qui se concrétisent par la commande de deux naviplanes N 500. Terminée en mars, une première structure résistante de 40 tonnes part de Lorient en direction de la Gironde pour y recevoir ses équipements654. Six mois plus tard, un second naviplane quitte l’arsenal et prend la même direction que son aîné655. L’arsenal travaille également pour l’armée de Terre avec les constructions pour le Génie. Ainsi, en prévision d’une livraison d’ici à deux ans de huit Ponts Automoteurs d’Accompagnement (PAA), des premiers essais avaient été menés sur la rivière le Blavet en août 1976656.
Plusieurs départs, des lancements en constructions et des achèvements à flot, marquent l’année 1977657. Lorient assure la maîtrise d’œuvre industrielle de quatre patrouilleurs Patra et de vingt autres de type S148 destinés à des clients étrangers658. Elle se charge aussi des essais d’armes et d’équipements de dix patrouilleurs du programme Saladin pour la Libye et d’un patrouilleur du Sénégal de type PR72. Elle participe enfin sous maîtrise d’œuvre SFCN-Thomson CSF au programme Tiburon des patrouilleurs rapides destinés au Pérou659.
Son activité de diversification se poursuit avec les engins du Génie militaire. Pour équiper les régiments, l’État-major de l’Armée de Terre veut développer deux prototypes de « Pont Flottant Motorisé » (PFM). Le premier, à la charge de Lorient, est classique avec une travure qui repose sur des flotteurs métalliques660. Le second, réalisé par les Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM), applique le principe de la poutre flottante661. D’autre part, grâce aux compétences acquises avec les constructions de ponts Gillois, Lorient se lance dans la construction de plusieurs Moyens Amphibies de Franchissement (MAF)662. Dans cette série, d’autres types sont étudiés : le MAF1 qui a fait ses essais en 1978, une cellule d’un MAF2 livrée en août, et pour finir le MAF1bis.
Sans être un échec retentissant, les programmes des corvettes ne se déroulent pas comme prévu. Reclassées frégates, les corvettes anti-sous-marine F 67 Tourville sont trop grosses et trop chères. La série est arrêtée après le troisième exemplaire. Le programme de la frégate antiaérienne Cassard connaît un dénouement semblable. Six frégates devaient être construites, avant que le programme ne soit annulé au profit de nouveaux programmes moins coûteux. Ces frégates devaient reprendre la coque des frégates anti-sous-marines F 70 types Georges Leygues. Suite aux études successives, à l’arrivée de nouveaux équipements et à une nouvelle génération de propulsion en 1979 une décision ministérielle limite la série à deux exemplaires seulement663.
En dépit des incertitudes sur le maintien de l’activité de l’arsenal, la période 1978-1979 est plutôt bonne « alors que la charge de l’arsenal était réduite il y a un an, ce qui avait amené une diminution très importante des effectifs des entreprises privées travaillant sur marchés de travaux, la fin de 1978 a vu un relèvement de la charge qui atteindra un niveau global très élevé en 1979 et également en 1980664 ».