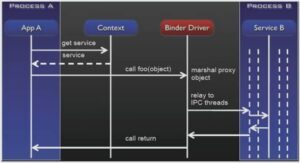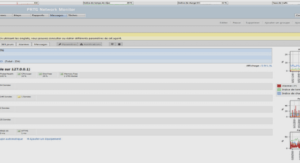APPROCHE PSYCHOPATHOLOGIQUE ET FAMILIALE DE L’ALCOOLO DEPENDANCE
Depuis l’antiquité, la consommation d’alcool est conviviale, associée à des festivités. Cette consommation peut revêtir parfois un caractère sacré et religieux. L’alcool a à la fois, un effet euphorisant, anxiolytique et anxiogène. Il est utilisé dans le but de se sentir mieux, d’être comme les autres, de faire face aux impasses intérieures, en un mot d’être normal : c’est ce qui en fait une substance susceptible de créer une addiction. Aujourd’hui, l’alcool est devenu un des principaux fléaux de la société et les conséquences de sa consommation sont perceptibles aussi bien sur les plans sanitaires, psychologiques, économiques et sociaux. Selon la structure de la personnalité, les antécédents, l’histoire personnelle et familiale, l’alcool peut devenir une drogue dont il est difficile de se détacher : s’installe alors la dépendance. Cette dépendance à l’alcool correspond à la conjugaison de trois facteurs : la personnalité, le produit « alcool » et l’environnement. Les conséquences de cette addiction ne touchent pas que l’alcoolo dépendant .Elles affectent aussi son entourage. L’impact de l’alcoolisme sur l’environnement familial s’observe à deux niveaux : l’alcoolisme d’un individu aura des conséquences sur le fonctionnement de sa famille. Par ailleurs, un environnement familial peut engendrer ou entretenir la pathologie alcoolique d’un membre. Il n’est donc pas surprenant d’observer dans la genèse de l’alcoolisme, la présence de facteurs familiaux, ce qui induit une importance à accorder à l’entourage lors de la prise en charge thérapeutique d’un sujet dépendant à l’alcool. La consommation d’alcool a considérablement augmenté au plan mondial. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé estime à plus de 140 millions le nombre de personnes présentant une dépendance à l’alcool. En outre, cette augmentation touche de plus en plus de jeunes et de femmes et l’on assiste à une redistribution géographique des consommateurs. Celle-ci concerne surtout les pays en voie de développement. (Rapport OMS Mai 2014) Cette augmentation de la consommation d’alcool touche aussi bien les pays du nord que les pays africains. (Rapport OMS Mai 2014) La plupart des écrits sur l’alcool en Afrique se sont intéressés à l’aspect épidémiologique. Les lectures psychopathologiques de l’alcoolisme restent encore rares. Au Sénégal, pays à majorité musulmane, la question de la consommation d’alcool reste encore taboue. Elle est souvent niée, cachée par peur de la réaction sociale. Une consommation, même occasionnelle ou récréative est souvent vécue comme problématique voire pathologique par l’entourage. Les tradipraticiens sont très souvent consultés et ont développé tout un arsenal thérapeutique contre la consommation de l’alcool. Par contre, dans le domaine de la psychiatrie, nous avons noté qu’il y a peu de travaux sur les addictions à l’alcool au Sénégal. Prenant en charge des sujets alcoolo dépendants, nous avons remarqué la grande souffrance qui est souvent vécue par la famille au point que la demande de soins est souvent portée par cette dernière. Cette présence et cette demande familiale nous semblent être utiles pour renforcer le soutien nécessaire à la prise en charge du patient. Nous nous sommes alors fixés comme objectif dans le présent travail d’analyser certains éléments de psychogenèse rencontrés chez nos patients alcoolo dépendants, d’en faire une lecture psychopathologique en relation avec leur vécu psychosocial et de dégager le rôle que la famille pourrait jouer dans la prise en charge. Pour se faire, nous présenterons dans un premier temps une revue de la littérature, qui sera suivie de nos observations et de nos commentaires sur les patients étudiés. Puis une synthèse des trois cas cliniques sera faite avant de clore ce travail. Approche psychopathologique et familiale de l’alcoolo dépendance au Sénégal : Analyse de trois observations cliniques Dr Damo Virgile KONAN
Approche psychopathologique et familiale de l’alcoolo dépendance au Sénégal : Analyse de trois observations cliniques Dr Damo Virgile KONAN
GENERALITES
Le concept « d’alcoolisme » a connu plusieurs définitions en relation avec l’évolution des classifications et des nosographies dont le but était de prendre en compte tous les aspects et les conséquences liés à la consommation de l’alcool. Parmi ces définitions, nous rappellerons celles qui entrent dans le cadre de notre travail.
Définitions Ces définitions peuvent être abordées selon trois approches.
Définitions quantitatives
Selon Guibert (1999), il convient de rappeler la définition de l’OMS qui reste toujours en vigueur et qui introduit une notion de seuil : « pas plus de 4 verres par occasion pour l’usage ponctuel. Pas plus de 21 verres par semaine pour l’usage régulier chez l’homme et 14 verres par semaine pour l’usage régulier chez la femme, sachant qu’un verre correspond à 10 g d’alcool pur ».
Définitions partielles
Les définitions partielles ont l’avantage de décrire différents aspects des conduites alcooliques, mais cependant elles limitent l’alcoolisme à ses expressions négatives et comportementales. Ainsi, Rainault (1954) dans son article intitulé: «L’impossible définition scientifique de l’alcoolisme », mettait en évidence la complexité de l’alcoolisme, par la définition suivante: « Le recours à l’alcool, continu ou discontinu, établissant progressivement sa prévalence sur tous les autres modes de relation du sujet, constitue l’alcoolisme quelle qu’en soit l’étiologie, la pathogénie et les conséquences. » Cette définition relevait aussi le caractère aliénant de la conduite alcoolique.
Définitions globales
Elles sont longues et complexes témoignant ainsi de la difficulté à préciser le terme » alcoolisme « . Davies en 1974 a proposé la définition suivante : «On peut appeler alcoolisme l’ingestion intermittente ou permanente d’alcool conduisant à la dépendance ou susceptible d’être nocive.» Bien que globale, elle met un accent sur deux notions importantes: La première considère que la maladie alcoolique chronique, n’implique pas forcément la consommation quotidienne et permanente de quantités excessives d’alcool mais ayant des conséquences somatiques, psychiques et sociales graves. La deuxième est basée sur deux aspects essentiels des conduites alcooliques que sont : la dépendance et de la nocivité. En 1992, Morse, accompagné d’experts du Conseil national d’alcoolisme des États Unis, proposa une autre définition: « L’alcoolisme est une maladie chronique, primaire, dont des facteurs génétiques, psychosociaux et environnementaux favorisent le développement et les manifestations. Cette maladie est souvent progressive et fatale. Elle se caractérise par une altération du contrôle des consommations d’alcool, une préoccupation par la « drogue alcool », l’usage d’alcool en dépit de ses conséquences négatives des distorsions de la pensée et en particulier le déni. Chacun de ces symptômes peut être permanent ou périodique ».Cette définition met en exergue l’étiologie multifactorielle de l’alcoolisme. De manière consensuelle, L’OMS en 1952 définit les alcooliques comme des buveurs excessifs dont la dépendance à l’égard de l’alcool est telle qu’ils présentent soit un trouble mental décelable, soit des manifestations affectant leur santé physique et mentale, leurs relations avec autrui et leur comportement social et économique, soit des prodromes de troubles de ce genre. 2. Nosographie de l’alcoolisme La nosographie de l’alcoolisme est actuellement abordée à travers un modèle bidimensionnel (DSM-IV, CIM-10), clinique comportemental, distinguant l’abus (DSM-IV 1996) ou l’usage nocif (CIM-10 1993) et la dépendance (DSM-IV et CIM-10).
L’abus d’alcool (DSM-IV), ou utilisation nocive pour la santé (CIM-10)
Selon DSM-IV, l’abus d’alcool est strictement réduit à ses conséquences nocives et à la persistance de cette consommation malgré la connaissance de cette nocivité. Il est donc caractérisé par ses conséquences observables. Celles-ci correspondent à une utilisation répétée de l’alcool dans des situations où l’usage est particulièrement risqué. Pour la CIM-10, l’utilisation nocive d’alcool correspond à une période pendant laquelle le sujet a des dommages sanitaires et sociaux liés à sa consommation. Ces dommages peuvent être physiques et psychiques. Cependant, il n’est pas dépendant. L’usage nocif autant pour la CIM-10 que pour le DSM-IV peuvent évoluer vers la dépendance. Cependant ce caractère évolutif n’est pas inéluctable.
La dépendance
En 1970, un groupe d’experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a suggéré de remplacer le terme alcoolisme jugé stigmatisant, par celui de syndrome de » dépendance alcoolique « . Il se caractérise principalement par l’existence de phénomènes d’addiction et d’habituation ainsi que par une » compulsion » vis-à-vis de l’alcool. Selon le DMS-IV, la dépendance est un mode d’utilisation inadaptée d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance, cliniquement significative, caractérisée par la présence de trois (ou plus) des critères, à un moment quelconque d’une période continue de 12 mois. Ces critères d’alcoolo-dépendance, retenus par la CIM-10 et le DSM-IV, reprennent l’essentiel de ceux d’Edwards (1992). La combinaison des critères de dépendance des deux systèmes (CIM-10 – DSM-IV) permet d’établir une liste de 11 items (dont six communs aux deux nosographies). Ces items définissent les principales caractéristiques cliniques des conduites d’alcoolo-dépendance. Ainsi, la dépendance alcoolique est un état physiologique de neuro-adaptation produit par la prise répétée d’alcool avec nécessité de la poursuivre pour prévenir l’apparition d’un syndrome de sevrage (développement d’un ensemble de signes spécifiques, dû à l’arrêt ou à la réduction de l’utilisation prolongée et massive). Elle se traduit par l’apparition d’une tolérance (besoin d’augmenter les quantités pour obtenir les mêmes effets), des signes de sevrage à l’arrêt de la consommation, consommation parfois compulsive. Le « craving » des anglosaxons ou besoin irrépréhensible de boire est au cœur de ces conduites. Pour le DSM-IV, l’absence de dépendance physiologique n’exclut pas le diagnostic de dépendance. 3. Classifications Plusieurs classifications ont permis d’aboutir à des groupes homogènes de patients alcooliques. Nous aborderons les plus pertinents que sont :
Classification de Fouquet (1955)
Elle différencie trois grandes formes d’alcoolisme : Les alcoolites, alcoolisme d’entraînement, d’habitude essentiellement masculin avec une consommation rapidement croissante et quotidienne, sans culpabilité ressentie avec risque de dépendance. Les alcooloses ou alcoolismes névrotiques, à début tardif, plus fréquent chez la femme et impliquant des consommations d’alcool de manière discontinue, solitaire, culpabilisée et importante. Elles sont essentiellement déterminées par des facteurs psychonévrotiques sous-jacents. Les somalcooloses, alcoolismes intermittents et compulsifs de type dipsomaniaque de Magnan correspondant à l’alcoolisme epsilon de Jennilek. L’existence de troubles graves de la personnalité est fréquente.
Classification de Cloninger (1988)
Cloninger, quant à lui a tenu compte de données d’ordre familial, génétique, épidémiologique, psychopathologique et évolutif ; définissant ainsi deux sous-types d’alcoolisme. Le » type I » ou alcoolisme de milieu » Le » type II » correspond à une forme d’alcoolisme dite » exclusivement masculine « .
Classifications d’Adès et de Lejoyeux (1996)
Elles s’inspirent des éléments de typologies primaire et secondaire de Cloninger et de Babor. L’alcoolisme de type primaire correspond au type II de Cloninger et au groupe B de Babor et concerne 70 % des usages avec dépendance. La recherche de sensations fortes est présente. L’alcoolisme de type secondaire renvoie au type I de Cloninger et au type A de Babor. L’alcool est utilisé comme automédication d’un trouble psychiatrique persistant après le sevrage. Son apport est régulier ou intermittent. L’évolution vers la dépendance est plus lente.
INTRODUCTION |