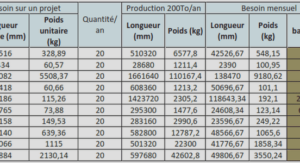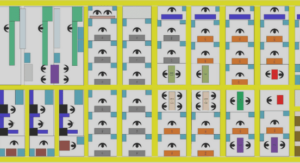MESURE DE LA DENITRIFICATION EN PARCELLE DRAINEE
Des mesures ponctuelles de la dénitrification réelle et potentielle ont été réalisées sur la parcelle drainée de référence. Ces mesures ont été faites en laboratoire en utilisant la méthode du blocage à l’acétylène. En complément de l’outil isotpique qui perment de caractériser le processus de dénitrification, l’objectif de ces mesures est de quantifier le processus dans les sols drainés.
Mesure de la dénitrification réelle
Le principe de la mesure de la dénitrification est basé sur l’inhibition exercée par l’acétylène sur la réduction du N2O en N2 (Balderstone et al., 1976; Yoshinari et Knowles, 1976). En présence de C2H2, le N2O devient le produit final de la dénitrification. Or, ce gaz est facilement quantifiable compte tenu de sa faible teneur atmosphérique dans l’air et de la sensibilité des détecteurs (chromatographes en phase gazeuse, détection par capture d’électrons). Ceci fait de cette méthode l’une des plus sensibles pour la mesure de la dénitrification (Duxbury et al., 1986). et la plus couramment utilisée.
Deux méthodes différentes sont réalisées avec des carottes de sol. La première consiste en une recirculation des gaz dans la carotte de sol, considérant qu’un courant facilite la distribution de l’acétylène et du N2O (Parkin et al., 1984; Tiedje et al., 1989; Figure 2-15).
Figure 2-15 : Boucle de recirculation de l’expérience réalisée par Tiedje et al. (1989)
Cette méthode permet une mesure en continu du flux de N2O. Cependant, elle nécessite un matériel cher et complexe, et ne permet pas d’analyser beaucoup d’échantillons.
Une deuxième est dite statique. Les carottes de sol sont simplement placées dans une Boîte d’incubation hermétique sans recirculation (Burton et Beauchamp, 1984; Ryden et al., 1987; Tiedje et al., 1989). Cette méthode, plus simple, permet la mesure simultanée d’un grand nombre d’échantillons, ce qui est un grand avantage compte tenu de la grande variabilité de la dénitrification.
Compte tenu de nos moyens matériels, la méthode du blocage à l’acétylène de type statique a été choisie. L’expérience se réalise sur des échantillons composés, ici correspondant à 4 carottes de sol dans une boîte hermétique, munie d’un septum pour permettre le prélèvement de gaz.
CemOA : archive ouverte d’Irstea / Cemagref
L’expérience a été réalisée sur 4 sites du bassin versant de Goins (1 en haut de la parcelle de référence, 1 au milieu de la parcelle, 1 en bas de la parcelle, 1 dans la forêt), et sur deux horizons de 25 cm d’épaisseur (Figure 2-17). Trois campagnes de prélèvements ont été éffectuées : le 28/02/07 ; le 27/03/07 et le 03/05/07.
On incube alors les échantillons de sol, avec, pour un horizon d’un site, une boîte avec acétylène et une sans (témoin), dans une chambre froide à température du sol. La boîte « témoin » permet d’évaluer indirectement la production de N2, par la différence de production de N2O entre les boîtes avec acétylène et celles sans.
Figure 2-17 : Situation des points de prélèvement de sol sur la photo aérienne du sous bassin de Goins (limites en jaune)
Mesure de la dénitrification potentielle
Elle détermine le taux maximal de dénitrification qui peut avoir lieu dans le sol, sans développement biologique (Figure 2-18).
Pour cela, un échantillon de 25 gr de sol (poids sec), préalablement homogénéisé (mélange de terre provenant de tous les points de prélèvement de l’horizon du site), est placé en conditions optimales, par un ajout d’eau distillée, de KNO3 et de glucose, en concentration finale 50 µg de N-NO3- par g de sol sec, soit 9,027 mg de KNO3 par échantillon, et de 300 µg de C-glucose par g de sol sec, soit 7,5 mg par échantillon (Luo et al., 1996).
Afin de se placer en condition anaérobie, des flush à l’hélium sont réalisés pour faire le vide dans la bouteille et d’obtenir une atmosphère d’hélium contenant peu d’O2 (inférieur à 0,1% si possible).
CemOA : archive ouverte d’Irstea / Cemagref
MODELISATION A DIFFERENTES ECHELLES SPATIALES
Comme indiqué dans le chapitre 1, l’ensemble des observations réalisées sur la dynamique de l’azote dans notre site expérimental a été synthétisé par le recours à la modélisation, tant à l’échelle de la parcelle (DRAINMOD-N II), qu’à l’échelle des sous-bassins versants (SENEQUE).
La modélisation a pour objectif de valider les schémas conceptuels ou de compréhension des processus.
Le modèle DRAINMOD-N II
L’utilisation du modèle Drainmod-N a pour but de quantifier les processus de transfert d’eau et d’azote dans les sols drainés en fonction des conditions climatiques, des propriétés physiques du milieu et des caractéristiques du réseau de drainage, avec une résolution temporelle fine permettant d’appréhender leur variabilité.
Le modèle hydrologique DRAINMOD a été développé par R. Wayne Skaggs à la North Carolina State University (Skaggs, 1980). Le modèle simule l’hydrologie à la parcelle des sols artificiellement drainés à nappe peu profonde, à pas de temps horaire ou journalier sur des longues chroniques climatiques (e.g. 50 années). Le modèle calcule l’effet du drainage et des pratiques associées, sur les hauteurs de nappe, les débits et les rendements des cultures.
DRAINMOD a été testé pour un grand nombre de conditions et de pays dans le monde, comme le montrent les dizaines de publications écrites à partir de ce modèle (http://www.bae.ncsu.edu/soil_water/drainmod/index.html). Depuis le début des années 1990, de nouveaux modules ont été ajoutés à DRAINMOD pour simuler l’impact du drainage sur la qualité de l’eau, pour les zones de cultures mais aussi les zones forestières.
La dernière version du modèle disponible et utilisée ici permet de simuler les pertes azotées dues au drainage, mais aussi les problèmes de salinité des sols.
Module hydrologique
Les processus hydrologiques simulés sont les suivants : précipitations, drainage, infiltration, évapotranspiration, ruissellement, stockage d’eau à la surface du sol et en zone non saturée. Le modèle calcule un bilan de l’espace poral dans le sol à chaque pas de temps :
CemOA : archive ouverte d’Irstea / Cemagref
ΔV =D+ET +DS−F (11)
où ΔV représente la variation du volume d’air du sol, D le volume d’eau évacué par le drainage, ET le volume d’eau évacuée par l’évapotranspiration, DS la drainance et F l’infiltration.