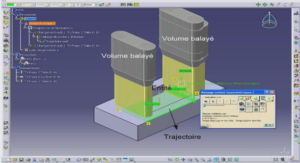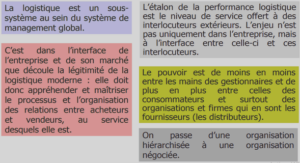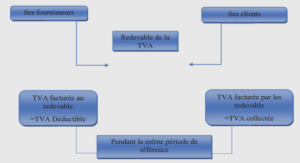APPORTS DES ESPECES PIONNIERES ET DES PROPRIETES DU SOL A LA REGENERATION FORESTIERE
Discussion partielle
Utilisation des terres et durée de jachère La durée de la jachère n’est pas prédéterminée mais dépend plutôt de la structure de la végétation (Some & Alexandre, 1997), des anciennes pratiques de culture, et de la disponibilité des terres. En outre, selon les besoins domestiques, les parcelles abandonnées sont remplacées par de nouvelles parcelles cultivées. De plus, l’insuffisance des productions conduit la population locale à chercher d’autres parcelles à cultiver. La principale question est : quelle parcelle sera déforestée et brûlée, ou labourée pour la nouvelle culture? Ce processus de sélection d’une nouvelle parcelle dépend également de la topographie et de l’éloignement ; et la sélection des plantes à cultiver dépend de la pente et de l’exposition des parcelles. Afin de permettre aux sols de retrouver leur fertilité, et aussi parce que les mauvaises herbes deviennent un fléau après quelques années de culture, les agriculteurs choisissent généralement de courtes périodes de jachère, environ 3 ans. Pour commencer de nouveaux cycles de culture dans les parcelles abandonnées, les agriculteurs évaluent la fertilité en observant la physionomie de la végétation et la présence d’espèces indicatrices (comme l’espèce d’Acanthaceae, A. angustifolium). En règle générale, une forte densité d’espèces ligneuses dans la jachère est considérée comme un bon indicateur pour la récupération de la fertilité des sols. Au contraire, la présence d’espèces telles que Pteridium aquilinum ou Erica floribunda indique une faible fertilité des sols ; ce qui conduit souvent à l’abandon de ces parcelles. Styger et al. (2007) ont trouvé, dans les forêts de l’Est de Madagascar que la perte de fertilité apparait après seulement trois cycles de culture ; ce qui est indiqué par le développement des espèces herbacées et des fougères dans les jachères. Il a donc été recommandé une durée de jachère de cinq ans après trois cycles de culture. Après plus de six cycles de culture-jachère, le recouvrement de la fertilité des sols prendrait 20 ans au moins. Cette étape de dégradation a pu être identifiée par le développement d’espèces de graminées telles qu’Aristida spp. Néanmoins, l’évolution de cette formation graminéenne vers une forêt secondaire ne pourra pas être bloquée. (Styger et al., 2007 ; Hervé et al., 2009 ; Randriamalala et al., 2012).
Influence de l’historique des parcelles sur la régénération forestière
Dynamique de la fertilité chimique du sol
Les pratiques agricoles ont montré une forte relation avec la durée de l’abandon, mais leur impact sur les indices de fertilité et les caractéristiques physico-chimiques des sols étudiés, est plus contrasté. Les sols ferralitiques dans les sites d’étude sont tous très acides, et il apparait qu’une forte relation positive existe entre le pH et la durée de l’exploitation. Il est normal qu’une durée d’exploitation longue des parcelles acidifie le sol due à la lixiviation et la perte de matières organiques venant de la phytomasse (Brams, 1971 ; Juo & Lal, 1977). Les parcelles avec des pH généralement plus élevés pourraient coïncider avec des indices de fértilité élevés permettant ainsi une plus grande période d’exploitation. Dans la zone d’étude, le pH du sol reste à peu près comparable et il ne semble pas y avoir une reprise du pH après abandon. Ceci est démontré par les résultats de la RDA où le pH est lié orthogonalement à l’âge d’abandon. L’aluminium échangeable semble être inversement lié à l’augmentation du pH et au nombre de cycles de culture. Cette relation avec le pH est prouvée (Foy, 1984 ; Delhaize, 1995), et sert également à démontrer un effet indirect possible sur la capacité d’une parcelle à poursuivre l’exploitation de longue durée. Cela est particulièrement le cas étant donné que la plupart des valeurs de pH observées sont autour de 4,5 où l’aluminium existe sous une forme Al3+ très mobile et toxique. Cela peut expliquer la forte corrélation négative entre aluminium échangeable et la durée de l’exploitation. Les indices de la fertilité des sols sont étroitement liés à des mesures de gestion, en particulier dans le cas du phosphore assimilable, qui semble être inversement proportionnel à la durée de l’exploitation. La possibilité pour les sols ferralitiques de fournir une réserve de phosphore assimilable est principalement déterminée par le phosphore organique, étant donné que la majorité du phosphore inorganique est lessivée ou liée avec des sesquioxydes, tels que le fer ou l’aluminium, qui dominent dans les horizons de surface. Une durée d’exploitation longue est la cause de l’épuisement rapide du phosphore dans le sol, qui est la cause la plus probable pour l’abandon. Cependant, il est également clair que la réserve en phosphore n’est pas immédiatement réapprovisionnée après l’abandon ; ce qui indique que le phosphore reste lié aux métaux dans le sol, ou est stocké dans la phytomasse (Buschbacher et al., 1988) plutôt que dans les matières organiques. L’azote du sol est lié à des mesures de gestion, et semble diminuer au fil du temps après l’abandon. Cela indique tout d’abord que, l’azote du sol n’est pas un facteur probable dans la détermination de la cessation de l’exploitation, mais aussi que l’abandon conduit à un appauvrissement du sol en azote. La réduction de l’azote dans le sol se reflète dans le rapport C/N qui malgré le peu de changement dans le carbone total du sol, augmente avec l’abandon, montrant une absorption nette d’azote. Dans l’ensemble, les données sur la fertilité chimique montrent qu’une diminution de phosphore en dessous d’un point critique est le facteur dominant conduisant à l’abandon dans un système déjà caractérisé par une limitation intrinsèque des éléments nutritifs. La période de récupération peut varier sensiblement, mais il ressort des différentes études (Styger et al., 2007 ; Raharimalala et al., 2010) que des périodes de plusieurs années sont nécessaires, et à Madagascar en particulier, des périodes de plus de dix ans sont susceptibles d’être un minimum raisonnable pour obtenir une récupération de la fertilité des sols suffisante pour permettre une exploitation plus poussée.
Dynamique de la végétation secondaire
Une fois que les surfaces cultivées sont abandonnées, principalement des herbacées et des arbustes commencent à se développer. La co-dominance des graminées et des fougères reflète l’intensité de l’ancien usage. La RDA montre que le nombre de cycles de culture et de la durée d’exploitation sont corrélés négativement avec la richesse spécifique et l’âge d’abandon. En effet, plusieurs cycles impliquent de nombreux brûlis, et plus de travail du sol (dans le cas de la végétation herbacée), diminuant ainsi la banque de semences du sol et le potentiel de germination des espèces ligneuses (Guariguata & Ostertag, 2001; Randriamalala et al., 2012). A Madagascar, plusieurs études ont décrit la végétation post-culturale dans les deux régions (Est et Ouest), et trois étapes de régénération sont généralement reconnues (Rasolofoharinoro, 1997 ; Grouzis et al., 2000 ; Carrière et al., 2005). La persistance des espèces herbacées est principalement liée à l’ancienne utilisation des terres. L’apparition des arbustes et des arbres indique le retour à un certain niveau de fertilité du sol. Avec un seul ou quelques cycles de culture, Raharimalala et al. (2010) ont trouvé dans la forêt sèche du sudouest de Madagascar que 10 ans d’abandon sont nécessaires pour l’apparition des espèces ligneuses, et après 21-30 ans des plantes herbacées deviennent moins importantes, de telle sorte que la richesse spécifique des herbacées diminue considérablement et qu’elles disparaissent même après 40 ans.
Conclusion partielle
L’utilisation antérieure des terres a un effet durable sur le dévéloppement de la végétation et même plus sur la fertilité du sol. L’âge d’abandon attenue les effets de l’utilisation des terres sur le développement des plantes et sur la richesse floristique. En effet, la richesse floristique évolue au cours de la succession forestière. L’intensité de l’utilisation passée des parcelles réduit la richesse floristique ; ce qui vérifie la première hypothèse. Toutefois, la richesse floristique peut augmenter au cours de la succession forestière avec le retour progressif de la fertilité du sol. Le phosphore est l’élément minéral majeur naturel dans ces sols, mais qui semble être exacerbé par la durée de l’exploitation vérifiant la deuxième hypothèse émise. La capacité des sols à récupérer le phosphore ne semble pas être liée à l’abandon, ce qui suggère que de plus longues périodes de temps sont nécessaires, ou que la végétation secondaire déplace cette réserve de nutriments dans la phytomasse. Le carbone est accumulé à l’abandon, mais lentement, et en raison de l’absorption d’azote, probablement par la phytomasse, les réserves en éléments nutritifs du sol restent faibles. Les résultats soulignent l’utilité d’un système de gestion qui permettrait de maintenir les arbres et les taches éparses d’herbacées, car cela pourrait être la clé de la promotion de la biodiversité et de la restauration des sols. L’optimisation de la culture sur abattis-brûlis pourrait être obtenue en utilisant le pâturage contrôlé sur des surfaces de rotation, alternant avec des parcelles de forêt où le sol peut récupérer sa fertilité sur une durée plus longue.
Introduction générale |