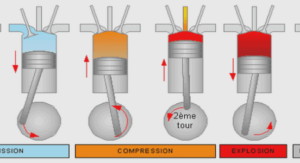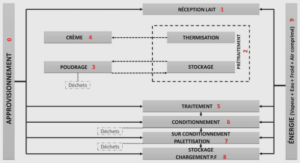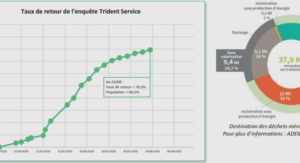L’économie et la Bourse : un couple très instable
A priori, on pourrait penser que les choses sont simples. Puisque les actions représentent une part du capital des entreprises, elles devraient aller bien quand l’économie est prospère et reculer quand celle-ci va moins bien. En fait, les choses sont un peu plus compliquées que cela.
Le produit intérieur brut n’explique pas tout
Si l’on voulait copier le lieu commun « L’argent ne fait pas le bonheur », on pourrait dire « Le PIB ne fait pas le bonheur ». Le PIB (produit intérieur brut) mesure les richesses créées dans un pays, autrement dit la somme des valeurs ajoutées par les différents acteurs économiques. Vous achetez du minerai, vous le transformez en fer : ce travail représente votre valeur ajoutée. Vous transformez ce fer en poutrelle ou en rail, vous avez encore produit de la valeur ajoutée. Et la somme des valeurs ajoutées par chacun fait le produit intérieur brut (pour simplifier). Tout le monde s’accorde à penser aujourd’hui qu’une forte croissance du PIB ne suffit pas à faire le bonheur des peuples, mais, toujours selon la sagesse populaire, ça aide.
Une économie dynamique, c’est bon signe, et l’entreprise étant par excellence l’endroit où se crée la valeur ajoutée, les actions devraient monter lorsque le PIB croît.
L’évolution de la Bourse précède celle du PIB
La fin des années 1990, par exemple, a été une période de forte croissance et, en dépit de plusieurs crises qui ont secoué les marchés (crise asiatique de 1997, crise russe et affaire LTCM en 1998), cela a été une période très faste sur le plan boursier. Les chiffres sont éloquents. Prenons la progression de l’indice CAC 40 : 23,7 % en 1996, 29,5 % en 1997, 31,5 % en 1998 et enfin 51,1 % en 1999.
La forte accélération de cette dernière année attire d’ailleurs l’attention. Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste pour voir que cela faisait beaucoup et que, même si l’économie allait bien, cet enrichissement des actionnaires était trop rapide et ne pouvait pas durer à ce rythme. En 2000, la croissance du PIB s’est élevée à 3,8 % en France (un chiffre que l’on ne retrouve pas souvent !), mais l’indice CAC 40 a reculé de 0,5 %. Sur les marchés, on commençait à se dire qu’on avait sans doute exagéré : on avait fait monter les actions parce qu’on croyait être entré dans un cycle long de croissance de l’activité et des bénéfices des entreprises, mais, en fin de compte, tout cela pouvait s’arrêter très prochainement. De fait, en 2001, les États-Unis ont connu une brève période de récession, entre le printemps et l’automne, et la croissance a commencé à ralentir dans tous les grands pays industriels. En amorçant son repli dès 2000, le marché boursier avait précédé l’économie réelle, il avait anticipé son évolution.
Autrement dit, il y a bien un lien entre la croissance économique et la hausse des actions, ce qui est normal, mais les deux phénomènes ne sont pas forcément concomitants ; ils apparaissent souvent avec un certain décalage dans le temps.
La Bourse peut même ignorer le PIB
De façon plus surprenante, il y a des périodes où la Bourse et l’économie peuvent apparaître complètement dissociées. Si l’on regarde les performances des actions françaises dans les années 1960 et le début des années 1970, c’est-à-dire la fin des trente glorieuses, période de croissance rapide qui fait figure de paradis aujourd’hui, on constate que la Bourse n’a pas fait de miracle. Après des taux de croissance du PIB de 5 % à 6 % au début des années 1960 et des menaces de tension sur les prix, le gouvernement avait annoncé un plan de stabilisation en 1963. Ajoutons à cela la détérioration de la balance commerciale et celle du budget de l’État, puis les événements de 1968, les difficultés du franc face au mark, le contrôle des changes et des mouvements de capitaux, on avait là un univers certes très tonique sur le plan économique, mais assez compliqué sur le plan financier et assez peu profitable pour les entreprises, avec des hausses de salaires marquées et des gains de productivité moins rapides. Ainsi, de 1963 à 1967, on a eu cinq années consécutives de baisse de la Bourse, avec des hausses du PIB qui atteignaient 5,2 % en 1964, 3,5 % en 1965 (en pleine période de freinage !) et 5 % encore en 1966.
Oui à la croissance… des profits
Toute la question est en effet de savoir ce qui se passe à l’intérieur des entreprises. Même avec une activité tout à fait satisfaisante, celles-ci peuvent ne pas se trouver dans des situations de très grande prospérité si elles doivent augmenter les salaires à un rythme qui dépasse les gains de productivité ou si, en raison de la concurrence ou de contrôles administratifs, elles ne peuvent répercuter sur leurs prix de vente la hausse de leurs coûts de production.
Sur ce point, on constate qu’il y a des cycles, autrefois surtout dépendants des politiques nationales, aujourd’hui davantage liés aux grandes tendances de l’économie mondiale. Ainsi, dans les années 1970 et au début des années 1980, notamment en France, on a favorisé la hausse des salaires pour préserver le pouvoir d’achat des ménages face à la hausse du prix des produits pétroliers. Cela s’est fait au détriment des marges des entreprises et les marchés boursiers n’ont pas apprécié. À partir du milieu des années 1980, au contraire, on est entré dans une grande vague de désinflation, avec des rémunérations d’autant mieux contrôlées que la vigueur de la concurrence internationale a fait repartir le balancier dans un sens beaucoup moins favorable aux salariés. Il n’est pas étonnant que, au cours de cette période, les années fastes pour la Bourse aient été plus nombreuses.
Deux indicateurs permettent de suivre ces évolutions et de voir si, globalement, on est plutôt dans une phase favorable aux entreprises. L’un mesure le partage de la valeur ajoutée après impôts entre les salariés et l’entreprise, en pourcentage du PIB. L’autre concerne le taux de marge des entreprises, c’est- à-dire le rapport entre l’excédent brut d’exploitation et la valeur ajoutée. Ces deux indicateurs sont publiés chaque trimestre par l’Insee avec les chiffres détaillés du produit intérieur brut.
Attention toutefois : ces chiffres sont intéressants, mais ils appartiennent à la macroéconomie ; ils permettent de comprendre ce qui se passe au niveau du pays, ils n’expliquent pas ce qui se passe au niveau des entreprises considérées individuellement. Par exemple, entre 2003 et 2007, on a vu
les résultats des entreprises du CAC 40 enregistrer des performances extraordinaires, alors que les grands indicateurs calculés par l’Insee (marge des entreprises, taux d’autofinancement, etc.) n’étaient pas très brillants.
Explication : les grandes entreprises, notamment celles qui appartiennent au CAC 40, réalisent maintenant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires hors de l’Hexagone. Leurs bénéfices sont réalisés pour l’essentiel à l’étranger et ne peuvent être estimés à partir des seules statistiques nationales ; pour la Bourse, la conjoncture doit être vue à l’échelle mondiale.
Les licenciements boursiers, réalité ou fantasme ?
Ce n’est pas la peine de nier l’évidence. Il faut voir la réalité en face : entre le capital et le travail, ce n’est pas toujours la lune de miel ! L’histoire économique le montre : il y a des périodes où le partage de la valeur ajoutée par les entreprises se fait plus au profit des salariés que des actionnaires, et inversement. Même si le capitalisme n’est pas « sauvage » partout et si le dialogue social est une réalité dans de nombreux pays, fondamentalement, les rapports de force jouent un rôle déterminant. Si le chômage est élevé, si la concurrence est rude, les salariés ne sont pas en situation de négocier. Néanmoins, l’opposition n’est pas seu-lement entre salaires et profits. Elle peut aussi exister entre la direction de l’entreprise et les actionnaires, sur l’utilisation des profits : dans quelle proportion doivent-ils être distribués aux actionnaires ou réinvestis dans l’entreprise ? Cette bataille aussi peut être féroce !
Il est clair que mieux l’entreprise maîtrise ses coûts salariaux, plus les actionnaires peuvent espérer voir leur dividende augmenter. Il n’est donc pas surprenant que l’annonce de plans sociaux soit souvent bien accueillie par la Bourse. Faut-il pour autant parler de « licencie-ments boursiers » ? La réponse n’est pas aussi évidente qu’il y paraît. Il est choquant qu’une entreprise licencie alors qu’elle annonce des bénéfices élevés, voire en hausse. Mais faut-il attendre qu’elle voie ses bénéfices chuter ou disparaître pour prendre les mesures de réduc-tion des coûts qui lui permettraient de résister à la concurrence ? Il est à craindre que, dans ce cas, les mesures prises soient encore plus douloureuses. Bref, il peut y avoir matière à discussion.
L’observation attentive de la Bourse montre en tout cas une chose : si l’action d’une société baisse, les dirigeants ne doivent pas s’imaginer qu’ils la feront remonter à coup sûr en annon-çant des licenciements. Si l’entreprise a une stratégie claire, si, pour employer le langage des marchés, elle offre une bonne « visibilité », une telle annonce pourra avoir un effet positif sur le cours. Mais si les actionnaires ne comprennent pas la stratégie des dirigeants, s’ils ne voient pas où va l’entreprise, alors ces licenciements ne seront considérés que comme un aveu d’échec et la manœuvre manquera son but.
La grande peur de l’inflation… ou de la déflation
La croissance n’est pas la seule variable à surveiller. Les actionnaires ont une grande peur, commune à tous les épargnants : l’inflation. Entendons-nous bien : quand on parle ici d’inflation, il s’agit de la vraie, pas de la hausse des prix qui s’arrête au prix de l’essence à la pompe ou au prix des légumes frais. Celle- ci pèse évidemment sur le pouvoir d’achat, mais les véritables problèmes commencent quand la hausse des prix gagne l’ensemble des produits et des services et qu’elle s’installe dans la durée. Dans un premier temps, les phases d’inflation ne sont pas défavorables à l’économie. Si l’on a la certitude que ce qu’on a envie d’acheter vaudra plus cher demain, alors il vaut mieux l’acheter aujourd’hui. Et comme tout le monde raisonne ainsi, le commerce marche bien, la production augmente, etc. Mais, on le sait, tout cela se termine généralement assez mal. Et même durant la phase de douce euphorie où tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, les actionnaires peuvent commencer à se faire du souci. Car, dans la course à la hausse des prix, les entreprises ne sortent pas toujours gagnantes. Le prix des biens intermédiaires qu’elles utilisent, les salaires, tout augmente souvent plus vite que leurs propres prix, et les marges s’en ressentent. Résultat : la hausse des prix appauvrit l’actionnaire. Dans les périodes d’inflation, seul s’enrichit celui qui emprunte pour investir, car les remboursements seront faciles.
Que faut-il alors à l’actionnaire ? Une inflation modérée, qui met de l’huile dans les rouages et permet une croissance soutenue de l’activité, sans emballement ni ralentissement brutal. Malheureusement, cela ne dure jamais très longtemps. L’actionnaire est condamné à vivre avec la crainte perpétuelle d’une accélération de l’inflation ou d’un fort ralentissement de l’activité. La navigation entre ces deux écueils détermine les variations au jour le jour.
La déflation est, en apparence, le contraire de l’inflation : les prix ont alors une tendance générale à baisser et, dans ce cas, le consommateur est incité à repousser ses achats, ce qui freine l’activité. A priori, on pourrait penser que c’est une bonne nouvelle pour l’épargnant. C’est exact, mais à une condition : que l’épargne soit sous la forme la plus liquide possible, en billets de banque, sur un compte à vue ou alors en obligations. Pour tous les autres actifs, c’est une période de repli : on l’a vu au Japon dans les années 1990 et encore au début des années 2000. En période de déflation, la valeur des biens immobiliers recule et la Bourse baisse.
Heureusement, la déflation n’est pas le phénomène économique le plus courant. De même, les phases d’hyperinflation sont devenues rares dans les pays connaissant une relative stabilité politique dans un cadre démocratique. Mais les deux périls restent toujours présents dans les esprits et, si jamais les actionnaires venaient à les oublier, les banquiers centraux seraient là pour les ramener à la réalité. Car ce sont eux qui manient l’arme absolue : les taux d’intérêt.
La boussole des marchés : les taux d’intérêt
Si vous êtes réellement débutant en Bourse, faites un test : écoutez plusieurs jours durant les bulletins d’information consacrés à la Bourse. Non seulement vous entendrez des commentaires sur les derniers chiffres de croissance ou d’inflation, mais vous serez à coup sûr mis au courant de ce qui se prépare à la Réserve fédérale des États-Unis ou à la Banque centrale européenne, les deux banques centrales qui comptent aujourd’hui le plus dans le monde.
Politique monétaire et taux à court terme
Les missions d’une banque centrale sont nombreuses et importantes : tout ce qui touche à la monnaie fiduciaire (les billets de banque) ou scripturale (sur les comptes bancaires) et au crédit est sous sa surveillance. Mais, du point de vue de l’actionnaire, sa fonction principale est de fixer les taux directeurs, c’est-à-dire les taux qu’elle pratique ou qu’elle cherche à obtenir par ses interventions sur le marché monétaire. Ainsi, c’est elle qui détermine le niveau des taux d’intérêt à court terme dans sa zone d’influence.
Les taux à court terme sont déterminants pour l’évolution de l’économie. Si la banque centrale ne redoute pas trop l’inflation, elle va les pousser à la baisse. Si les financiers estiment qu’elle a raison, c’est toute la gamme des taux d’intérêt, du court terme au long terme, qui va être orientée vers le plancher. Et, sauf cas exceptionnels (comme celui du Japon en déflation), des taux d’intérêt bas constituent un formidable stimulant pour l’économie. Si le crédit est peu cher et abondant, les particuliers vont pouvoir s’endetter pour acheter une maison, une voiture ou divers biens de consommation, les entreprises vont procéder à de nouveaux investissements et les marchés boursiers vont être bien orientés. C’est ce que l’on observe au début de chaque phase de reprise, comme en 2003 et 2004. Puis, progressivement, la croissance de l’activité et le rythme de hausse des prix accélérant, la banque centrale commence à resserrer sa politique monétaire, autrement dit à relever ses taux directeurs, et on sent l’inquiétude monter à la Bourse. Quand la banque centrale estime que sa politique est assez restrictive, elle arrête de relever ses taux, elle attend, elle observe, et si, effectivement, les risques de surchauffe sont écartés, elle recommence à baisser ses taux et, progressivement, la Bourse reprend confiance.
Politique budgétaire et taux à long terme
En l’occurrence, le terme « confiance » est fondamental. Si la banque centrale est crédible, si les investisseurs estiment que sa politique monétaire est de nature à maîtriser les risques d’inflation, alors les taux à moyen et à long terme restent contenus ; si ce n’est pas le cas, malgré des taux à court terme bas, les taux à long terme se tendent.
D’autres acteurs économiques jouent aussi un rôle non négligeable : c’est notamment le cas des États. Si un gouvernement baisse beaucoup les impôts en gardant des dépenses élevées (ce qu’avait fait le président Reagan aux États -Unis dans les années 1980) ou s’il augmente beaucoup ses dépenses sans que les recettes suivent (ce que fit la gauche française en 1981), le déficit du budget augmente. Pour le financer, l’État doit émettre des emprunts. Plus il en émet, plus il risque d’avoir du mal à trouver des investisseurs prêts à acheter ses titres et plus il est obligé d’offrir une rémunération élevée pour réussir à les placer. Des déficits budgétaires élevés vont souvent de pair avec des taux à long terme élevés, la crise grecque est venue nous le rappeler fin 2009 et dans les années suivantes. Comme toutes les règles, celle-ci comporte évidemment des exceptions ou des limites : par exemple, si une monnaie est très appréciée à l’étranger, le gouvernement peut se permettre quelques écarts, au moins pendant quelque temps, il trouvera des investisseurs intéressés par ses titres sans avoir à payer des intérêts trop élevés. En fait, plus on est puissant, plus on peut se permettre de fantaisies…
Un concentré d’informations : la courbe des taux
Une chose est sûre : les actionnaires n’aiment pas les taux d’intérêt élevés. Si les taux courts montent, c’est mauvais signe, parce que cela veut dire que la banque centrale va pratiquer une politique plus restrictive et que l’activité économique va ralentir. Quand on parle de pressions exercées par les marchés sur les banques centrales, il s’agit toujours de pressions pour faire baisser les taux, jamais pour les faire monter, même si cela est dans l’intérêt bien compris du pays et de son économie. Éventuellement, avec le recul, des analystes peuvent reprocher à une banque centrale de ne pas avoir été assez ferme à une époque donnée, mais, sur le moment, personne ne l’a sûrement encouragée à relever ses taux directeurs. Un banquier central doit savoir que, s’il fait bien son métier, il sera forcément impopulaire. On ne peut pas serrer la vis et être aimé. C’est bien pour cela que, dans la plupart des pays, les banques centrales sont aujourd’hui indépendantes du pouvoir politique : si l’on veut une politique monétaire sérieuse, il ne faut pas la confier à quelqu’un qui devra un jour ou l’autre solliciter les suffrages des électeurs.
Les taux longs élevés (pour simplifier, on n’est pas obligé de parler de taux à court terme ou à long terme, on peut employer les expressions plus ramassées de « taux courts » et « taux longs ») ne sont pas non plus très aimés des actionnaires. La concurrence entre les différentes formes de placement s’exerce, pour l’essentiel, par leur rendement. Si les emprunts d’État sont bien rémunérés, mieux vaut acheter des obligations, qui sont en théorie peu risquées, que des actions. De surcroît, des taux longs élevés ne sont pas favorables à l’investissement des entreprises et donc à leur développement et à leurs bénéfices futurs.
Pour résumer toutes ces informations très demandées par les actionnaires, il existe un instrument très pratique : la courbe des taux. Sur un même graphique, vous mettez tous les taux, du court terme (au jour le jour, à une semaine, à un mois, à trois mois, etc.) au long terme (selon les pays, vous pouvez inclure les taux à trente ans ou à cinquante ans, mais en allant jusqu’à dix ans, vous avez déjà l’essentiel des informations), et vous obtenez ainsi la courbe des taux. Si le taux au jour le jour est bas et le taux à dix ans un peu plus haut (par exemple avec un écart de 1,50 point de pourcentage – 150 points de base si l’on veut parler comme les professionnels ! – ou de 2 points – 200 points de base), on a une courbe normalement pentue, qui est plutôt de bon augure. Si le taux au jour le jour et le taux à dix ans sont peu séparés, on a une courbe des taux plate ; c’est généralement une situation transitoire. Enfin, quand les taux à long terme sont plus bas que les taux à court terme, on a une courbe inversée. Cela veut dire que la banque centrale est en train de donner un sérieux coup de frein en relevant ses taux directeurs et c’est généralement un assez mauvais signe pour la Bourse.