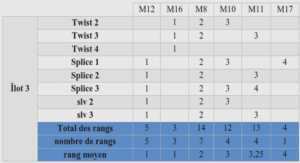CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Étymologiquement, le mot sociologie vient du latin « socius- » signifiant élément social, société et du grec « logos » désignant étude ou science. Littéralement, elle désigne l’étude de la société, de la vie sociale. La sociologie est définie de manière générale comme l’« étude scientifique des faits sociaux humains, considérés comme appartenant à un ordre particulier, et étudiés dans leur ensemble ou à un haut degré de généralité ». De ce fait, elle vise à « étudier les manières de vivre et d’agir ensemble » par l’analyse et l’interprétation des interactions, des organisations, des changements sociaux afin d’en étudier et d’en élaborer « des lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux » .
Ainsi, la sociologie réside à l’étude scientifique des « faits sociaux » et se soucie à une observation profonde de tous les secteurs de la vie sociale.
L’école et le système d’enseignement à Madagascar
Le terme relatif à l’enseignement nous amène à orienter notre réflexion d’une part, sur « les enjeux de l’école » et d’autre part, sur « son fonctionnement dans l’organisation de la vie sociale ». En d’autres termes, selon la perspective spielo-durkhémienne, l’institution scolaire est un instrument de socialisation(s).
De prime abord, elle intervient dans la transmission de savoirs, c’est-àdire les «savoirs enseignés » . Ensuite, elle se doit d’assurer une « éducation sociale » en dirigeant l’intégration sociale et en préparant l’insertion professionnelle.
Des visées sociales et évolution de l’école à Madagascar
L’objet de ce travail réside sur une analyse des curricula dont l’objectif est d’expliquer les nécessités sociologiques de l’enseignement et les attentes socio-professionnelles des institutions scolaires. Avant d’aborder le thème qui nous intéresse, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle (la formation paramédicale), nous croyons utile de procéder par un survol historique de l’enseignement à Madagascar.
Partant de la définition étymologique même du terme « éducation », du latin educatio signifiant « éduquer », l’éducation a pour sens la « mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d’un être humain » .
Autrement dit, « diriger le développement, la formation de quelqu’un par l’éducation» consiste à conduire un être non social à devenir social. Pour André LALANDE, l’éducation est le « processus consistant en ce qu’une ou plusieurs fonctions se développent graduellement par l’exercice et se perfectionnent et le résultat de ce processus » .
Partant des conceptions antiques de l’éducation jusqu’à nos jours, l’école reste l’institution sociale par excellence ayant pour finalité la socialisation des individus. Mais encore, le fondement de l’éducation ou encore l’enseignement a pour conséquence « la transmission des connaissances codifiées dans le cadre institutionnalisé, en l’espèce l’école, a vu le jour au fur et à mesure du développement des forces productives, suivi d’une complexité croissante des tâches, et découlant de la division du travail. (…) Le besoin d’un enseignement assuré par l’école est un phénomène général et vital pour les sociétés humaines ».
Dans cette perspective, « la socialisation révèle les enjeux de l’éducation : apprentissage des valeurs, des idées, des sentiments, des savoirfaire et des savoir-être » . Pour Émile DURKHÉIM, l’éducation vise à la transformation de l’être « asocial » en un être « capable de mener une vie morale et sociale ».
En effet, à partir du XIXème siècle, à Madagascar, l’école maintenait déjà des fonctions « de socialisation, de régulation sociale et de contrôle social ». La première école a été ouverte à Antananarivo en 1820 par des missionnaires de la L.M.S avec l’autorisation du Roi RADAMA I. Toutefois, les savoirs et enseignements offerts, depuis l’institutionnalisation de l’école , a engendré un phénomène de désinstitutionalisation et dépravation des valeurs traditionnelles malgaches, jusqu’à déstabiliser l’unité culturelle de Madagascar au profit de l’implantation coloniale.
L’école aristocratico-constructiviste anté-coloniale
« Il faut que cette terre m’appartienne, la mer sera la limite de mon royaume » , telle était la philosophie de la conquête de l’Imerina et de l’île du Roi ANDRIANAMPOINIMERINA. Transmise à son fils RADAMA I, cette idéologie avait comme fondement le maintien de « l’unité culturelle de Madagascar » et «l’unification de l’île ». En effet, l’unification politique de la grande île atteint son apogée quand les français arrivèrent.
D’abord, l’école du règne de RADAMA I était un « instrument de régulation politique ». RADAMA I, s’alliant avec le Gouverneur de l’île Maurice, Robert FARQUHAR étend son royaume. Il fût le premier roi à accepter l’ouverture de Madagascar à la civilisation étrangère. « Diplomate, intelligeant, ami de l’instruction», « il accorda aux étrangers le droit de prêcher leur foi à condition qu’ils enseignassent en même temps à ses sujets (…) les savoirs qui donnaient aux Occidentaux leur supériorité technique » . Autrement dit, l’influence de la modernité et de la civilisation occidentale exigeaient des connaissances techniques pour l’amélioration du système de production.
Une école sélective et utilitaire aristocratique qui enseignait la lecture, l’écriture, le calcul et le français par les soins du Français Robin à ses sujets. Les premières écoles à Madagascar dans la première moitié du XIXème siècle constituées par un seul niveau étaient destinées aux aristocrates et à la bourgeoisie, comme le confirme le passage suivant, « Les écoles coraniques des Antemoro islamisées dispensaient l’enseignement de l’arabico-malgache, du coran et de l’astrologie à des élèves sélectionnés issus des classes privilégiés. Nous avons vu que les écoles fondées par les missionnaires de la L.M.S à Tamatave et à Tananarive s’adressaient avant tous aux fils de chefs » .
Quant à son armée, HASTIE et BRADY, instructeurs des troupes, s’occupaient de l’éducation militaire. Une perspective qui abonde sur la conception utilitaire de l’éducation de Herbert SPENCER (1849) qui selon lui est « une activité qui assure le maintien de l’ordre social et politique ».
De plus, conscient d’une civilisation malgache fondée sur la riziculture inondée, l’élevage du bœuf, les activités socio-économiques de l’époque,… l’industrie commença à se développer, de même que l’enseignement technique. De par l’enseignement du français, de l’évangile, l’enseignement technique de l’époque nécessitait l’apprentissage de la langue anglaise basé sur des ateliers « de tissage, de menuiserie, de forge ». Des missionnaires et artisans, « un Français, le gros, charpentier, et deux Anglais CAMERON et HOVENDON, industriels, apprirent aux malgaches l’usage de divers outils ; les derniers fondèrent même la première imprimerie à Tananarive » (Une industrialisation et technicisation reflétant le précapitalisme d’alors). Mais encore, en organisant la vie socio-économique de l’île, il monta un corps juridique, les « ANDRIAMBAVENTY ».
Tout cela pour démontrer les fonctions socio-économiques et politiques de l’institution scolaire dès le règne de RADAMA I car « L’hégémonie du royaume merina à partir du XIXème siècle est liée à la constitution d’un véritable « appareil d’État », d’un corps de fonctionnaires – sans rémunération régulière toutefois – d’un ensemble de lois écrites, de l’introduction délibérée de savoirs et de techniques d’origine occidentale, et cela, par l’intermédiaire de l’école » (la fonction politique et de régulation sociale de l’école).
INTRODUCTION GÉNÉRALE |