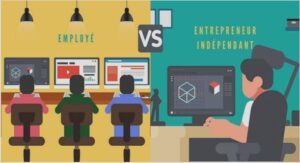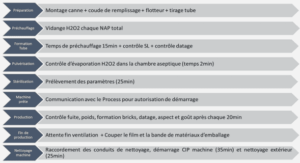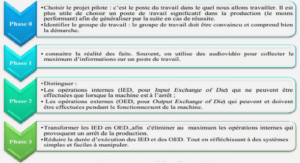ANALYSE ET DEFINITON DU BONHEUR
Il est difficile de concevoir un individu recherchant non pas son bonheur, mais son propre malheur. L’homme, en tant qu’être de désir, cherche par tous les moyens une vie heureuse, sans complaisance et sans dérive. Il est toujours en quête du bonheur, puisque tout être humain, quelles que soient sa race et sa classe sociale, cherche une vie heureuse. D’ailleurs, tous les hommes, explique Pascal dans sa philosophie, cherchent à être heureux.
L’accès au bonheur paraît être un désir universel, mais dans ce constat, c’est la définition même du bonheur et son interprétation qui font immédiatement problème. Pour les uns, ce bonheur prône l’assouvissement des désirs, mais d’autres qui se trouvent dans la richesse, plaident pour le renoncement aux plaisirs. Mais selon Pascal, il n’y a de bonheur possible que dans la religion. La question qui se pose alors est la suivante : «Qu’est-ce que le bonheur ?».
Avant d’aborder cette question, on doit souligner que le terme ne s’applique qu’à un être pleinement conscient, et donc capable, d’une part, de concevoir ce qui peut le rendre heureux, de l’autre, d’apprécier relativement à cette conception, la situation dans laquelle il se trouve. Cet être ne sera rien d’autre que l’homme. Ce n’est que métaphoriquement que l’on peut évoquer le bonheur d’un animal, car il n’y a de bonheur que là où existe une réflexion sur l’accord possible entre l’être et le monde.
LE BONHEUR ET LA VIE HUMAINE
Le rigorisme kantien et la position de Pascal rejoignent la tradition chrétienne : le bonheur n’est pas de ce monde, mais il est toujours posé dans ce monde. C’est néanmoins au XVIIIème siècle que l’éventualité du bonheur commence à être pensée en relation avec les conditions de la vie sociale. C’est ainsi qu’il est impossible de poser la question du bonheur sans celle de l’existence, puisqu’il faut que l’homme existe pour pouvoir parler du bonheur.
En effet, la notion d’existence fait l’objet principal de la tradition philosophique, bien que certains systèmes philosophiques l’aient mis dans les oubliettes. D’ailleurs, beaucoup de philosophes depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, entre autres Socrate, Pascal et Kierkegaard ont réfléchi sur ce problème de l’existence. Cependant, cette question constitue aussi la toile de fond de toute religion. C’est ainsi qu’avant de savoir ce qu’est exister philosophiquement, il serait mieux de voir d’abord les explications que nous donne la Bible en ce qui concerne l’existence. Cette démarche nous paraît importante, puisque le philosophe dont il est question ici s’inspire assidûment du christianisme pour expliquer le bonheur.
LE BONHEUR DANS LA PHILOSOPHIE
Le bonheur a toujours été l’objet principal de la philosophie. Aussi n’est-il guère possible de comprendre les démarches des grands philosophes fondateurs, ceux de l’Antiquité ainsi que ceux des Temps Modernes, si l’on ne saisit pas leur rapport au bonheur. Et si l’on estime qu’il y a aussi une forme de pensée philosophique au sein des religions hindouistes et bouddhistes, force est de remarquer que le bonheur y constitue également une question centrale.
Tout cela n’est guère étonnant, car le bonheur est d’abord le but poursuivi par tout homme, dès lors qu’il se donne une fin propre. En effet, pourquoi travaille-t-on si ce n’est que pour gagner de l’argent ? Et pourquoi veut-on de l’argent, si ce n’est que pour pouvoir acheter les choses dont on a envie ? Et pourquoi veut-on satisfaire ses envies si ce n’est que pour être heureux ? Et si l’on cherche plutôt à exercer une activité plaisante, c’est encore en vue d’être heureux. Chaque chose plus ou moins subalterne que l’on désire, chaque action que l’on accomplit a donc pour but ultime le bonheur. Les choses n’ont de valeur que parce qu’elles contribuent, soit à notre survie, soit à notre bonheur.
LE BONHEUR ET LA SUPERSTITION
Comme le bonheur est le concept de base de notre thème, nous n’avons pas manqué de le définir et de l’analyser dans les pages précédentes.
Le travail qui nous attend ici, dans ce chapitre, est certes, de l’aborder encore une fois, mais dans son rapport avec le concept de superstition. Il s’agit notamment d’expliciter ce dernier, et de montrer du coup la façon dont les superstitions conçoivent le bonheur. Mais avant tout, qu’est-ce qu’on entend justement par superstition ?
Etymologiquement, la notion de superstition vient du latin superstitio qui signifie croyance. Selon le Petit Larousse illustré, la superstition désigne :
« Une déviation du sentiment religieux, fondée sur la crainte ou l’ignorance, et qui prête un caractère sacré à certaines pratiques, obligations, etc. Croyance à divers présages tirés d’événements fortuits (salière renversée, nombre 13, etc.) »
De toute façon, cette croyance qu’est la superstition est généralement considérée comme dénuée de tout aspect rationnel. Elle s’inscrit a fortiori dans le cadre des forces invisibles et inconnues qui sont souvent influencées par des objets et des rites. C’est pour cette raison que la magie, la sorcellerie et les sciences occultes en général, sont souvent prises pour des superstitions.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : ORIGINE DE LA PHILOSOPHIE RELIGIEUSE DE PASCAL
CHAPITRE I : LES ORIGINES LOINTAINES
I.- LE SCEPTICISME DE PYRRHON ET DE MONTAIGNE
II.- LE STOICISME D’EPICTETE
CHAPITRE II : LES ORIGINES IMMEDIATES
I.- LES JANSENISTES (AUGUSTINISTES)
II.- LES JESUITES (MONDAINS)
DEUXIEME PARTIE : LE BONHEUR DANS LA PHILOSOPHIE
CHAPITRE I : LE CONCEPT DU BONHEUR
I.- ANALYSE ET DEFINITON DU BONHEUR
II.- LE BONHEUR ET LA VIE HUMAINE
III.- LA VISION PESSIMISTE DU BONHEUR
CHAPITRE II : LA RECHERCHE DU BONHEUR
I.- LE BONHEUR DANS LA PHILOSOPHIE
II.- LE BONHEUR DANS LA RELIGION
III.- LE BONHEUR DANS LA SCIENCE
IV.- LE BONHEUR ET LA SUPERSTITION
TROISIEME PARTIE : LA CONCEPTION PASCALIENNE DU BONHEUR
CHAPITRE I : LA VOIE DU BONHEUR
I.- L’HOMME EST UN « ROSEAU PENSANT »
II.- LE CHRISTIANISME
III.- LA FOI
CHAPITRE II : LES OBSTACLES AU BONHEUR
I.- L’INCOMPLETUDE ET LA FINITUDE DE L’HOMME
II.- LES PUISSANCES TROMPEUSES
III.- LE DIVERSTISSEMENT
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE