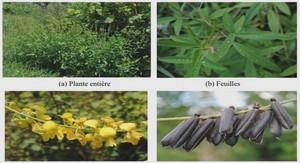Madagascar vit un phénomène d’indigence et d’insécurité alimentaire prégnante, étant donné qu’il figure parmi les 66 pays à faible revenu et à déficit vivrier (FAO, 2012). Environ 51,5% des familles malgaches sont victimes de la sous-alimentation (INSTAT, 2011), mais ce chiffre ne tient pas compte de l’état des personnes privées d’accès à une nourriture variée, qui souffrent de carences en micronutriments, tels que le Fer et la vitamine A. Pourtant, le droit à la nourriture est un attribut de la dignité humaine et parler de développement est tout simplement absurde tant que le peuple est soumis à l’emprise de la faim. Face à ce constat, le combat contre la faim est aujourd’hui reconnu comme un défi stratégique pour Madagascar, en se synchronisant avec la lutte pour la réduction de la pauvreté.
Dans la mesure où le pays compte 79,7% de ruraux dont une large majorité de 76% vivent de l’agriculture (INSTAT, 2011), la voie de la sécurité alimentaire durable va passer par une relance active des systèmes agricoles. Cependant, malgré des ressources agropastorales et halieutiques importantes, la grande Île est depuis 1970 confrontée à un déficit chronique de sa balance commerciale au niveau des denrées alimentaires. Ainsi, les importations en aliment de base ou en riz oscillent entre 150 000 à 300 000 tonnes par an (MAG PANSA, 2005). Le recul continu des disponibilités céréalières par tête atteste la morosité du secteur primaire, dont la croissance peine à suivre la vitesse de la progression démographique. De plus, l’univers de la production agricole est menacé par la dégradation des ressources naturelles, l’érosion des sols et le déboisement lesquels contribuent à inhiber l’effort des paysans vers la suffisance vivrière et jouent dans le sens d’une accentuation de la pauvreté.
Dans le milieu rural, le fardeau de la crise politique se reflète par la propagation de l’insécurité, l’inertie économique et la détérioration des infrastructures. La variation des prix, du temps et des récoltes entraîne une fluctuation perceptible du niveau de consommation alimentaire des ménages vulnérables, d’une manière qui met à rude épreuve leur statut nutritionnel. Le système tourne en boucle, car la malnutrition amoindrit la capacité de travail et de résistance aux maladies, limitant ainsi la perspective de relever la production alimentaire et d’augmenter le revenu.
Etape préliminaire
Justification du thème
A l’instar des pays d’Afrique, Madagascar est plongé dans une insécurité alimentaire grandissante. La plupart des personnes sous-alimentées à Madagascar résident dans les zones rurales et tirent principalement leur subsistance des produits de la terre. Très souvent, les exploitations agricoles sont sujettes au déficit alimentaire en raison d’une récolte insatisfaisante due à l’exigüité des parcelles, à la faible utilisation d’intrants et à la survenance des catastrophes naturelles. « L’insécurité et la pénurie alimentaire sont en outre perçues comme les formes les plus extrêmes des aspects multidimensionnels de la pauvreté » (PAM, 2005). Un de ses aspects est la malnutrition dont souffrent 50% des enfants malgaches de moins de 5 ans, (ONN, 2004) et qui trouve un terreau fertile dans les habitudes alimentaires inappropriées, l’illettrisme et la dégradation des services sociaux de base.
Dans ce contexte, le travail d’investigation justifie sa pertinence en s’employant à découvrir les moyens les plus probants pour extraire les paysans malgaches de la pauvreté et mettre un terme au scandale de la faim, qui à une telle échelle, constitue une menace sur l’avenir de l’économie mondiale et la stabilité de la paix. Sur un autre plan, le thème de l’étude répond à une double visée : (1) l’utilité de fournir des données fiables et mises à jour, afin d’apprécier l’évolution de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, conformément aux attentes de l’organisme d’accueil ; (2) l’ambition de traiter un problème complexe, qui ouvre la porte à plusieurs rentrées d’analyse et permet la mobilisation d’un bouquet d’outils conceptuels.
Portrait de la zone d’étude
L’étude s’est déroulée dans la Région d’Itasy, dont l’attrait unique mérite d’y prêter une attention profonde. En fait, Itasy a la réputation d’être un grand bassin céréalier sans que la moitié de ses habitants soit pour autant affranchie de la malnutrition (INSTAT, 2010). La zone d’étude, telle qu’exposée dans la Figure 1, est circonscrite aux Communes Rurales de Miarinarivo II et d’Analavory, qui ont été délibérément choisies en raison de leur proximité avec le siège de l’organisme d’accueil. Il s’agit de deux zones limitrophes, qui ont l’intérêt d’offrir une large variété de situations, tant au regard de la puissance agricole que de la vulnérabilité nutritionnelle.
Concepts de base de l’étude
Concept théorique de la sécurité alimentaire
a) Définition
L’aliment est un élément vital à la physiologie humaine, auquel l’individu doit sa survie, sa capacité de travailler et de grandir. De ce fait, il figure parmi les biens universels, c’est-à-dire les biens que les agents chercheront toujours à atteindre, «les fonctions auxquelles nous avons raison de tenir ou d’aspirer » (Bertin, 2008). Cette préséance alimentaire est confirmée par la loi de Maslow, qui place la nourriture au rang des besoins primaires de l’être humain au même titre que l’air, le repos, l’élimination ou le sexe (Bremond et Geledan, 1984). Selon le Sommet mondial de l’alimentation, «la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active» [29].
b) Dimensions de la sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire revêt 4 dimensions principales : la disponibilité, l’accessibilité, la stabilité et la qualité nutritionnelle .
✔ Disponibilité
Historiquement, la situation alimentaire se mesurait à l’aune de la disponibilité, qui suppose que le pays doit produire ou importer des quantités d’approvisionnement qui soient à la hauteur des besoins de la population. La disponibilité reste toutefois une richesse virtuelle, car les vivres peuvent manquer à l’endroit et à l’époque où le peuple en a besoin (Peter, 1986). En effet, les pays qui se sont lancés dans la poursuite de l’autosuffisance alimentaire en tablant sur la subvention des intrants agricoles et la hausse du prix à la production se sont aperçus très vite que la faim n’a pu être éliminée malgré l’abondance des denrées de base (FAO, 2002).
✔ Accessibilité
Vers les années 1980, ce constat a conduit la FAO à une révision des méthodes d’estimation de la sécurité alimentaire, en ce sens qu’à la disponibilité céréalière par personne il a ajouté un autre critère, celui du revenu par habitant ou « le droit à l’échange », pour employer l’expression d’A.K.Sen (Peter, 1986). On est donc passé du concept selon lequel la faim provient du manque de provisions disponibles vers un nouveau concept où la faim résulte de la faiblesse de revenu (Drogué et al, 2006). La dimension de l’accès tourne sur la densité de la ration énergétique, la variété de la base alimentaire, et l’équilibre harmonieux des apports nutritifs.
✔ Stabilité
D’autres auteurs insistent sur la dimension temporelle de la sécurité alimentaire, pour souligner la périodicité des déficits alimentaires due à l’irrégularité des flux d’approvisionnement. Il y a l’insécurité alimentaire transitoire, qui correspond à un « déclin temporaire de l’accès à la nourriture, en raison de l’instabilité de la production alimentaire, des prix ou des revenus » (FAO, 2002). Par exemple, la famine qui a touché les peuples du Sahel et de la Corne de l’Afrique durant les épisodes de sècheresses de 1983 à 1985 peut être assimilée à cette variante d’insécurité alimentaire (FAO, 2002). Il y a l’insécurité alimentaire chronique quand la pénurie de vivres est un problème constant pour les individus et les familles, à la suite d’une forte croissance démographique ou de problèmes socio-économiques.
✔ Caractéristique nutritionnelle
Cet aspect porte sur la salubrité de la nourriture et son utilisation effective par l’organisme. Il sous-tend l’appropriation par la population des principes d’hygiène et de santé, l’accès facile à l’eau pure et aux dispositifs d’assainissement, la pratique judicieuse du sevrage et de l’allaitement maternel.
INTRODUCTION |