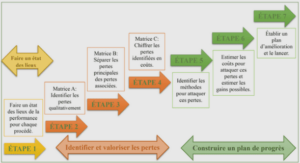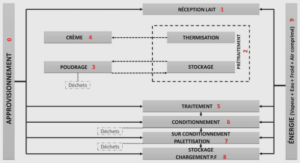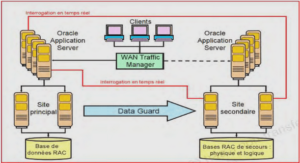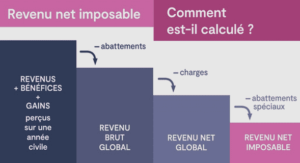Phase 2 : Etude de comportement mécanique de l’ossature
A la base des données recueillies à partir de la première phase et des plans deréaménagement (architecture), le fonctionnement mécanique de l’ossature peut être approché par simulation numérique et par essais en vraie grandeur (essais de chargement des planchers en bois).
A issus de cette phase, on serait en mesure de mener une étude diagnostic et même d’expliquer les désordres et les anomalies entachant la structure.
Phase 3 : Etude des solutions concernant la construction
Cette phase portera sur l’étude et la proposition des solutions de reprise à même d’assurer des restaurations et/ou des renforcements durables et appropriés à la nature de la construction existante, aux réaménagements projetés et aux conditions générales du site (techniques, esthétiques, etc.)
Cette phase étant menée en collaboration avec les différents intervenants dans l’opération.
Matériaux autres que le bois
En général sur un chantier de restauration d’un bâtiment traditionnel on relève la présence des matériaux suivants :
– Briques pleines
– Mortier de chaux et autres mortiers
– Zellige
– Tout venant
– Produits industriels de traitement
– Produits d’étanchéité
Schéma d’action :
– Identifier les matériaux en place
– Comprendre le mode de mise en œuvre
– Prélever des matériaux pour des essais au laboratoire
– Caractériser les matériaux au laboratoire pour reproduire le même aspect architectural avec des matériaux répondants aux performances demandés.
– Contrôle de l’exécution des principes de reprise.
Intervention sur place
Cette phase préliminaire nécessite l’examen des matériaux sur place. Une analyse détallée des dégradations et une enquête sur histoire de ces matériaux.
Caractéristiques des matériaux
L’objet est de permettre à l’expert en modélisation numérique d’introduire des données fiables dans le code de calcul. Une deuxième phase consiste à étudier des matériaux qui auront le même aspect architectural mais des caractéristiques qui peuvent différer des matériaux en place.
Suivi et assistance technique
Par des visites périodiques, il sera procédé à une évaluation des travaux en cours et à l’examen de leur conformité aux principes préalablement définis.
Eléments en bois
Le but de la démarche consiste à établir un diagnostic permettant de repérer les zones présentant des problèmes, ensuite définir les causes, et en fin proposer des solutions de réparation et de restauration.
Les actions à entreprendre sont :
1. Rassembler l’information afin d’étudier et de comprendre le système constructif.
Ceci nécessite une intervention sur le terrain pour examiner l’ensemble des ouvrages en bois et relever tous les points présentant des problèmes.
2. Relevé des dégradations du matériau, analyse des causes et propositions des solutions adéquates.
Il s’agit d’une synthèse des informations recueillies lors de la mission sur leterrain.
3. Etude des propriétés physiques, mécaniques et la durabilité naturelle du bois utilisé.
APERCU HISTORIQUE ET METHODILOGIE DE DIAGNOSTIC
LES MONUMENTS HISTORIQUES AU MAROC
Le Maroc est un pays situé dans le nord ouest du continent africain. Habité d’abord par les berbères, il a connu la succession de plusieurs dynasties arabes, qui ont fait de lui, le joyau de al civilisation islamique. En effet, elles ont construit et édifié des villes et des sites qui témoignent encore d’une civilisation brillante. Ces monuments diffèrent d’une époque à l’autre, parce que chaque dynastie, se voulant être la meilleure ; favorisait à ses artistes la voie de la création et la rénovation ; Ainsi chaque ville Marocaine a son aspect original, qui la distingue des autres villes.
Maroc Antique
Lixus se considérait comme la ville la plus ancienne du Maroc antique, dont les traditions urbaines remontaient à 1110 avant J-C, les autres cités étaient, soit d’anciens comptoirs phéniciens ou puniques, comme Zilis, Tamuda, Mogador, Tingi, Emsa, soit des bourgades maures telles que Volubilis et Sala (actuelle Chella), soit encore des fondations impériales, comme Baba Campestris et Thmusida. Chacune de ces cités comprenait de nombreux monuments et de belles maisons : on en cite particulièrement l’Arc de triomphe, la basilique et le capitole à Volubilis la romaine.
Les Idrissides
Les Idrissides sont la première dynastie arabe qui a gouverné au Maroc, sous le règne d’Idriss premier, et c’est ce dernier qui a signé en 789 la naissance de Fès. En effet, Oualili se révélant trop petite, après l’arrivée de partisans arabes d’Ifriquia et d’Andalousie, le Souverain s’est chargé de fonder une nouvelle capitale pour son royaume. Mais l’histoire considère Idriss II, son fils comme le vrai fondateur, parce que c’est lui qui, à partir de 808, a donné à la ville les véritables dimensions,. A cette époque, deux quartiers furent bâtis : Karaouyine et Andalous. Après la mort d’Idriss II, Fès continuait à être le centre de rayonnement de la civilisation islamique par la présence de la Mosquée Karaouiyine, qui représente un édifice rare en beauté, fruit d’une oeuvre inlassée d’édification, de réédification, d’embellissement et de sauvegarde.
Les Almoravides
Lorsque la dynastie Almoravide fut fondée au 11ème siècle, l’Islam avait déjà plus de trois siècles de présence au Maroc. Ils ont crée, alors un état selon leur imagination et leurs optiques propres. Pour la première fois dans l’histoire du Maroc, un état allait recouvrir de son autorité l’ensemble du pays et donner aux provinces du Sud, la place qui leur revient, et qu’illustre bien la fondation d’une nouvelle capitale, Marrakech. (454/1062).
Les Merinids
La civilisation Mérinides occupe une place de choix dans le domaine de la construction et de l’édification, ce qui a suscité l’admiration de l’auteur du « Lisan », qui pour souligner toute l’importance du modèle légué par la dynastie Mérinide, a écrit : « ce patrimoine légué par cette dynastie et qui ,souligne toute sa grandeur, n’a pas son pareil parmi tout ce qui a été laissé par les autres dynasties Marocaines, en témoignent avec éloquence les Médersas, les Mosquées, les forteresses et les autres édifices réalisés par les Mérinides ».
Les constructions réalisées par ces bâtisseurs ont été destinées à diverses utilisations. En premier lieu, ils se préoccupèrent du secteur militaire et urbanistique, sans délaisser pour autant les réalisations religieuses et culturelles tout en accordant autant d’importance au domaine social. Les Mérinides, ont édifié Fès Jdid, à 2Km à l’Ouest de Fès El Bali, en 1276, ainsi q’un groupe de portes : Dekaken, Bab Boujloud à Fès Bab El Mrisa et Bab El Ferran à Salé et une série de Médersas (Médersas Seffarine, Attarine, Masbahia, Sahridj et la Bouanannia) à Fès, (Médersa Ben youssef) à Marrakech, ensemble de Qasbah, à Meknès, Larache et Tétouan Tous ces monuments, qui sont des perles d’art, expriment la noblesse et le génie de la dynastie Mérinide.
Les Saadiens et els Alaouites
Sous les dynasties Saâdienne et Alaouite, le Maroc a cessé d’être la puissancemaritime qu’il fût à l’époque Mérinide ou Almohade. Il se trouvait pratiquement soumis au blocus maritime du Portugal dont la flotte contrôlait les eaux territoriales marocaines isolant complètement le Maroc du reste du monde. Toutefois, du début XVIè siècle à la moitié du XVIIè siècle, le Maroc Saâdien a traversé l’histoire en la marquant d’une empreinte particulière ; l’écrasante victoire dans la bataille des trois Rois. La rénovation a connu alors de nouveau sa relance, et les Saâdiens ont reconstruit Taroudant, Agadir et ils ont élargi les monuments de Marrakech et y ont édifié le palais Badia, et la MOSQU2E Doukkala ;
Les Alaouites, qui se sont installés à Meknès, ont édifié de leur part beaucoup de monuments, on en cite la Koubba El Khiattine à Meknès la Médersa Cherratine à Fès, la Qasbah des Gnoua à Salé.
METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC
Les monuments historiques subissent des dégradations qui s’aggravent de plus en plus, si des mesures efficaces ne sont pas prises pour freiner ce processus, qui est généralement mal connu et qui devient une préoccupation constante aussi bien des usagers que des responsables.
La question fondamentale est dés lors de dresser une méthodologie de diagnostic, en essayant de grouper les causes de dégradations dans un ordre logique e d’en déterminer l’interdépendance. Les dégâts peuvent se subdiviser en deux grandes catégories selon qu’ils sont dus à des causes en rapport étroit avec la conception et la nature initiale du monument, ou à des causes découlant des circonstances de son histoire.
ANALYSE DES CAUSES DE DEGRADATION
La conservation et la restauration impliquant une modification des conditions d’exposition ou des facteurs qui sont à l’origine des altérations. Les grandes variétés des pierres, leur diversité de situation, et de mise en œuvre sur les monuments, font que chaque monument constitue un cas particulier, il est donc aléatoire de vouloir transposer globalement les résultats d’un site à l’autre ou d’une qualité de pierre à l’autre.
C’est pourquoi, sans études précises sur les propriétés des pierres, leurs formes d’altération et les causes de dégradation, il n’est pas possible de définir la nature des interventions à effectuer, et plus précisément la nature des paramètres à modifier pour limiter les altérations.
SYMPTOMES DE DEGRADATION
Il est possible de subdiviser les dégradations des pierres dans les monuments historiques en quatre groupes essentiels : les patines, les altérations physiques, les altérations chimiques et les altérations biologiques.
Les patines
Elles correspondent à une évolution superficielle de couleur ou de texture sans changement de la forme ou de la résistance de la pierre. L’acquisition de ces teintes superficielles est due à un léger enrichissement en oxyde de fer de la couche externe de la pierre. En effet lors de la migration des fluides par capillarité, les oxydes sont transférés vers la surface d’évaporation où ils s’accumulent.
ANALYSE DES CAUSES DE DEGRADATION
La conservation et la restauration impliquant une modification des conditions d’exposition ou des facteurs qui sont à l’origine des altérations. Les grandes variétés des pierres, leur diversité de situation, et de mise en œuvre sur les monuments, font que chaque monument constitue un cas particulier, il est donc aléatoire de vouloir transposer globalement les résultats d’un site à l’autre ou d’une qualité de pierre à l’autre.
C’est pourquoi, sans études précises sur les propriétés des pierres, leurs formes d’altération et les causes de dégradation, il n’est pas possible de définir la nature des interventions à effectuer, et plus précisément la nature des paramètres à modifier pour limiter les altérations.
SYMPTOMES DE DEGRADATION
Il est possible de subdiviser les dégradations des pierres dans les monuments historiques en quatre groupes essentiels : les patines, les altérations physiques, les altérations chimiques et les altérations biologiques.
Les patines
Elles correspondent à une évolution superficielle de couleur ou de texture sans changement de la forme ou de la résistance de la pierre. L’acquisition de ces teintes superficielles est due à un léger enrichissement en oxyde de fer de la couche externe de la pierre. En effet lors de la migration des fluides par capillarité, les oxydes sont transférés vers la surface d’évaporation où ils s’accumulent.