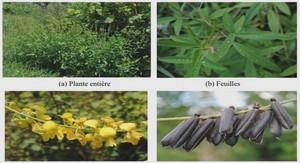Le système écologique de la zone lacustre
L’écosystème lacustre est un système dynamique qui évolue lentement avec le temps et le climat, et sous l’effet des activités humaines du bassin versant. L’élément principal d’un écosystème lacustre correspond donc à un lac étant à son tour défini comme une masse d’eau stagnante sans communication directe avec la mer, située dans une dépression du sol fermée de tout côté (Forel, 1892). Il est caractérisé par une taille et une profondeur des eaux qui lui confère certaines propriétés physiques cruciales pour la dynamique générale du système. L’espace disponible permet une grande hétérogénéité des habitats, des masses d’eau, une stratification thermique, un renouvellement total ou partiel des eaux de fond, les échanges avec les sédiments (Jaquet, 2004). En d’autres termes, un lac est de manière générale une grande étendue d’eau située dans un continent où il suffit que la profondeur, la superficie, ou le volume soit suffisant pour provoquer une stratification, une zonation, ou une régionalisation des processus qui lui sont propres. Plus le lac est profond, plus l’inertie thermique et chimique de la masse d’eau est importante. Inversement, certains vastes plans d’eau superficiels et très peu profonds seront très sensibles et immédiatement réactifs aux changements de l’environnement (climat, hydrologie, pollution, activités anthropiques). Ceci vaut d’ailleurs, mais à d’autres échelles spatiotemporelles pour les étangs et les mares.
Délimitation du bassin versant
La délimitation de la zone, du fait de la focalisation de l’étude sur le lac Itasy, correspond au bassin versant de ce dernier. En effet, un bassin versant est un territoire qui draine l’ensemble de ses eaux vers un exutoire commun. Il est limité par des frontières naturelles : les lignes de partage des eaux. De part et d’autre de ces lignes, les eaux des précipitations et des sources, ainsi que tous les éléments dissous ou en suspension (sédiments, pollution…), s’écoulent vers des exutoires séparés. Généralement, la ligne de partage des eaux correspond à la ligne de crête et le bassin versant est ainsi qualifié de topographique. Plus pratiquement le terme bassin versant (ou bassin hydrographique) désigne le territoire sur lequel toutes les eaux de surface s’écoulent vers un même point appelé exutoire du bassin versant. Ce territoire est délimité physiquement par la ligne de partage des eaux .
Traditionnellement, l’identification des limites d’un bassin versant se fait soit à partir de l’interprétation d’une carte topographique, soit à partir de l’observation stéréographique de photographies aériennes. Dans les deux cas, les possibilités de commettre des erreurs de lecture ne sont pas négligeables. Etant donné que d’autres attributs sont tirés de la délimitation du bassin versant, il est généralement souhaité de minimiser les possibilités d’erreur à cette étape. Les progrès enregistrés dans les sciences informatiques, particulièrement dans les SIG, ont, non seulement, révolutionné les façons de délimiter les bassins versants, mais éliminent aussi les possibilités d’erreur de lecture.
Cartographie de l’état des forêts et des plans d’eau
Classifications non supervisées et supervisées : La classification a pour objectif commun la découverte d’un estimateur assurant l’affectation d’une classe parmi c classes disponibles à un individu inconnu sur la base de la connaissance d‟un ensemble de m caractères le décrivant ou attributs descripteurs (Brostaux, 2005). En télédétection, la classification est une méthode par laquelle des identifiants de classes sont attachés à des pixels produisant une image sur la base de leurs caractéristiques. Ces caractéristiques sont généralement des mesures de leur réponse spectrale. Concernant les méthodes non supervisée et supervisée qui sont fort employé dans le domaine de l’analyse et du traitement des images (Lefèvre, 2008), elles sont utilisées pour la classification de l’occupation du sol à partir de données de télédétection.
Elles regroupent en général les procédures non supervisées telles que ISODATA et les méthodes supervisées dont la plus populaire et plus usitée est la classification par maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood Classifiers, MLC) (Donia et Hanan, 2012). L’interprétation des traitements des images satellites via cette méthode est appliquée dans la classification des différentes occupations du sol (Huang et al., 2007) et de leurs utilisations (Shalaby et Tateishi, 2007). La classification par maximum de vraisemblance est basée sur une procédure de classification probabiliste qui suppose que chaque classe spectrale peut être décrite et modélisée selon une loi de distribution normale. La performance de ce type de classification dépend ainsi de la façon dont les données s’accordent au modèle prédéfini. Le modèle gaussien est caractérisé par le vecteur de moyenne et la matrice de covariance des classes. Si un échantillonnage a un nombre de sites fixe, la précision des estimateurs des éléments du vecteur de moyenne et de la matrice de covariance de l’échantillon diminue avec l’augmentation du nombre de zones d’occupation du sol. Ainsi on peut s’attendre a une dégradation des performances de la classification avec l’augmentation du nombre de types d’occupations du sol. L’hypothèse que les données de chaque classe suivent une distribution normale restreint les analyses à une certaine proportion de données.
Analyse des facteurs d’influence de la dynamique des rives lacustres
Cette partie s’est basée sur des analyses bibliographiques de quelques auteurs ayant déjà effectué des études au niveau de l’assèchement d’un lac. Nombreuses sont les variables explicatives de la dynamique ayant été identifiées notamment celles dépendant de la précipitation, celles dépendant de l’anthropisation en amont du bassin versant. Toutefois, le paramètre relevant de la précipitation a été omis de l’étude vu son caractère climatique et conséquemment devant intégrer la théorie des variabilités climatiques considérée comme étant un domaine à part entière. Le paramètre démographie pour sa part s’est révélé non fiable compte tenu de non actualisation des données s’y rattachant telles le recensement dont le dernier remonte à 1993. A cet effet, la seule variable considérée correspond à la superficie forestière et l’impact de sa variabilité sur la dynamique des rives lacustres.
Table des matières
1. INTRODUCTION
2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
3. MATERIELS ET METHODES
3.1. Dispositif du milieu d’études
3.2. Le système écologique de la zone lacustre
3.3. Description des données de base et des matériels utilisés
3.3.1. Travaux de terrain
3.3.2. Descriptions des données spatiales
3.3.3. Traitement des images satellites
3.3.3.1. Traitements préliminaires
3.3.3.2. Caractérisation du bassin versant
3.3.3.3. Cartographie de l’état des forêts et des plans d’eau
3.3.4. Analyse des facteurs d’influence de la dynamique des rives lacustres
3.4. Limites du travail
3.5. Cadre opératoire de la recherche
4. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
4.1. Délimitation du bassin versant
4.2. Dynamique spatio-temporelle de l’état des forêts et des plans d’eau
4.2.1. Situation générale des forêts dans la région
4.2.2. Situation des forêts de tapia
4.2.3. Situation des plans d’eau
4.3. Analyse des impacts de la dégradation forestière sur la dynamique des rives lacustres
5. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
5.1. Discussions
5.1.1. Sur l’approche méthodologique
5.1.2. Sur les résultats
5.2. Recommandations
5.2.1. Option pour d’autres méthodes de classification
5.2.2. Amélioration des mesures de protection des bassins versants
6. CONCLUSION
7. REFERENCES