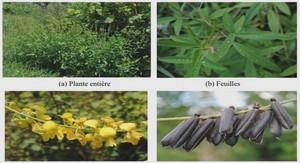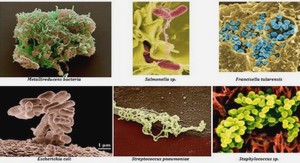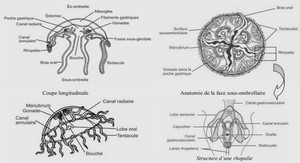ANALYSE COÛT / BENEFICE DE L’INSEMINATION
ARTIFICIELLE BOVINE
Objectif du compte de résultat
L’objectif du compte de résultat est de résumer les produits et les charges liées à la production et de déterminer le revenu agricole. Son analyse permet d’établir la rentabilité de l’exploitation.
Construction du compte de résultat
Le compte de résultat regroupe les produits et les charges de l’exploitation. Il se présente sous la forme d’un tableau en deux parties. Les charges et les produits sont respectivement présentés à gauche et à droite (RETHORE et RIQUIER, 1988).
Les produits
On appelle produits la valeur de ce qui a été produit, c’est-à-dire fabriqué pendant une période donnée (RETHORE, RIQUIER, 1988). Un produit ne donne pas nécessairement lieu à une rentrée d’argent. Il correspond à la valeur de la production brute agricole au cours de l’exercice annuel estimée aux prix du marché (MEMENTO DE L’AGRONOME, 1993).
Les charges
On appelle charge d’une production la valeur des biens nécessaires et des services effectivement utilisés pour mener à bien cette production pendant un cycle de production (RETHORE et RIQUIER, 1988). Les charges d’exploitation sont classées en charges opérationnelles et en charges de structure. Les charges opérationnelles correspondent à des coûts variables. Pour de tels coûts, une variation de la quantité de facteur de production utilisée entraîne une variation dans le même sens de la production obtenue. Ce sont en 16 général des consommations intermédiaires comme par exemple les médicaments, les minéraux, les vitamines, les aliments etc. Les charges de structure représentent des coûts fixes. Elles continuent d’exister même si les activités se modifient. Les charges de structure comprennent les frais du personnel, les charges sociales, les amortissements, les impôts, les taxes, les charges financières, les frais généraux. Certains coûts ne correspondent pas à une sortie d’argent mais ont une valeur économique qui est leur coût d’opportunité.
Les résultats Différents niveaux de résultats peuvent ensuite être calculés.
La marge brute
Elle correspond à la valeur ajoutée ou richesse créée lors du processus de production. Etant donné l’importance de l’autoconsommation, la marge brute est décomposée en marge brute monétaire et en marge brute non monétaire. Marge brute monétaire = production destinée à la commercialisationconsommations intermédiaires relatives à cette production. Marge brute non monétaire = production destinée à l’autoconsommation – consommations intermédiaires relatives à cette production
La marge nette et le revenu agricole
A partir de la marge brute, on peut calculer la marge nette puis le revenu agricole. Marge nette = marge brute – charges de structure spécifiques Revenu agricole = marge nette – charges de structure non spécifiques marge brute – charges de structure totales Le revenu agricole est défini par MARSHALL (1981) comme la différence entre le montant de la valeur de la production réalisée dans l’exercice que l’on désigne par produit global d’exploitation et ce qu’a coûté globalement cette production que l’on désignera par charges réelles. II.5. Utilisation des résultats Pour atteindre les objectifs fixés par cette analyse, les résultats du compte de résultat doivent être bien utilisés. Selon RETHORE et RIQUIER (1988), le revenu disponible ou « cash flow » mesure le flux monétaire dégagé par les activités de production pendant l’exercice. Il correspondrait à une rentrée réelle 17 d’argent si toutes les charges et produits avaient fait l’objet d’un règlement pendant l’exercice et si les stocks n’avaient pas varié. Ce revenu disponible peut avoir trois utilisations possible suivant son importance, sous forme de : – Remboursement d’une partie des emprunts en cours, – Prélèvements privés pour la famille, – Investissements éventuels. III. Deuxième méthode d’analyse : l’Analyse du Budget Partiel Cette analyse permet de voir si l’accroissement net de la production ou du revenu de l’exploitation par l’usage d’une technologie donnée, constitue une rémunération adéquate ou du moins satisfaisante des efforts déployés par l’exploitant. Le budget partiel consistant à comparer deux situations différentes, il est nécessaire, pour que la comparaison ait un sens, que ces deux situations soient stables (RETHORE et RIQUIER, 1988). L’analyse du budget partiel permet donc d’apprécier la rentabilité de la nouvelle technologie adoptée. Les bénéfices additionnels se traduisent par une augmentation de la production ou du revenu et une diminution des coûts. Les autres avantages occasionnés par l’adoption de la nouvelle technologie sont aussi considérés comme bénéfices additionnels. Pour mieux apprécier les bénéfices additionnels, une comparaison des deux situations avec et sans la technologie est nécessaire. Les coûts additionnels correspondent à une augmentation des dépenses ou à une diminution de la production ou des revenus. Les efforts supplémentaires déployés, de même que les pertes de production sont considérés comme des coûts additionnels. Les bénéfices nets ou gains nets ne sont rien d’autre que la différence entre les bénéfices additionnels et les coûts additionnels. Gain net = Bénéfices additionnels – Coûts additionnels L’analyse économique peut se faire suivant le type de données recueillies par le compte des résultats ou par une budgétisation partielle. Cette dernière méthode est plus commode dans le cas où certains produits n’ont pas de valeur marchande.
INTRODUCTION GENERALE |