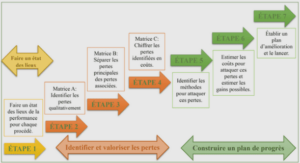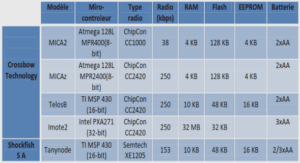Considérations de l’objet mathématique choisi
Le domaine de l’Analyse mathématique commence à se formaliser dans l’œuvre de Leonard Euler sur le calcul infinitésimal en 1748. L’Analyse Numérique est un des sous-domaines de l’Analyse mathématique. Il s’agit de l’étude des méthodes numériques qui a été objet d’intérêt depuis l’antiquité par les Babyloniens, les Grecs (Archimède, Héron d’Alexandrie) et qui donnent une réelle importance aux suites numériques.
Les suites récurrentes trouvent en partie leur importance dans un problème essentiel en mathématiques telle que la résolution d’équations �(�) = 0. En ce qui concerne les méthodes numériques et la résolution d’équations, la construction de suites qui convergent vers les racines de polynômes s’avère une méthode efficace, car on peut déterminer ses racines de manière exacte. Néanmoins, nous les trouvons seulement dans certains cas particuliers3 . Une des méthodes numériques les plus connues est celle de Newton. Ici, c’est la définition d’une suite récurrente qui converge vers une solution de �(�) = 0 qui permet de trouver les valeurs approchées d’une racine. Ainsi, l’intérêt des suites récurrentes repose principalement dans la résolution des équations numériques de ce type, dont la recherche de ces solutions ramène à un problème de point fixe (Perrin, 2000).
Le théorème du point fixe a une importance cruciale en mathématiques : il sert de base pour des théorèmes de l’Analyse et joue un rôle central en calcul différentiel4, il appartient au domaine de la Topologie, et il est possible de l’adapter à différentes applications à partir d’une méthode itérative (Rouvière, 2009, p. 147). En effet, le point fixe permet de prouver l’existence d’objets mathématiques (comme des limites), approchant ces objets avec une précision souhaitée, et il donne un contrôle de la vitesse de convergence des objets approchés vers l’objet limite. Il est basé sur la convergence de suites de Cauchy dans ℝ, c’est-à-dire, sur la complétude de ℝ.
Par ailleurs, les suites récurrentes �! »# = �(�!) sont définies par une fonction � qui détermine la relation de récurrence. Bien qu’il soit possible pour certaines suites1 récurrentes de déterminer leurs termes par une expression explicite (par exemple les suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques), cela n’est pas toujours le cas. Pour certaines suites récurrentes, on a besoin des termes précédents pour calculer un terme donné. En effet, il existe des suites générées par des fonctions dont l’étude peut parfois se compliquer5 , car la relation de récurrence �! »# = �(�!) et un premier terme ne suffissent pas pour bien définir une suite récurrente. Alors, comment étudier les suites récurrentes de sorte qu’elles soient bien définies ?
En outre, les suites récurrentes permettent l’étude de problèmes mathématiques contemporains. Un premier exemple est la modélisation mathématique de dynamique des populations (actuellement dans le cadre de la pandémie du Covid-19). Les premiers mathématiciens à s’intéresser à ce sujet étaient entre autres Fibonacci (1170-1250), Euler (1707 – 1783), Thomas Robert Malthus (1766-1834) et Pierre François Verhulst (1804-1849) (voir par exemple Bacaër (2009) et Perrin (2008)). Verhulst propose un modèle logistique pour étudier cette question, modèle qui est utilisé de nos jours pour étudier des problèmes démographiques, biologiques, épidémiologiques, économiques, géographiques, etc. Il étudie la suite logistique : une « simple »6 suite récurrente de la forme �! »# = ��!(1 − �!) peut conduire à des problèmes mathématiques très difficiles (selon le paramètre, la suite peut soit converger soit avoir un comportement chaotique). Un deuxième exemple concerne les suites homographiques. Ces suites ne sont pas toujours définies et cela dépend du premier terme de la suite. L’intérêt des suites homographiques réside dans le fait qu’elles permettent aussi de travailler dans d’autres domaines des mathématiques comme la géométrie anallagmatique qui correspond à la géométrie de l’inversion, dans laquelle on travaille en projectif (Perrin (s.d.), chapitre VI). En conséquence, les suites récurrentes �! »# = �(�!) sont un objet mathématique riche qui permet de traiter des problèmes mathématiques s’avérant a priori très simples, comme la résolution d’équations �(�) = 0, mais qui, en même temps, s’appliquent à des mathématiques plus complexes.
Motivation et objectifs de cette recherche
La place des suites récurrentes dans l’enseignement actuel nous semble pertinente compte tenu de leur importance épistémologique et de leur utilité dans le développement du domaine de l’Analyse. En France, cet objet mathématique est travaillé en fin de lycée et au début de l’université ; période où les études menées dans le champ constatent que les élèves manquent de contrôle dans leur activité mathématique au moment de travailler avec des objets propres de l’Analyse. Ainsi, la question qui nous guidera dans la première partie de cette étude est : Comment promouvoir, d’une part, le contrôle dans le travail mathématique des élèves afin qu’il soit pertinent aux problématiques de la transition lycée-université et, d’autre part, qu’il prenne en compte les spécificités des suites définies par récurrence ainsi que les difficultés que les élèves rencontrent ?
Plan de la thèse
Cette étude se compose de deux grandes parties. La partie I concerne 5 chapitres relatifs aux raisons et à la contextualisation de ce travail de thèse. Le premier chapitre est une introduction à ce travail de thèse et aux suites récurrentes. Le chapitre 2 concerne l’état de l’Art, qui a un double objectif : d’une part nous nous intéressons aux problématiques de la transition lycée-université et, d’autre part, nous faisons une révision des études sur le domaine de l’analyse, particulièrement sur les suites étudiées dans cette transition. Ensuite, nous présentons le cadre théorique qui guidera cette étude dans le chapitre 3. Puis, nous exposons la pratique du Networking théorique qui nous amène à la définition de la notion de contrôle, essentielle pour la poursuite de ce travail dans le chapitre 4. Enfin, dans le chapitre 5, nous présentons nos questions de recherche et la méthodologie adoptée pour donner réponse à ces questions. La partie
II a pour but de présenter l’étude de suites récurrentes à la transition Lycée-Université en France au travers de 3 chapitres. Ainsi, le chapitre 6 rend compte de la façon dont on enseigne les suites récurrentes avec un panorama des programmes d’études, des manuels scolaires et des tâches d’évaluation à la transition. Le chapitre 7 expose les résultats d’une étude préliminaire à nos expérimentations, visant à identifier des difficultés des élèves et des étudiants comme conséquence des caractéristiques de l’enseignement actuel de ces suites. Dans le chapitre 8, nous exposons les expérimentations réalisées, ainsi que les résultats que nous obtenons lors des analyses.
Enfin, nous présentons nos conclusions finales au sein desquelles nous faisons référence aux résultats principaux, aux contributions de ce travail dans l’étude de la transition lycée-université, et, enfin, aux limites et perspectives de ce travail de thèse.
Ampleur de la transition Lycée-Université
Les derniers ICME’s (International Congress on Mathematical Education) ont traité le sujet de la transition et mis ainsi en évidence sa portée internationale. Les difficultés issues de la transition Lycée-Université (L-U) dépendent du contexte du pays dans lequel elle est étudiée. Néanmoins, quelques résultats paraissent stables à l’échelle internationale : cette transition reste une difficulté majeure même pour de bons élèves (Luk, 2005). Dans Gueudet et al. (2016), lors d’un panel d’experts en la matière, les auteurs ont identifié différents types de transitions entre le lycée et l’université. Ces dernières impliquent, d’une part, des transitions épistémologiques et cognitives où l’apprentissage des étudiants est principalement étudié et, d’autre part, des transitions socioculturelles où l’on analyse les différentes pratiques mathématiques d’individus qui passent d’un groupe social à un autre. Plusieurs travaux, dans des domaines mathématiques différents, mettent en relief des ruptures (voir par exemple Gueudet, 2008) qui peuvent avoir des origines distinctes : enseignants, élèves ou institutions éducatives.
D’une part, la formation dispensée aux enseignants est différente selon leur futur niveau d’affectation. En effet, le travail que font les enseignants de lycée diffère de celui des enseignants de l’université. À l’université, par exemple, on trouve souvent des enseignants chercheurs en mathématiques (ou des champs liés) avec un niveau d’études en mathématiques plus élevé que celui des enseignants du secondaire (Gueudet et al., 2016). En outre, les enseignants qui appartiennent à ces institutions – lycée comme université – ne sont pas toujours sensibles à cette transition. Cela est particulièrement vrai pour les enseignants de l’université (Gueudet & Thomas, 2020). D’autre part, du côté des élèves, les ruptures semblent être beaucoup plus nombreuses que celles des enseignants. La plupart d’entre eux estiment que les élèves manquent des connaissances nécessaires à l’entrée à l’université dans des sujets
mathématiques spécifiques (Thomas et al., 2015). Les étudiants sont ainsi confrontés tantôt à un décalage important dans l’utilisation des symboles (Corriveau & Bednarz, 2016), tantôt à des difficultés dans les pratiques de preuves déductives exigées à l’université. Ces dernières difficultés sont souvent dues à une pratique de reproduction des preuves au lycée plutôt qu’à sa construction. Les différences culturelles des deux institutions auraient donc un impact considérable pour les élèves : groupes d’étudiants plus grands à l’université , différents professeurs de mathématiques, attente d’une plus grande autonomie de travail des étudiants (pour l’étude personnelle, hors et en classe), présentation des cours (plus de ressources de textes à l’université qu’au lycée où il n’y a qu’un seul manuel), niveau plus élevé des tâches données et de leurs techniques associées d’un niveau plus élevé (Gueudet & Thomas, 2020). Ces ruptures conduiraient au constat de la baisse des résultats des étudiants de première année (voir par exemple Jennings, 2009).
Par ailleurs, la littérature internationale sur le sujet de la transition témoigne des difficultés épistémologiques et cognitives. Gunter (2019) montre que les étudiants qui réussissent dans l’enseignement secondaire n’y parviennent pas nécessairement à l’université, bien au contraire. Les élèves du secondaire réussissent grâce à la reproduction algorithmique systématique mais cette reproduction semble conduire à un apprentissage superficiel. En effet, ils sont formés pour reproduire des informations mathématiques et non pour un apprentissage autonome comme celui dont ils auront besoin à l’université (Guzmán et al., 1998 comme le signale aussi Engelbrecht, 2010). À cela, il faut ajouter le coté traumatique de cette transition pour la plupart des étudiants.
Pour bien étudier cette transition, nous avons besoin de connaitre la durée de celle-ci. À ce sujet, Tall (1997, 2008) signale que cette transition commence dans les deux dernières années du lycée, et se termine une fois que les étudiants arrivent à travailler avec une pensée mathématique avancée c’est-à-dire après les deux premières années de l’université (Gunter, 2019). Néanmoins, les chercheurs ne seraient pas tous d’accord sur cette durée. Clark et Lovric (Clark & Lovric, 2008, 2009) se focalisent sur un point de vue anthropologique (et non sur le contenu mathématique) et modélisent
la transition L-U comme un « rite de passage ». Ce rite est séparé dans les trois phases « separation, liminal, and incorporation ». D’abord, il existe une séparation physique du lycée et de tout son contexte (foyer, famille, amis) ; la phase liminal correspond, quant à elle, à la position de l’élève qui se trouve entre les deux institutions (il a fini le lycée et n’a pas encore commencé l’université) ; enfin, la phase d’incorporation comprend la première année de l’université. Gunter mentionne que cette façon de modéliser la transition L-U diffère de la plupart de la littérature sur ce sujet, notamment quant à la temporalité et la réduction de l’écart entre les deux institutions.
D’une part cette temporalité réduite serait moins sensible aux problèmes épistémologiques et cognitives chez les élèves (d’autant plus qu’ils ne traversent pas la transition avec la même vitesse). Et d’autre part, la perspective de Clark et Lovric ne propose pas une réduction de l’écart entre les deux institutions en signalant que la « douleur » des élèves serait nécessaire pour affronter ce rite de passage. En nous focalisant sur la transition du point de vue des institutions, nous remarquons que le corps universitaire se plaint du manque de préparation des élèves qui arrivent en première année. Cela conduit à étudier plus souvent ce que le lycée fait (ou pas) pour préparer les élèves aux études universitaires. La plupart des études de cette transition se sont focalisées à l’université, et témoignent donc de ce manque de préparation chez les élèves. Cependant, la recherche portant sur ce que l’université fait pour recevoir les étudiants de lycée pourrait être davantage développée. Autrement dit, tout se passe comme si l’enseignement à l’université était correctement fait et que c’est seulement le lycée qui doit prendre en charge cette transition. À cet effet, Gueudet et al. (2016 ; p.21) mentionnent :