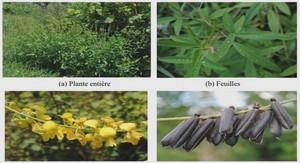La protection et l’aménagement
Les principaux risques de dégradation contre lesquels le Parc doit se protéger proviennent actuellement de la coupe illicite de bois d’œuvre, dont notamment celle du palissandre, de la coupe de bois pour la carbonisation et des feux de forêts liés au pâturage illicite à la récolte illicite d’igname sauvage (Massiba). L’endiguement des activités illégales, telles que la coupe de bois, nécessite la mise en œuvre de moyens de dissuasion et de répression, alors que la maîtrise d’un évènement en partie naturel, comme le feu, passe à travers des mesures de préventions et de traitement du phénomène par une organisation spécifique.
La polyvalence présente le double avantage que l’Administration du Parc n’est pas perçue par la population sous un angle trop répressif et que l’on évite de multiplier les effectifs du personnel. L’immersion dans les villages permet d’établir des relations de confiance, qui favorisent l’acceptation du Parc par les populations et qui facilitent aux agents l’obtention de renseignements sur activités illégales. Cependant, on ne peut pas non plus nier que l’immersion comporte le risque que les agents perdent de leur vigilance.
L’association des villageois aux patrouilles est un moyen de faire participer la population activement à la protection du Parc. Comme elle se fait sur la base du bénévolat, elle contribue aux efforts de maîtrise de coûts. La motivation des villageois pour apporter leur concours aux activités de surveillance, sans percevoir pour cela une rémunération, réside dans la perspective de pouvoir bénéficier de mesures de développement liées au Parc et dans l’obtention d’indemnités appréciables pour les frais de subsistance.
Le suivi écologique et la recherche
Le suivi écologique et l’implication de l’Administration du Parc dans les activités de recherche sont conçus dans l’optique de disposer des données indispensables pour la gestion du Parc et d’être en mesure de répondre aux exigences des bailleurs de fonds et aux souhaits d’information du public. Le suivi écologique régulier porte sur l’observation d’un nombre limité de bio-indicateurs fauniques à partir de transects installés dans des endroits représentatifs d’états intacts et dégradés des habitats. La collecte des données est effectuée par des équipes de AGP et de riverain VNA. Pour ces derniers, il s’agit de personnes qui possèdent une bonne connaissance de la faune, leur permettant d’identifier facilement les animaux à la vue, aux traces et aux cris.
A titre des frais supportés par eux et de leur manque à gagner, ils perçoivent une indemnité. Le recours à cette main d’œuvre presque bénévole permet de limiter les coûts de l’activité et d’améliorer la perception de la conservation dans les villages.
Les données provenant des transects demandent à être complétées par des inventaires exhaustifs fauniques et botaniques exigeant l’intervention de spécialistes et un budget conséquent. L’Administration du Parc entend procéder rapidement à des tels inventaires afin d’avoir une vision plus exhaustive et fiable de la diversité des ressources naturelles du Parc et de leur état. A cet effet, il semble souhaitable de pouvoir mettre à profiter compétences et connaissances des chercheurs et institution de recherche travaillant ou ayant travaillé dans le Parc.
La direction du Parc
Dans la mesure où le parc représente un intérêt particulier en termes de biodiversité et qu’il demande des moyens importants pour sa sauvegarde, l’administration doit déployer des efforts particuliers pour s’assurer les moyens financiers nécessaires, dont une partie non négligeable doit aussi dans le futur provenir de sources externes. C’est aussi dans cet ordre d’idées que l’administration a prévu de remettre à jour et d’affiner les principaux documents de planification, comme le plan d’aménagement, le plan de conservation ou le plan de gestion, lesquels doivent contribuer à convaincre des bailleurs de fonds de la pertinence de l’apport d’un soutien financier. De par sa valeur écologique, son potentiel écotouristique et la présence du Projet d’Appui jusqu’en 2008, le Parc joue un certain rôle pilote à l’intérieur du réseau PNM-ANGAP. Cette situation confère à l’Administration du Parc des tâches particulières dans l’animation du réseau. Ainsi, l’Administration est actuellement impliquée dans la révision des procédures de gestion financière du réseau, incluant l’amélioration du système comptable et portant notamment sur le renforcement des capacités analytiques de ce système.
Les Problèmes constatés sur terrain
Les problèmes de suivi sur terrain : La relation entre direction et personnel : les directeurs de parcs ne pratiquent pas un management objectif mais un management prioritaire. Le Plan de Travail Annuel n’est pas bien précis.
Les problèmes de réalisation technique : On prend comme exemple, la réalisation du poste de garde. Il n’existe plus d’une normalisation venant du siège. Pour les pares feux, le suivi-évaluation ne correspond pas à la réalité ; par exemple le responsable de suivi-évaluation exige qu’il faut des pare feux à 25m à Ankarafantsika or cela n’y serait plus possible car le terrain y est petit.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LA METHODOLOGIE
I- La méthodologie
I- Le bilan rétrospectif de la situation financière du Parc
I-I Les montants et structure de coûts de 2002 à 2005
I-2 Les sources de financement de 1997 à 2005
II- Les caractéristiques de la gestion financière du Parc pour les années 2006 à 2010
III- L’approche méthodologique et fondements théoriques des analyses
III-1 Le système PTA et ses caractéristiques
III-2 Le système d’organisation de la gestion budgétaire et financière
III-3 Le mode de contrôle de gestion
DEUXIEME PARTIE : LES RESULTATS
I- Le bilan de l’organisation et du fonctionnement des volets d’activités et d’incidences financières
I-1 La conservation
I-1-1 La protection et l’aménagement
I-1-2 Le suivi écologique et la recherche
I-2 Le développement de la périphérie
I-3 L’écotourisme
I-4 La direction du Parc
II- La projection financière pour les années 2006 à 2010
II-1 Le démarche et les hypothèses pour l’analyse des coûts
II-2 Les montants et structures des coûts
II-3 Les hypothèses pour l’estimation des recettes
II-4 Les montants et structures des recettes
II-5 Les mécanismes pour l’atteinte de l’équilibre financier
TROISIEME PARTIE : LES DISCUSSIONS
I- Les évaluations des risques de déséquilibre financier
II- Les points forts et les points faibles du Parc National Ankarafantsika
II-1 Les points forts
II-1-1 Les conservation et recherche
II-1-2 Les développement et éducation environnementale
II-1-3 L’écotourisme
II-2 Les points faibles
II-2-1 Les conservation et recherche
II-2-2 La direction
II-2-3 Les problèmes constatés sur terrain
II-2-3-1 Les problèmes de suivi sur terrain
II-2-3-2 Les problèmes de réalisation technique
II-2-4 Dans le domaine social
II-2-5 Dans le domaine ressources humaines
III- Les recommandations
III-1 Les Conservation et recherche
III-2 Les développement et éducation environnementale
III-3 L’écotourisme
III-4 Le contrôle interne
CONCLUSION