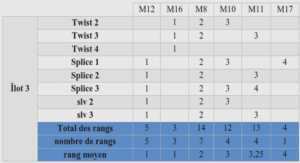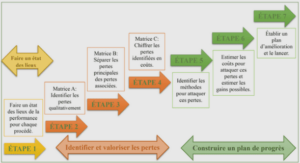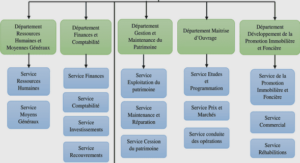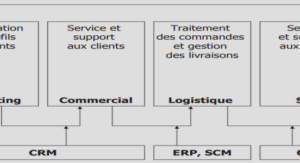Peu de mandats tels que le mandat d’administrateur auront autant vu de mutations au cours de l’histoire. Ainsi, fin XVIIIe – début XIXe siècle, le conseil d’administration représente-t-il seulement ceux des actionnaires qui détiennent le plus grand nombre d’actions , au point de conduire la Banque de France à exiger la possession individuelle minimale de 30 actions pour figurer au conseil. A la même époque s’esquisse une distinction entre conseil d’administration, représentant les actionnaires les plus importants, et conseil de direction, rassemblant les gestionnaires des sociétés, comme dans la Compagnie des Indes . Au fil du temps et de la législation, la place du conseil d’administration dans les sociétés de personnes, puis de capitaux oscille entre l’exercice effectif du pouvoir de direction, et le rôle plus restreint de supervision des actes de la direction générale. Une tendance est néanmoins continue : la disparition de l’obligation pour l’administrateur d’être actionnaire de la société pour laquelle il détient un mandat.
Depuis le début des années 2000 et la loi dite sur les « Nouvelles Régulations de l’Entreprise » (NRE), le conseil d’administration et l’administrateur ont perdu les pouvoirs de direction qu’ils avaient auparavant pour se voir accorder un pouvoir d’information, de détermination des grandes orientations de la société, et le pouvoir de se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société. Désormais, la fonction de « Président Directeur Général » est scindée en deux, ce qui autorise une répartition soit associée, soit dissociée, suivant que cette scission ait été adoptée par les sociétés concernées.
En dépit de cette perte de pouvoirs de direction, l’administrateur conserve encore quelques prérogatives du fait de son pouvoir d’information, quoique limité par le filtre du président du conseil d’administration, et par ceux de l’abus et de la confidentialité. En outre, le pouvoir par l’administrateur de déterminer les grandes orientations de la société entraîne quelques empiètements sur les pouvoirs du Directeur Général qui lui, conserve la mainmise sur la gestion courante de la société. On constate donc que le balancier semble incliner toujours plus nettement vers la vision d’un administrateur détenteur d’un pouvoir de supervision et de contrôle.
A la suite de la loi NRE, d’autres lois ont suivi, portant notamment sur le cumul des mandats, la rémunération et la diversité dans les conseils d’administration. Ces lois, depuis le début des années 2000, semblent chercher à responsabiliser l’administrateur, et une jurisprudence récente admet la mise en cause de la responsabilité de l’administrateur qui approuve ou marque insuffisamment sa désapprobation vis-à-vis d’informations fausses. Le développement de la responsabilisation de l’administrateur porterait à la fois sur sa responsabilité juridique, et sur sa responsabilité extra-juridique, « déontologique ».
Cette mise en lumière de la responsabilité extra-juridique est portée par ce qu’on appelle la « corporate governance », branche hybride du droit des sociétés et des sciences de gestion dont les pères sont Berle et Mean en 1932 . Ceux-ci ont les premiers mis en lumière la dissociation croissante entre la propriété du capital et l’exercice du pouvoir dans l’entreprise, dès lors notamment, que la société est introduite à la cote et fait appel à des capitaux anonymes dont les détenteurs ne sont pas directement associés à la gestion de l’entreprise.
Discipline protéiforme et terme difficilement traduisible , la « corporate governance » ou « gouvernement d’entreprise » vise à proposer des modes de dévolution et d’exercice des pouvoirs et des responsabilités dans les sociétés cotées, et malgré son appareil théorique, la « corporate governance » reste soumise aux développements de l’actualité. Si dans les années 1970-1980 le débat portait principalement sur la responsabilité des dirigeants en matière civile ou pénale, ou encore en matière d’Offre Publique d’Achat (OPA), les années 1980-1990 ont vu la croissance du capitalisme collectif, c’est-à-dire l’importance grandissante de la dissociation entre la propriété du capital et la gestion du capital via les fonds d’investissement. Selon Bissara, c’est la crise financière de 1987 qui a eu pour effet de pousser les gestionnaires d’actif à intervenir dans le débat sur la « corporate governance » pour y trouver un moyen de sécuriser leur responsabilité civile et pénale vis-à-vis de leurs mandants, et vis-à-vis des sociétés dans lesquelles ils investissaient. Le mouvement de la « corporate governance » s’est ainsi développé à partir de la fin des années 1990 avec la floraison de divers rapports, Cadbury (1994) au Royaume-Uni, Dey (1994) au Canada, Vienot (1995) en France.
La crise bancaire qui s’est ensuivi a eu pour effet la fragilisation du capital des banques et la restriction de l’octroi de crédits, ce qui a entraîné la crise de « l’économie réelle », la raréfaction des crédits à la consommation, et donc la chute de la consommation, la fragilisation des entreprises, et les suppressions d’emplois consécutives. En réaction à cette grave crise, un mouvement d’opinion en faveur d’une meilleure régulation du système bancaire et financier a vu le jour.
Le législateur a pris acte de ce mouvement d’opinion qui tire sa force de la notion de « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » (RSE). Selon la définition donnée par le livre vert de la commission européenne de juillet 2001, la responsabilité sociale des entreprises «sedéfinit comme une démarche d’affirmation volontaire, par les entreprises, de leurresponsabilité sociale – ou sociétale – qui se traduit par des engagements qui vont au-delà desexigences réglementaires et conventionnelles auxquelles elles sont soumises » . Cette responsabilité concerne les impacts de l’activité des sociétés sur les salariés, les populations, les consommateurs –ceux qu’on nomme les « parties prenantes » ou « stakeholders », et l’environnement notamment.
Ce puissant courant d’idée est perçu par les entreprises comme le complément éthique du respect des lois et des réglementations, et comme le moyen de donner aux sociétés multinationales une cohérence dans ses choix de gestion qui dépasse les frontières et les systèmes juridiques. L’originalité de cette démarche réside dans son aspect volontaire, et dans sa coloration morale. En effet, les entreprises ne sont pas débitrices d’une obligation de souscrire aux principes RSE, toutefois la pression des différents acteurs politiques, économiques et sociaux croit toujours davantage pour les inciter à adopter ces démarches.
Introduction |