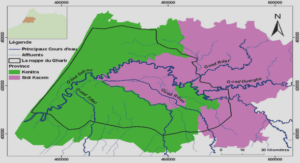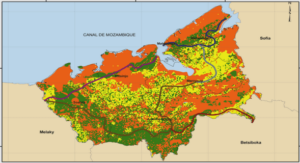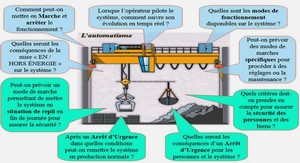Souvent décriées pour leur inertie procédurière, souvent critiquées pour leur déconnexion du « monde réel » – celui du secteur privé, de l’entreprise productive – souvent mises à l’index pour leur manque de performance dans de nombreux domaines – gestionnaire, managérial, financier ou organisationnel – les grandes organisations publiques qu’elles relèvent de la fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière, donnent l’image de structures incapables de s’adapter aux variations rapides de l’environnement dans lequel elles évoluent, sclérosées par la lourdeur de leur configuration. Parmi les recherches conduites sur les organisations publiques, les résultats des études du courant de la contingence structurelle ne participèrent guère à l’amélioration de cette image. Dès les années 60, Burns et Stalker mettent en avant dans leur typologie des structures qu’une organisation mécaniste – dont se rapproche le plus une organisation publique – ne serait bien adaptée que dans le cadre d’un environnement stable. Plus tard, c’est Mintzberg (1982) qui force le trait en présentant « les organisations gouvernementales [comme] donnant naissance à une forme fréquemment rencontrée […] : la bureaucratie mécaniste publique qui tant que l’environnement demeure parfaitement stable […] ne rencontre pas de grandes difficultés. » (pp. 290-303).
Si le courant de la contingence structurelle a eu le mérite de positionner l’organisation au sein de son environnement par rapport aux conceptions universalistes et technicistes développées par Fayol et Taylor au début du XXe siècle, et de montrer l’influence qu’exerce cet environnement sur l’entreprise, l’absence de considération du rôle de l’acteur est une critique fréquemment adressée à ce courant, la théorie de la contingence structurelle reléguant l’acteur à un rôle mineur quand il n’est pas tout simplement écarté. Crozier et Friedberg (1977) cherchent à dépasser cette vision macroscopique et déterministe qui lie la survie d’une organisation à sa capacité à ajuster sa structure à un environnement en perpétuel changement. Aussi lorsqu’ils insistent sur le rôle de l’acteur « qui sous tend l’organisation et qui seul lui donne vie et sur sa capacité à agir pour résoudre les problèmes posés par la technologie, l’environnement » (pp. 159-160), nous pouvons légitimement imaginer qu’ils se font les avocats indirects des bureaucraties mécanistes. Cette interprétation doit rapidement être mise de côté lorsque les auteurs rappellent plus loin (pp. 197-199) les difficultés de changement propres à l’organisation bureaucratique et partagent avec le reste du champ sociologique l’impression de rigidité léguée par le courant de la contingence structurelle.
Longtemps, et encore ancrée comme référence de l’analyse organisationnelle, la contingence structurelle a pourtant très rapidement montré les limites de sa pertinence. Au début des années 60, Chandler démontre que l’environnement n’a d’influence sur les structures qu’au travers de la stratégie de l’entreprise qui initie leur changement. En réponse, le changement engendré se répercute à son tour sur la stratégie de l’organisation. Cela nous ramène au rôle des acteurs construisant la perception qu’ils ont de leur environnement, la représentation qu’ils s’en font et le comportement que cela engendrera en retour chez eux pour ajuster la stratégie de l’organisation. Pour achever ce jeu d’interactions, les changements opérés dans les organisations provoquent à leur tour une évolution de l’environnement (Livian, 2010). Ces études mettent ainsi en lumière la fragilité du déterminisme ‘environnement – organisation’ avancé par les tenants de la contingence structurelle.
Abstraction faite de l’influence des acteurs, c’est sous un autre aspect que la théorie de la contingence est remise en cause par de récentes études : celui de la coordination. Abondamment développée et illustrée par Mintzberg (1982), la coordination chez les tenants de ce courant revêt un aspect de plus en plus formalisé lorsque croît la taille d’une entreprise qui évolue dans un environnement stable. De l’ajustement mutuel, cette coordination évolue en supervision directe, puis en diverses formes de standardisation (des procédés du travail, des résultats, des qualifications, des valeurs) avant de retrouver une forme d’ajustement mutuel dans les « situations les plus complexes » (pp. 23-24). Cette approche de la coordination par Mintzberg coïncide avec ce que Burns et Stalker démontrent à propos de la forme d’organisation la mieux adaptée en situation d’incertitude de l’environnement : la structure organique. Celle-ci serait la seule à même d’offrir, par une communication plus informelle et une structure hiérarchique aplatie, les conditions de réussite de l’organisation confrontée à un environnement turbulent.
C’est pourtant bien une remise en cause de cette approche à laquelle on assiste depuis le début des années 2000 (Nizet & Pichault, 2012). Cette association automatique ‘à tel environnement, telle organisation et tels types de coordination’ est mise en défaut par des études portant sur des thématiques aussi diverses que la coordination en situation extrême, celle au sein d’un grand groupe automobile, ou encore dans le cadre de la création spontanée de groupes venant en aide aux personnes confrontées à des désastres naturels (Nizet & Pichault, 2012). Les pratiques de coordination qu’on y observe interrogent la théorie de la contingence structurelle car elles s’écartent des modèles habituellement présentés par celle-ci. Dépassant une vision qui connecte de façon automatique les mécanismes de coordination et les « caractéristiques du contexte interne ou externe de l’organisation» (Nizet & Pichault, 2012), l’influence de phénomènes tels que le pouvoir ou la production de sens est mise en lumière. Ces phénomènes soulignent le rôle des acteurs et la façon dont ils « font la coordination » (p. 22), ce qui représente une approche bien moins mécanique des pratiques de coordination.
La grande organisation avec sa ligne hiérarchique verticale, ses modes de coordination reposant essentiellement sur des standards, et l’omniprésence du contrôle tant pour assurer un fonctionnement optimal de la « machine » (Morgan, 1998) que pour écarter les risques de conflits (Mintzberg, 1982) serait donc mal pourvue et bien incapable de s’adapter rapidement à un environnement incertain et mouvant. Reprenant les études de Crozier sur le « phénomène bureaucratique », et notamment le cas de « l’agence comptable », Barouch (2011) avance que l’organisation bureaucratique se comporterait comme un système homéostatique, c’est-à-dire capable de maintenir l’équilibre de son milieu intérieur peu importe les variations de son environnement. Cette stabilité interne s’expliquerait par « l’existence de règles impersonnelles » (p. 28) qui présentent l’avantage pour le subordonné de se protéger « du contrôle intrusif » (ibid.) de la hiérarchie, et pour les chefs de dépersonnaliser les décisions peu agréables et d’éviter les conflits. Un individu ou un petit groupe d’individus qui souhaiterait introduire un changement substantiel de la structure et de son fonctionnement peinerait à parvenir à ses fins car il se heurterait à l’hostilité des autres acteurs. On voit revenir sur la scène le rôle de l’acteur. La grande organisation serait ainsi, en externe, dépendante d’un environnement stable (Burns & Stalker ; Mintzberg) et, en interne, immobilisée par ses acteurs cherchant par des stratégies construites dans un « contexte de rationalité limitée » (Crozier & Friedberg, 1977) à maintenir « une marge de liberté et de négociation. » (ibid.).
Ce portrait peu engageant devrait donc avoir pour conséquence logique le résultat suivant : dès que son environnement change substantiellement, la grande organisation devrait disparaître du fait de son incapacité à s’adapter. Et cette conclusion semblerait encore plus fondée pour la « bureaucratie mécaniste publique» souvent présentée comme un symbole de l’immobilisme. Nous constatons qu’il n’en est rien. Dans une démarche épistémologique poppérienne, nous serions donc conduits à réfuter les théories précédentes. Si les grands établissements ne périclitent pas sous l’influence de leur environnement, et parviennent à évoluer malgré des acteurs enclins à maintenir le statu quo, il faut alors chercher les raisons qui infirment – du moins permettent de nuancer – la théorie de la contingence structurelle et de l’analyse stratégique. Au début des années 2000, plusieurs études de cas s’intéressent aux modes de coordination du travail et assouplissent le stéréotype d’une association automatique de ces derniers à une forme de structure organisationnelle particulière telle que l’avait notamment présentée Mintzberg (1982). Les résultats issus d’une focalisation de l’analyse sur « des situations assez circonscrites » (Nizet & Pichault, 2012) mettent alors en lumière le rôle des acteurs dans « la manière dont se pratique la coordination » (ibid.).
INTRODUCTION GÉNÉRALE |