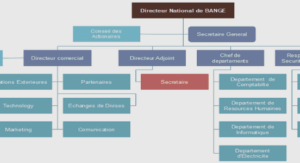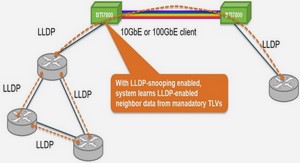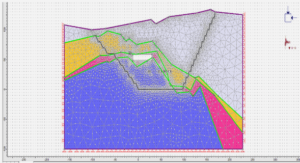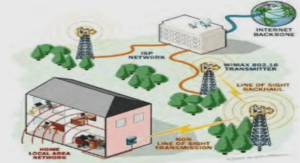Renforcement des collaborations entre collectivités et acteurs territoriaux
L’action internationale permet de créer des convergences entre les collectivités et les acteurs territoriaux à la fois sur les projets internationaux mais également localement, dans une relation qui tend vers l’horizontalité. Ces convergences, qui se caractérisent par une diversité de logiques et de configurations193, revêtent un intérêt stratégique. En stimulant la coopération entre les acteurs notamment économiques et sociaux, l’action internationale décloisonne les sphères traditionnelles d’intervention de chacun et trouve ainsi sa place en tant qu’outil de gouvernance. Elle facilite également l’appropriation des territoires par les acteurs locaux, à l’heure où ces derniers sont identifiés par leurs dimensions politiques et sociales avant leurs frontières géographiques et administratives, moins perceptibles194. De plus, le travail collaboratif de réseau sur lequel l’AICT repose favorise les échanges et l’intérêt porté acteurs locaux sur les questions publiques. Elle participe, de fait, de la cohérence et du développement local.195 Les catégories d’acteurs mobilisés dépendront en partie des échelons des collectivités territoriales. Alors que les Régions s’appuient fortement sur les acteurs du développement économique ou de l’aménagement du territoire dans le cadre de la mise en œuvre de leurs compétences, les Départements mobilisent avant tout les acteurs du développement social et de l’emploi, etc. Les Villes auront un lien plus direct de proximité avec les associations locales.
La figure 21 illustre la diversité des acteurs avec lesquels la Ville de Cergy a eu l’occasion de collaborer entre 2009 et 2012 dans le cadre du programme de coopération décentralisée Cergy-Thiès.
Durant les quatre années de mise en œuvre du programme quadriennal de coopération Cergy-Thiès (Sénégal) entre 2009 et 2012, des représentants de plusieurs familles d’acteurs locaux ont été impliqués par la Ville de Cergy. Cette implication s’est faite à trois niveaux. Un premier niveau de partenariat a rassemblé la Ville de Cergy, l’association Solidarité Cergy-Thiès et l’Université de Cergy-Pontoise autour d’un programme d’actions définies conjointement et mises en œuvre par chaque partenaire en fonction de ses spécificités. Ainsi, l’association Solidarité Cergy-Thiès196 s’est impliquée sur le volet « jeunesse » et l’animation locale du programme et l’Université de Cergy-Pontoise sur les échanges entre des enseignants-chercheurs. Ces acteurs étaient réunis au sein d’un Comité Mixte de Pilotage, chargé de définir les orientations prises et d’assurer le suivi des actions menées.
Par ailleurs, d’autres acteurs locaux ont été impliqués par la Ville sur la mise en œuvre d’actions nécessitant une expertise spécifique. L’association d’Insertion par l’Activité Économique (IAE) Incite Formation a ainsi été sollicitée dans le cadre de l’organisation de chantiers d’insertion et de solidarité internationale ; l’Ecole Supérieure d’Agro-Développement international (ISTOM) a été impliquée lors de la réalisation d’études environnementales et La Case, Centre de ressources sur le Développement Durable et la Solidarité Internationale, lié à la Ville par une convention de prestation, est intervenue tout au long des quatre années pour dispenser des modules de sensibilisation à l’interculturalité aux cergyssois concernés par les missions à Thiès. De la même manière, l’association des Ateliers Internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine a co-organisé un atelier d’urbanisme à Thiès197. Pour finir, plusieurs associations ont été sollicitées ponctuellement pour participer à des missions
• réciproques » d’échanges de pratiques professionnelles avec des homologues sénégalais sur des sujets divers (jardins familiaux, défense des droits des femmes, éducation sportive, etc.). Ces dernières ont intégré le programme en tant que « bénéficiaires » de ces dispositifs qui visaient à leur apporter une opportunité d’ « ouverture » sur d’autres réalités professionnelles. En outre, lors de l’accueil régulier de délégations thiessoises à Cergy, de très nombreuses autres structures locales ont été mobilisées sur le temps d’un rendez-vous ou d’une visite, afin qu’elles partagent leurs expériences.
Au regard de ces échanges, il ressort que cette mobilisation, importante sur une période aussi courte, a permis de lancer une dynamique locale certaine et de faire connaître la coopération décentralisée Cergy-Thiès sur le territoire local. Si certaines collaborations entre la Ville et ces acteurs ont eu un caractère ponctuel, d’autres sont vouées à se pérenniser. C’est le cas du partenariat avec l’ISTOM, avec lequel un cycle annuel de conférences sur les questions de solidarité internationale et de Développement Durable a été mis en place à Cergy.
La complémentarité des interventions de chaque acteur autour d’une problématique spécifique fonde leur légitimité et participe d’une reconnaissance des expertises de chacun. « Un acteur de coopération décentralisée est tout d’abord défini par un savoir faire, exportable sur d’autres territoires. De ce fait, l’organisme le plus apte à décliner une action de coopération est celui qui apporte la bonne réponse à la bonne question. Quelquefois, effectivement, c’est une ONG, mais ça peut aussi être une entreprise, un syndicat mixte, un hôpital, une université, une association locale, etc. La vitalité des acteurs de la coopération reflète la propre vitalité de leur territoire 198». Le rapport entre la collectivité territoriale et la structure mobilisée va alors au-delà de la relation financière qui prédomine souvent avec les organismes professionnels du développement. La figure 21 révèle le fait qu’à Cergy, les acteurs intervenant sur des problématiques locales ont été deux fois plus sollicités que ceux bénéficiant d’une expertise internationale.
Avec le temps, cette mobilisation peut se renforcer. Ainsi, à Angers, la coopération Angers-Bamako qui existe depuis 1974, fait aujourd’hui partie de la culture et de l’identité de la Ville. De nombreux acteurs angevins sont engagés: entre 70 et 80 associations, 20 établissements d’enseignement supérieur, des institutions (Centres hospitaliers, Chambres des Métiers, Mutualités), etc. La liste des organismes angevins ayant des actions suivies avec des partenaires bamakois compte plus de 120 structures, tous types confondus199. A l’instar d’autres communes françaises en Afrique, Angers a même construit une maison d’Angers à Bamako. Avant le coup d’État du 22 mars 2012, le taux de passage d’angevins dans cette maison était très important. Entre 250 et 300 acteurs locaux (associations, scolaires, stagiaires, médecins, etc.) s’y rendaient annuellement dans le cadre d’une mission de coopération entre les deux Villes200. Le coût très faible de la nuitée (entre 5 et 7 euros) est considéré comme une « aide à l’hébergement » pour les angevins, un service public, rendu à plusieurs milliers de kilomètres.
Au-delà de la dimension de gouvernance et du lien ainsi créé – ou renforcé – entre les collectivités territoriales et les acteurs locaux, l’action internationale représente également une opportunité pour ces derniers, qui disposent d’un cadre institutionnel leur permettant de confronter leurs pratiques avec les réalités d’autres territoires.
« Ouverture au monde » et élargissement des pratiques des acteurs territoriaux
Au-delà des liens qu’elle permet de nouer entre les acteurs locaux et les collectivités territoriales, l’AICT peut faciliter les synergies et les complémentarités entre les acteurs des différents territoires partenaires, pour lesquels la coopération représente une opportunité de mise en réseau à l’échelle internationale et de démultiplication de leurs actions. Ces passerelles sont un levier d’amélioration des pratiques locales. Dans le domaine du développement social, l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS), en mission à Cergy à l’occasion d’un échange de pratiques professionnelle, a été fortement sollicitée par plusieurs associations cergyssoises de défense des droits des femmes. Cet enthousiasme ne relevait pas d’un élan de solidarité internationale. Un partenariat avec une telle structure au Sénégal représentait pour ces associations un outil de réponse à plusieurs problématiques rencontrées au quotidien dans leur travail: l’annulation de mariages forcés, l’aide à l’obtention de documents officiels (fichiers d’état civil, etc.), l’aide au rapatriement, etc. D’un point de vue stratégique pour les élus des collectivités territoriales délégués à l’action internationale, le fait d’identifier le nombre et la diversité d’acteurs des territoires intéressés et mobilisés par l’action internationale peut constituer un argument permettant de justifier le maintien de ces projets en période de crise et de « sauver » ainsi des financements. Les équipes exécutives sont en effet d’autant plus sensibles à ces enjeux s’ils sont défendus par les habitants eux-mêmes.
Malgré l’intérêt potentiel de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales au niveau de la gouvernance, la pluralité des acteurs intervenant aux côtés de l’institution locale n’est pas un facteur automatique d’impacts pour les territoires. Ses retombées sont souvent impalpables et ne s’observent que sur un très long terme. Quatre ans après le lancement du programme de coopération Cergy-Thiès, cette mobilisation considérable est observable sous un angle quantitatif mais il est moins aisé d’identifier des impacts concrets. Il est difficile d’estimer si les responsables associatifs ont réellement pu réinvestir les apports de leur courte expérience à Thiès sur le territoire cergyssois. Face à ce constat, l’idée, pour la suite des actions de coopération, pourrait être de mieux cibler un nombre restreint d’acteurs amenés à se déplacer à Thiès. Ces missions seraient alors liées à des projets, déjà existants ou programmés à Cergy, que l’expérience internationale viendrait enrichir201. Le réseau relationnel et professionnel créé sur les territoires par les actions internationales des collectivités territoriales sera d’autant plus pérenne que les projets dans lesquels les acteurs ont été impliqués s’inscrivent dans une démarche locale.
Intervenir sur le même territoire local et international encourage les collectivités et les acteurs territoriaux à mettre en place un dialogue et des modalités de partenariat afin de dépasser les difficultés qui peuvent parfois émerger d’un travail commun.
Les freins au dialogue entre acteurs territoriaux
Nous avons vu, dans les parties précédentes, que l’Action Internationale des Collectivités Territoriales peut constituer un vecteur de rapprochement entre des acteurs locaux divers. Ce décloisonnement pose la question de leur coordination dans la mesure où, de leur capacité d’action collective dépendra la qualité de l’action publique territoriale202. Au-delà de son intérêt théorique du point de vue de la collaboration et du dialogue, ce rapprochement entre des structures, obéissant à leurs propres logiques et à leurs propres intérêts, est une démarche complexe. Il soulève un certain nombre de questions récurrentes sur l’équilibre des rapports entre les collectivités territoriales et la société civile : la négociation entre le partenariat et la prestation, entre la concurrence et la complémentarité, etc. Ces différences de nature conduisent, comme le propose Isabelle Leroux, à concevoir la gouvernance territoriale sous l’angle de la « mise en compatibilité des actions, des modalités de coordination et des intérêts en jeu » entre tous les acteurs géographiquement proches et parties prenantes d’un projet collectif203.
Le tableau 8 propose une typologie des difficultés potentiellement issues de ces collaborations. Différents décalages y sont identifiés en termes de culture, de moyens humains et financiers et de niveau de professionnalisation. Toutefois, ces difficultés ne peuvent être appliquées indifféremment à la diversité des acteurs concernés. Aussi, nous avons fait le choix d’axer cette analyse sur les rapports entre les collectivités territoriales et les associations de solidarité internationale – ou, les
• initiatives populaires de solidarité internationale », pour reprendre les termes du sociologue belge Gautier Pirotte204. Il s’agit historiquement (avec la création des comités de jumelages) du couple d’acteurs le plus habituel au niveau local dans la mise en œuvre de l’AICT. Ce choix est aussi lié au fait que leur accompagnement est l’une des missions des collectivités territoriales dans le cadre de l’animation territoriale de l’action internationale.
L’articulation entre les sphères associatives et politiques est sensible. Les actions internationales menées par les associations entraînent une série de dynamiques locales qui ne s’inscrivent pas forcément dans des accords de coopération portés par les Villes. Il peut alors être complexe de trouver l’équilibre entre une mobilisation des associations dans les politiques internationales et le respect du projet associatif initial. Il est parfois difficile pour les « associations-supports » des coopérations décentralisées, qui sont souvent à l’origine de l’engagement des collectivités territoriales, de trouver leur place lorsque les partenariats s’institutionnalisent. Cette question du rôle de chaque acteur peut fluctuer selon le niveau d’appropriation des questions internationales par l’équipe municipale. Lorsque les élus locaux ne s’emparent pas concrètement des projets de coopération sur le plan politique, les rôles et les frontières entre les actions de chacun – collectivités et associations – peuvent être flous. Franck Petiteville soulignait déjà en 1996 les difficultés des relations entre les collectivités territoriales et les ONG, dont les approches respectives de la coopération diffèrent. Celui-ci identifiait l’hétérogénéité des stratégies des acteurs mobilisés parmi les écueils des jumelages et de la coopération décentralisée205.
Cette problématique se pose à l’échelle des territoires français comme à celle des territoires partenaires, où la question du « qui fait quoi ?» revient régulièrement dans les échanges pour clarifier le positionnement de chacun et légitimer les différents niveaux d’action.