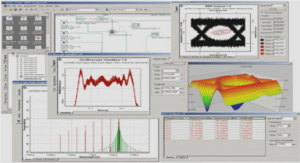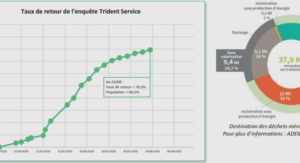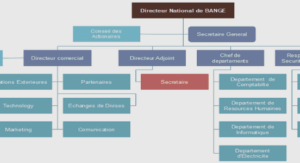Une nouvelle réalité des jeux de pouvoir à l’échelle planétaire
Avec la globalisation et l’ouverture des marchés, l’attitude et les ambitions des acteurs mondiaux changent radicalement. Une approche bien novatrice se fait imposer : ce qui devient absolument primordial c’est de décrypter les rapports de force et les enjeux de puissance sur la scène internationale selon le prisme économique et commercial tout en valorisant l’action des acteurs non-étatiques notamment celles des entreprises et des entités territoriales.
L’approche classique seule selon laquelle les relations et les conflictualités internationales étaient exclusivement mues par les relations d’État à État devient obsolète. Dorénavant, « La géopolitique étudie les relations de puissance entre l’homme en tant qu’acteur de son destin, l’espace et le territoire nourricier. En d’autres termes, nous dirons que la géopolitique est une méthode particulière qui repère, identifie et analyse les phénomènes conflictuels, les stratégies offensives ou défensives centrées sur la possession d’un territoire, sous le triple regard des influences du milieu géographique, pris au sens physique comme humain, des arguments politiques des protagonistes du conflit, et des tendances lourdes et continuités de l’histoire. »
Il déclare dans une interview :
« La montée en puissance de l’affaire Snowden début juillet [2013] n’aura surpris que ceux qui s’évertuent à nier la réalité des jeux de pouvoir à l’échelle planétaire. Oui, les Etats-Unis ont mis la planète sur écoute. Oui, ils surveillent leurs alliés, l’Europe au premier chef. Oui, leurs pôles d’intérêt dépassent de loin la guerre contre la drogue ou le terrorisme. Oui, ils se servent de leur puissance pour vaincre dans une guerre économique où tous les coups sont permis, pour faire gagner leurs entreprises. Mais cela n’est pas nouveau. Par angélisme ou par faiblesse, nous préférons ignorer ces réalités, résultat d’une combinaison subtile entre hard et soft power. »480
Les États développés donc, en position de stratèges coordonnant diverses actions de la multitude d’acteurs non-étatiques, s’engagent aux côtés de leurs entreprises nationales dans des politiques de conquête des marchés extérieurs et de prise de contrôle des secteurs d’activités considérées comme stratégiques. Leurs diplomates, au service des ambitions nationales, se doivent eux aussi d’avoir la double casquette, diplomatique et économique car, de fait, la santé économique d’une nation est l’aune à laquelle on juge désormais sa puissance.
Dans un monde de plus en plus globalisé par les nouvelles technologies d’information et de communication, la concurrence est donc planétaire. Chacun cherche âprement à gagner une part du marché global tout en œuvrant à l’élimination de l’adversaire, laquelle intention d’élimination qui devient chaque jour davantage affirmée et exacerbée. La conquête des marchés et la maîtrise des technologies les plus avancées ont donc pris le pas sur celle des territoires.
Toutefois, dans cette course effrénée à conquérir des marchés et à maîtriser des technologies de pointe, des logiques transversales en coulisses sont de mise selon les règles subtiles de l’influence et du « soft power » permettant d’en emporter les décisions. Une forme spécifique de puissance, discrètement exercée par des acteurs nouveaux481, impose donc en douceur mais avec une implacable rigueur la vision à faire primer, chacun ses propres intérêts dans un climat de guerre économique exacerbée par un patriotisme482 à caractère mercantile.
En ce début du XXIe, dans ce monde devenant global, la géopolitique a donc vécu et la géostratégie n’est valide et efficiente que si elle est planétaire car les intérêts politiques des nations se soumettent désormais à leurs intérêts économiques rendant l’environnement des relations internationales encore plus concurrentiel qu’auparavant. Un glissement indique l’ouverture d’une ère nouvelle, celle où émergent à l’horizon de nouveaux concepts et de nouvelles approches de la notion de puissance en transformation : géoéconomie483, guerre économique, intelligence économique et marketing territorial.
Chacun de ces concepts demande donc des éclairages afin que soit présentée, par la suite, la notion axiale d’influence.
La géoéconomie
Selon LOROT Pascal484 , « la géoéconomie est l’analyse des stratégies d’ordre économique – notamment commercial –, décidées par les États dans le cadre de politiques visant à protéger leur économie nationale ou certains pans bien identifiés de celle-ci, à acquérir la maîtrise de technologies clés et/ou à conquérir certains segments du marché mondial relatifs à la production ou la commercialisation d’un produit ou d’une gamme de produits sensibles, en ce que leur possession ou leur contrôle confère à son détenteur – État ou entreprise « nationale » – un élément de puissance et de rayonnement international et concourt au renforcement de son potentiel économique et social. »485
Se démarquant de la géopolitique486, la géoéconomie487 s’interrogeant sur les relations entre puissance et espace affranchi des frontières territoriales et physiques caractéristiques de la géopolitique, mobilise l’ensemble des instruments à la disposition d’un État, susceptibles d’être mobilisés par lui au service de la satisfaction des objectifs nationaux. Ce qui confère de nouvelles missions à ses représentants (fonctionnaires, corps diplomatique, ONG, collectivités territoriales, Bureaux d’étude, experts …) afin :
▪ D’identifier des secteurs d’activités clés ou vitaux,
▪ D’identifier des entreprises à défendre ou à promouvoir internationalement. (cas du TGV et du Tramway pour la France, cas parmi d’autres produits français à promouvoir sur les marchés internationaux, tâche dont s’occuperaient des collectivités territoriales).
Actuellement en France, on qualifie cela de la « diplomatie économique » qui organise annuellement une « conférence des Ambassadeurs », un rendez-vous des représentants de la France à l’étranger avec des chefs des grandes entreprises et des grands patrons de l’économie française qui discutent des grands sujets stratégiques.
Dans ce domaine, la France est en train de rattraper le retard qu’elle accusait par rapport aux anglo-saxons, américains en tête : la coopération décentralisée en est justement l’un des outils de compétition et de concurrence car les collectivités territoriales, les régions en l’occurrence, sont devenues des moyens de pénétration et des relais efficaces d’influence dans certaines zones géographiques488.
N’est-ce pas là l’objectif fondamental du projet français de l’Union pour la Méditerranée, projet qui, dans le contexte de la réelle guerre économique, piétine et met du temps à prendre forme ? L’action extérieure des collectivités territoriales françaises, telles qu’elle est exercée et menée au Maroc, pratique donc l’approche géoéconomique. La coopération décentralisée franco-marocaine, c’est donc de la géoéconomie.