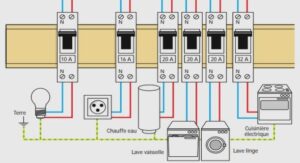L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Ces prescriptions ont une finalité purement urbanistique et contribuent à modeler la forme urbaine. Il peut s’agir soit d’implantation en limite de la voie ou de l’emprise publique, soit d’une implantation en retrait de cette limite.
Lorsque l’implantation se fait en alignement, les constructions doivent être implantées en limite de la voie ou de l’emprise publique. L’intérêt est de créer un front bâti continu.
A la différence, l’obligation d’implanter un bâtiment en retrait des voies et emprises publiques a des conséquences directes sur le tissu urbain. Cela permet notamment de libérer des espaces afin de créer des espaces verts entre les voiries et les constructions.
Le règlement peut imposer un retrait qui peut être défini de plusieurs façons. Il peut s’agir soit d’un retrait imposé (la construction doit alors respecter la distance de recul imposée), soit d’un minimum (la construction doit alors s’implanter sur la ligne de recul ou au-delà de celle-ci), soit encore un retrait relatif (en fonction de la hauteur de la construction).
Dans cette dernière hypothèse, le règlement offre la possibilité de prévoir un retrait variable en fonction de la hauteur des constructions.
Evidemment, l’intérêt de définir un recul doit se faire compte tenu des caractéristiques du territoire.
Si le territoire est déjà urbanisé, les rédacteurs du PLU peuvent soit conforter la densification, soit prendre le contre-pied en édictant des prescriptions pour les constructions nouvelles.
A la différence, dans les zones peu urbanisées ou à urbaniser, les rédacteurs peuvent complètement modeler le paysage urbain.
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A la différence des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, celles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ont une finalité mixte47. Au delà de la finalité urbanistique, elle permet également d’éviter les troubles de voisinage susceptibles d’être provoqués par les conditions d’implantation d’un bâtiment.
De manière générale, les rédacteurs de PLU ont tendance à reprendre le règlement national d’urbanisme en matière de distance aux limites séparatives. Le nouvel article R. 111-17 du Code de l’urbanisme dispose ainsi que : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres »48.
Concernant les limites séparatives, cela implique les limites latérales et les limites de fond de parcelle. Les rédacteurs du règlement peuvent ainsi fixer soit des règles différenciées selon la nature des limites, soit des règles communes. Que l’on impose un retrait par rapport aux limites latérales et/ou aux limites de fond de parcelle, l’objectif est d’aérer le tissu urbain.
Le Conseil d’Etat est venu préciser que : « Les limites séparatives s’entendent comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent ; la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie ; la circonstance qu’une telle limite séparative soit constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux est sans incidence sur la qualification de limite séparative aboutissant aux voies »49.
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Le recours à des règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété s’explique par la nécessité de faciliter le passage des engins de secours ainsi que d’assurer l’ensoleillement, l’éclairement des constructions.
Cela implique que le terrain soit destiné à supporter plusieurs constructions 50 . Les prescriptions s’appliquent à l’ensemble des constructions, qu’il s’agisse de bâtiments principaux ou d’annexes (sauf à ce que les auteurs du règlement en décident autrement).
Les rédacteurs du PLU ont la possibilité d’utiliser avec plus ou moins d’ouverture les prescriptions de l’article 8 du règlement. En effet, l’article R. 151-21 51 du Code de l’urbanisme dispose, dans son troisième alinéa, que dans le cadre d’un lotissement, « les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
Toutefois, seules les règles régissant l’implantation des constructions par rapport tant aux voies et emprises publiques qu’aux limites séparatives sont obligatoires. Elles revêtent d’ailleurs un caractère impératif.
Les règles de hauteur
Les auteurs du règlement du PLU sont autorisés, par le Code de l’urbanisme, à fixer une règle de hauteur des constructions. Le plus souvent, la règle de hauteur permet d’imposer une hauteur maximale aux constructions.
Comme évoqué précédemment, la hauteur joue un rôle important dans la perception de la densité. Patrick Hocreitère disait d’ailleurs que :
« La règle définissant la hauteur maximale des constructions est sans doute l’une des plus importantes du règlement dans la mesure où elle imprime à l’urbanisation une limite dans la troisième dimension. Elle constitue pour l’auteur du PLU un outil indispensable pour modeler le paysage de la ville, d’urbanisation existant, susciter certains monuments ou sites ».52
sa silhouette, son aspect général, maintenir le type un type d’urbanisation homogène, protéger la vue de La hauteur peut être fixée règlementairement de diverses manières. Elle est principalement exprimée en mètres (A) ou en niveaux (B).
La hauteur exprimée en mètres
Lorsque les auteurs d’un PLU imposent une règle de hauteur, il est important de définir les points permettant de la définir, à savoir les points bas et haut.
Le point bas
De manière générale, le point bas peut correspondre : au sol naturel existant avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la construction ; à la cote NGF53 ; au niveau de la rue ou de l’emprise publique.
La plupart du temps, le point le plus bas pris en compte dans le calcul de la hauteur est le niveau du sol au dessus duquel la construction est visible54.
Evidemment, le choix du point bas n’est pas sans conséquence. Par exemple, si les auteurs du règlement font le choix de privilégier le profil sur rue au détriment de la façade arrière, il est préférable de privilégier un point bas fixé par rapport au niveau de la rue.
A la différence, si le point haut est l’égout du toit, le point bas sera considéré comme étant celui à l’aplomb de l’égout du toit, même si un autre point sera situé plus bas55.
Il est toutefois déconseillé aux rédacteurs de choisir une fixation de la hauteur par rapport au sol naturel dans les zones urbanisées puisque le sol naturel peut être une plus grande source d’incertitude (recouvrement du sol, travaux d’aménagement du sol avant que le permis de construire ne soit demandé, etc.). Malgré tout, en l’absence de précision de la part des rédacteurs, le juge calculera la hauteur à partir du sol naturel56.
Le point haut
Les collectivités doivent veiller, afin d’éviter une quelconque difficulté d’interprétation, à définir précisément le point haut de la construction.
Toutefois, en l’absence de précision au sein du règlement, la hauteur sera calculée, de manière générale, à l’égout du toit, sauf si la finalité de la règle conduit à choisir un autre point de référence.
Il peut s’agir de plusieurs points :
– Le faîtage. C’est la ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture, c’est le point le plus haut d’une construction ;
– L’égout du toit permet de définir une hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture important ;
– Le sommet de l’acrotère. Ce point est plus proche de l’égout du toit et permet de favoriser les toitures terrasses. Il favorise également l’aménagement des combles ;
– Le plancher le plus élevé. Il s’agit ici du plancher du dernier étage utilisable du bâtiment57. Il est toutefois rarement conseillé d’avoir recourt à ce critère pour définir la hauteur d’une construction, celui-ci était difficilement contrôlable au moment de la délivrance des autorisations d’urbanisme ;
– La hauteur sous pente au droit de la façade. Elle correspond à toute la façade, jusqu’au faîte, combles inclus ;
– La hauteur maximale ou le point le plus élevé du bâtiment. De manière générale, la jurisprudence considère qu’il s’agit de l’égout du toit.
La jurisprudence a toujours été très fluctuante concernant les règles de hauteur. Récemment, le Conseil d’Etat a pu considérer qu’« il y a lieu de mesurer cette hauteur au faîtage et non à l’égout du toit lorsque la façade, correspondant à un mur pignon, ne comporte pas d’égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire »58.
En l’espèce, l’article UB7 du règlement du POS d’Amiens énonçait qu’ « au delà de la bande d’une profondeur de 12 mètres ou de 15 mètres, l’implantation des bâtiments en limite séparative… est autorisée si leur hauteur en limite n’excède pas 3,50 mètres ».